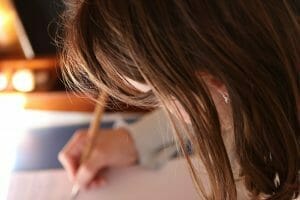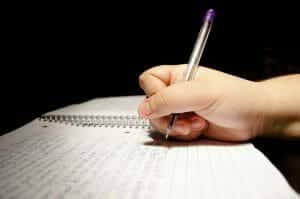Sais-tu commenter un texte de théâtre ? Dans cet article, nous te donnons nos meilleurs conseils pour briller au bac de français si tu tombes sur un texte de théâtre.
Dates du bac de français 2026
Le calendrier officiel des épreuves anticipées de français pour les élèves de première en 2026 est le suivant :
- Épreuve écrite : jeudi 11 juin 2026 (de 8h à 12h pour toutes les séries).
- Épreuve orale : à partir du lundi 22 juin 2026, selon les convocations individuelles, jusqu’au début du mois de juillet.
💡 Pense à vérifier ta convocation sur cyclades ou auprès de ton établissement pour connaître la date exacte de ton passage à l’oral.
La méthodologie du commentaire de texte de théâtre
La problématique d’un texte de théâtre
Pour trouver la problématique d’un extrait de théâtre, il faut commencer par saisir la spécificité du texte. Qu’est-ce qui le rend intéressant et exceptionnel (trouver la raison pour laquelle les jurés l’ont choisi) ?
Plusieurs axes sont possibles pour un texte de théâtre :
- Le texte est-il particulièrement représentatif d’un genre ou d’un mouvement littéraire ?
- Se distingue-t-il au contraire des autres dans un genre ?
- Quels outils littéraires sont utilisés et dans quel but ?
L’important est de trouver un ou plusieurs axes (attention à ne pas t’éparpiller non plus, un ou deux suffisent) qui concernent le texte dans sa totalité.
Attention à la problématique de ton commentaire de texte de théâtre
La problématique de ton commentaire de texte de théâtre ne doit pas être trop réduite ni se limiter à une seule partie de l’extrait. Si elle est trop étroite, tu risques d’avoir du mal à construire des axes solides et pertinents pour ton analyse. Pense à formuler une question globale qui englobe l’ensemble du texte étudié.
Comment construire un commentaire de texte de théâtre ?
Dans ton développement, tu devras toujours partir d’observations basiques pour aboutir à quelque chose de plus subtil, pointu et réfléchi.
Le premier niveau d’analyse est important pour permettre à celui qui lira ton travail de saisir la nature du texte, ce qu’il contient, etc. et pour montrer que vous l’avez bien compris.
Il faut veiller à construire son analyse de manière composée, c’est-à-dire en retenant les grandes idées du texte et en construisant son plan à partir de deux ou trois grands axes.
Évite le catalogue de procédés pour ton commentaire de texte de théâtre
Attention : évite de donner l’impression d’un simple catalogue de procédés. Utilise des mots de liaison pour structurer ton propos et pense à alterner entre des observations précises (sur une phrase) et des remarques plus larges (sur un paragraphe ou l’ensemble du texte). Cela rendra ton commentaire plus fluide et plus convaincant.
🤓 Exemple : Tout d’abord, ensuite, enfin, toutefois, cependant, en revanche, de plus, de même, etc.
Il faut tout d’abord faire attention au rythme du texte, à la place du narrateur et de l’auteur dans le texte ! Il faut ensuite ne pas oublier de bien citer le texte pour prouver ce que l’on déclare (en précisant à chaque fois la ligne). Enfin, veillez à utiliser le vocabulaire spécifique au théâtre (on ne parle pas de ligne, mais de vers ; ne pas oublier les didascalies).
Vocabulaire du théâtre : les termes que tu dois connaître pour ton commentaire composé de théâtre
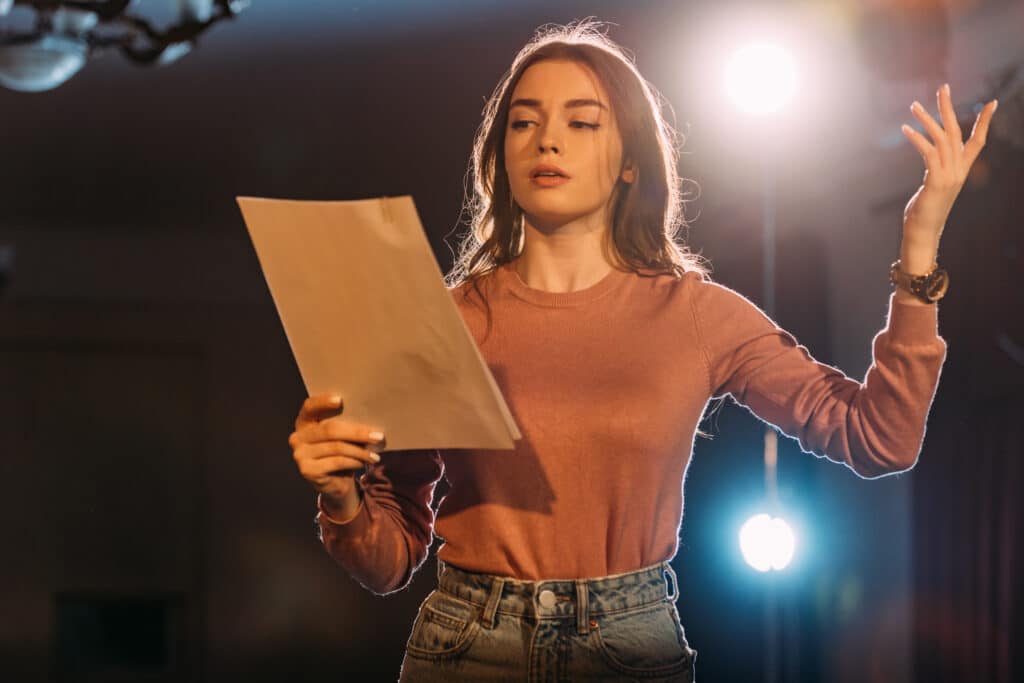
Nous t’avons concocté un petit florilège de termes à connaître pour étayer ta copie de commentaire de texte de théâtre.
| Terme | Définition |
|---|---|
| Dramaturge | Auteur d’une pièce de théâtre. |
| Acte | Grand découpage d’une pièce, composé de scènes. |
| Scène | Sous-division d’un acte ou lieu où se déroule la pièce. |
| Hors scène | Événements ou paroles qui se passent hors de la vue du spectateur. |
| Règle des trois unités | Unité de lieu, de temps (24h) et d’action dans le théâtre classique. |
| Vraisemblance | Obligation pour la pièce de paraître crédible et réaliste. |
| Bienséance | Respect des bonnes mœurs (pas de sang, de mort ou de nudité sur scène). |
| Chœur | Groupe chantant ou dansant qui commente l’action. |
| Confident | Personnage à qui les héros se confient dans les tragédies. |
| Didascalie | Indication scénique sur le ton, les gestes ou les émotions des personnages. |
| Monologue | Discours d’un personnage seul sur scène révélant ses pensées. |
| Tirade | Longue réplique adressée à un ou plusieurs personnages. |
| Stichomythie | Échange rapide de répliques brèves traduisant une tension. |
| Réplique | Paroles prononcées par un personnage sur scène. |
| Aparté | Réplique dite pour le public, non entendue par les autres personnages. |
| Soliloque | Discours qu’un personnage se tient à lui-même même s’il n’est pas seul. |
| Quiproquo | Malentendu créant un effet comique ou dramatique. |
| Grotesque | Comique exagéré basé sur la caricature et la déformation du réel. |
| Burlesque | Comique reposant sur le décalage entre le rang social et les manières. |
| Satire | Œuvre qui ridiculise des mœurs ou des comportements. |
| Saynète | Courte pièce comique avec peu de personnages. |
| Scène d’exposition | Scène initiale présentant personnages, intrigue et contexte. |
| Prologue | Introduction présentant le sujet avant l’action principale. |
| Intrigue | Suite d’événements qui font avancer l’histoire. |
| Péripétie | Événement imprévu qui modifie la situation des personnages. |
| Dénouement | Résolution finale de l’intrigue, apportant une conclusion. |
Définition dramaturge
Tu connais sans doute déjà ce terme, mais un petit rappel ne fait jamais de mal. Le dramaturge est l’auteur d’une pièce de théâtre. François Mauriac (l’auteur du célèbre roman Thérèse Desqueyroux) disait justement : « Ce qui distingue un romancier, un dramaturge, du reste des hommes, c’est justement le don de voir de grands arcanes dans les aventures les plus communes. »
Définition acte
Au théâtre, l’acte est un grand découpage de la pièce. Un acte se décompose lui-même en scène. C’est pour cette raison que, dans une pièce de théâtre, tu peux lire en haut des pages « Acte I, scène 3 » par exemple. Ce découpage permet au lecteur de se retrouver dans l’ensemble de la pièce.
Définition scène
Comme nous venons de le voir, les pièces de théâtre sont découpées selon une logique : les actes et les scènes. Les scènes sont le découpage qui intervient à l’intérieur des actes. Tu peux alors comparer cette organisation à celle d’un roman composé de parties et de chapitres.
Homonymie oblige, la scène est également le lieu où se déroule la pièce de théâtre, mais ça, je pense que je n’ai pas besoin de te le rappeler !
Définition hors scène
Comme son nom l’indique, il s’agit du lieu où se déroule tout ce qui n’est pas visible par le spectateur lors de la représentation théâtrale. On inclut également dans le hors scène les paroles prononcées par un personnage qu’on ne voit pas.
Définition règle des trois unités
Très connue dans le milieu du théâtre, cette règle est imposée par le théâtre classique et elle concerne l’unité de lieu (la pièce doit avoir lieu dans un seul et même espace), l’unité de temps (en 24 heures seulement) et l’unité d’action (une seule action peut avoir lieu), ainsi que la vraisemblance de la pièce. Nicolas Boileau disait : « Qu’en un lieu, en un jour, un seul fait accompli tienne jusqu’à la fin le théâtre rempli. »
Définition vraisemblance
Dans les pièces de théâtre classique, la règle de vraisemblance a toute son importance. Elle oblige les auteurs à ce que leur pièce soit ressemblante à la réalité et donne aux spectateurs une impression de vérité. Le but est que les spectateurs se sentent concernés par la pièce de théâtre, car ils peuvent s’identifier à ce qu’ils voient. Il faut donc faire preuve de crédibilité dans l’histoire racontée. C’est l’une des règles du théâtre classique.
Définition bienséance
La bienséance correspond aux règles morales et éthiques que le dramaturge doit respecter selon le théâtre classique, par exemple : pas de sang sur scène, pas de mort sur scène, pas de scène de nudité, etc. La bienséance est présente pour ne pas heurter la sensibilité du public et maintenir les bonnes mœurs sur scène.
Définition chœur
Le chœur est un groupe de personnes qui intervient dans la pièce sous la forme de chant ou de danse à l’unisson (d’où l’expression « chanter en chœur ». Il vient animer le discours des personnages. Le chœur est généralement composé de 10 à 15 personnes. Il n’est pas obligatoire dans une pièce de théâtre.
Définition confident
Dans le théâtre tragique, le confident est le personnage à qui se confient les autres personnages. Il a bien généralement un rôle clé dans le dénouement de la tragédie. Par exemple, dans la tragédie de Jean Racine, Andromaque, le personnage de Pylade est à la fois le confident et l’ami d’Oreste, tandis que Céphise est le confident d’Andromaque. Même chose dans la tragédie Phèdre du même auteur, le personnage principal Phèdre se confie à Œnone.
Définition didascalie
La didascalie est une indication ou instruction scénique qui est insérée dans le corps du texte en italique et/ou entre parenthèses.
Comprendre l’importance des didascalies
Par exemple : elle éclate en sanglots • elle détourne son visage. Ces indications, appelées didascalies, sont précieuses pour les acteurs et le metteur en scène.
- Elles révèlent les intentions de l’auteur : attitude, ton de la voix, comportement ou tenue du personnage.
- Elles aident à mieux incarner et comprendre un rôle.
💡 Les didascalies ne sont pas lues à voix haute, mais elles guident fortement la mise en scène et l’interprétation.
Définition monologue
Le monologue est un moment de la pièce de théâtre dans lequel le personnage, seul sur scène, se parle à lui-même. Le monologue révèle généralement les sentiments du personnage, qui n’a pas peur d’être surpris par un autre. On peut citer par exemple le monologue d’Arnolphe dans L’École des femmes de Molière (acte IV, scène 1) : « J’ai peine, je l’avoue, à demeurer en place». La pièce le Cid de Corneille comporte également plusieurs monologues du personnage Don Diègue :
- Acte I, scène 4 : « Ô rage ! Ô désespoir ! Ô vieillesse ennemie ! » ;
- Acte I, scène 6 : « Percé jusques au fond du cœur ».
Définition tirade
La tirade est une longue réplique qui ressemble à un monologue, à la seule différence qu’elle n’est pas prononcée par un personnage seul sur la scène. Parmi les tirades les plus connues et reconnues du théâtre classique, on compte la tirade de Phèdre dans la pièce du même nom Racine. Elle déclare alors son amour à Hippolyte ( « Oui, prince, je languis, je brûle pour Thésée (…) », acte II, scène 5). Dans un registre plus comique, on retrouve la tirade du nez de Cyrano de Bergerac dans la pièce éponyme d’Edmond Rostand : « Ah ! non ! C’est un peu court, jeune homme ! » (acte I, scène 4).
Définition stichomythie
La stichomythie se traduit par un échange de répliques courtes et sèches entre des personnages. La stichomythie marque une accélération dans le dialogue. Elle sert aussi à mettre en avant des sentiments intenses chez les personnages. Elle est souvent utilisée lors de scènes de badinages amoureux. Elle fait ressortir l’escalade des émotions fortes telles que la violence ou la passion lors de scènes de mise sous tension. Tu peux retrouver des exemples de stichomythie à acte I, scène 3 du Cid de Corneille ou bien dans l’École des femmes de Molière, acte II, scène 1.
Définition réplique
Tu connais sans doute déjà ce terme, les répliques sont les paroles prononcées par un personnage sur scène, lors d’un monologue ou d’un dialogue.
Définition aparté
L’aparté est un mot ou une réplique prononcés à part du dialogue par un personnage qui n’est entendu que par les spectateurs. Lors de l’aparté, le personnage en question révèle bien souvent des informations au public quant à ses sentiments, ses ressentis et ses intentions sans filtre (puisque les autres personnages ne sont pas censés l’entendre). L’aparté peut également avoir un effet comique. C’est souvent le cas dans les pièces de Molière par exemple.
Définition soliloque
Là, les choses se corsent… Le soliloque est un discours prononcé par un personnage qui ne cesse de parler, même lorsque les autres personnages sont présents. Il existe aujourd’hui le verbe « soliloquer » qui veut ainsi dire : se parler à soi-même. Il s’agit donc d’un cas particulier de monologue. Tu peux le reconnaître facilement, notamment dans les comédies, car il est introduit par des didascalies qui indiquent « à lui-même » /« à elle-même ».
Définition quiproquo
Tu connais déjà ce terme, il s’agit d’un malentendu au théâtre. Le quiproquomène généralement à des scènes comiques ou encore tragiques. Un personnage est par exemple pris pour un autre, les intentions des personnages ne sont pas les bonnes, etc. Molière met en scène un parfait exemple de quiproquo comique dans L’Avare, acte V, scène 3. Alors que le personnage de Valère est amoureux d’Élise, la fille d’Harpagon, Harpagon, lui, est obnubilé par la cassette qui renferme son argent. Il s’agit d’un véritable dialogue de sourds.
Définition grotesque
Le grotesque est un type de comique qui se caractérise par la caricature et la déformation de la réalité.
Définition burlesque
Tout comme le grotesque, le burlesque est un type de comique qui, cette fois-ci, ne respecte pas l’adéquation de la classe sociale et des manières du personnage et inverse ce rapport. Des personnages de la haute société qui agissent avec bassesse et inversement par exemple. On peut aussi appeler cette caractéristique « carnavalesque ».
Définition satire
La satire est une œuvre qui ridiculise et se moque des mœurs d’une personne ou d’un groupe. Elle est bien souvent en vers. Le Malade imaginaire de Molière est un exemple de satire au théâtre.
Définition saynète
La saynète (eh oui, c’est bien la bonne orthographe !) est une petite pièce comique avec peu de personnages. Si tu trouves le mot orthographié de la manière suivante : « scènette », c’est qu’il s’agit d’une erreur, malheureusement fort répandue. Adam et Eve de David-Olivier Defarges est un exemple de saynète.
Définition scène d’exposition
La scène d’exposition est une scène introductive de l’œuvre théâtrale, dans laquelle apparaissent les clés de compréhension de celle-ci (les personnages principaux ou protagonistes, l’espace, le temps, l’intrigue, etc.).
Définition prologue
Dans les œuvres antiques, le prologue est la présentation du sujet avant l’intervention du chœur (dont nous avons parlé un peu plus tôt). Parmi les prologues célèbres, on peut notamment citer celui de la comédie Amphitryon de Molière qui est essentiel pour que les spectateurs puissent reconnaître les personnages.
Définition intrigue
L’intrigue désigne les événements qui constituent la plus grosse partie de la pièce (le déroulement) et qui font avancer grâce à plusieurs rebondissements.
Définition péripétie
La péripétie est un changement de situation subi par un ou plusieurs personnages. Les péripéties permettent de faire avancer l’intrigue jusqu’au dénouement (ci-dessous).
Définition dénouement
Le dénouement désigne la résolution des nœuds de l’intrigue, souvent à la fin de la pièce. Il s’agit souvent de la scène finale d’une pièce de théâtre, qui apporte la solution au problème rencontré jusqu’alors par les personnages.
Nos conseils pour réussir un commentaire composé de théâtre
Tu n’es pas encore très à l’aise avec cet exercice ? Nous te prodiguons nos meilleurs conseils.
Réussir l’analyse d’un extrait de théâtre : le plan d’action
- Comprendre le contexte de la pièce : auteur, éventuel engagement, mouvement littéraire, contexte historique. Ces données « métatextuelles » posent le cadre et éclairent le sens.
- Lire l’extrait plusieurs fois : une première lecture globale pour saisir l’idée directrice, puis des lectures attentives pour repérer dialogues, répliques, didascalies et détails significatifs.
- Situer l’extrait dans l’œuvre : début, milieu, fin ? Après quel événement ? Cette localisation aide à comprendre les enjeux de la scène.
- Identifier les éléments dramatiques : personnages, actions, conflits, enjeux, progression de l’intrigue. C’est la base de ton analyse.
- Analyser le langage théâtral : observe répliques, apartés, monologues, didascalies et leurs effets (rythme, tension, comique, pathétique…). Rien n’est écrit « par hasard ».
- Repérer les références culturelles : mythes, allusions historiques, codes du genre. Elles peuvent transformer une lecture correcte en analyse vraiment pertinente.
💡 Astuce : articule toujours tes observations au sens de la scène et au projet de l’auteur ; chaque procédé doit servir une idée.
Les 5 erreurs à éviter dans un commentaire composé de théâtre
Erreurs à éviter dans un commentaire de texte théâtral
- Ignorer le registre théâtral : ne commente pas une pièce comme un roman. Utilise le vocabulaire spécifique (aparté, monologue, tirade, didascalies…), les types de comique et les figures de style propres au théâtre.
- Oublier la méthodologie : le commentaire suit un plan précis (introduction, développement structuré, conclusion). Ne te contente pas d’écrire sans méthode.
- Paraphraser le texte : ne répète pas le passage mot à mot. Sélectionne des citations pertinentes pour appuyer ton analyse, sans recopier l’extrait.
- Négliger la structure : ton analyse doit être organisée avec des parties et sous-parties clairement identifiées. Cela aide le correcteur à suivre ton raisonnement.
- Ne pas aérer ta copie : saute des lignes entre les grandes parties et les sous-parties. Une présentation claire et soignée facilite la lecture et peut valoriser ton travail.
💡 Astuce : saute deux lignes entre chaque grande partie et une ligne entre chaque sous-partie pour rendre ta copie lisible et agréable à corriger.
Commenter un texte de théâtre : sujets commentaires de texte théâtre corrigés
Pour que tu y voies un peu plus clair, nous avons listé ci-dessous plusieurs exemples d’analyses de commentaire d’extrait de textes de théâtre :
- En attendant Godot, Samuel Beckett (scène dernière du second acte).
- Bérénice, Racine (scène dernière de l’acte V).
- Les Fourberies de Scapin, Molière (acte III, scène 2).
- Les Mains sales, Jean-Paul Sartre (5e tableau).
- Dom Juan, Molière (acte I, scène 3).
- Les Fausses confidences, Marivaux, (acte II, scène 2).
La liste des œuvres au programme du bac de français 2026
| Objet d’étude | Œuvre au programme | Parcours associé |
|---|---|---|
| Littérature d’idées (XVIe – XVIIIe siècle) |
Étienne de La Boétie – Discours de la servitude volontaire | « Défendre » et « entretenir » la liberté |
| Bernard de Fontenelle – Entretiens sur la pluralité des mondes | Le goût de la science | |
| Françoise de Graffigny – Lettres d’une Péruvienne (éd. augmentée 1752) | Un nouvel univers s’est offert à mes yeux | |
| Théâtre (XVIIe – XXIe siècle) |
Pierre Corneille – Le Menteur | Mensonge et comédie |
| Alfred de Musset – On ne badine pas avec l’amour | Les jeux du cœur et de la parole | |
| Nathalie Sarraute – Pour un oui ou pour un non | Théâtre et dispute | |
| Poésie (XIXe – XXIe siècle) |
Arthur Rimbaud – Cahier de Douai (22 poèmes) | Émancipations créatrices |
| Francis Ponge – La rage de l’expression | Dans l’atelier du poète | |
| Hélène Dorion – Mes forêts | La poésie, la nature, l’intime | |
| Roman et récit (Moyen Âge – XXIe siècle) |
Abbé Prévost – Manon Lescaut | Personnages en marge, plaisirs du romanesque |
| Honoré de Balzac – La Peau de chagrin | Les romans de l’énergie : création et destruction | |
| Colette – Sido suivi de Les Vrilles de la vigne | La célébration du monde |
Un exercice pour tester tes connaissances sur le vocabulaire de théâtre
Exercice – Quiz théâtre (bac de français)
Testez vos connaissances sur le vocabulaire et les règles du théâtre classique.
Question 1
Comment appelle-t-on l’auteur d’une pièce de théâtre ?
- A) Un metteur en scène
- B) Un dramaturge
- C) Un scénariste
- D) Un auteur dramatique
Question 2
Que signifie « acte » au théâtre ?
- A) Une division d’un roman
- B) Un ensemble de scènes formant une partie de la pièce
- C) Une longue réplique d’un personnage
- D) Un élément du décor
Question 3
Qu’est-ce que le « hors scène » ?
- A) Un espace destiné aux spectateurs
- B) La partie de la scène réservée aux acteurs principaux
- C) Tout ce qui se passe en dehors de ce que le spectateur peut voir
- D) Une méthode de jeu d’acteur
Question 4
Quelle est l’une des règles des trois unités du théâtre classique ?
- A) La pièce doit être jouée par trois personnages minimum
- B) L’action doit se dérouler en moins d’une heure
- C) L’histoire doit se limiter à un seul lieu, en 24 heures, et à une seule intrigue
- D) Les décors doivent rester identiques tout au long de la pièce
Question 5
À quoi sert la vraisemblance dans le théâtre classique ?
- A) À rendre l’histoire poétique
- B) À donner l’illusion de réalité et à impliquer les spectateurs
- C) À introduire des éléments surnaturels
- D) À ajouter de l’humour dans la pièce
La correction de l’exercice sur le vocabulaire de théâtre
- b) Un dramaturge
- b) Un ensemble de scènes formant une partie de la pièce
- c) Tout ce qui se passe en dehors de ce que le spectateur peut voir
- c) L’histoire doit se limiter à un seul lieu, en 24 heures, et à une seule intrigue
- b) À donner l’illusion de réalité et à impliquer les spectateurs
Qu’attend-on d’un commentaire de texte théâtral au bac ?
Il faut analyser un extrait dramatique en montrant comment les choix textuels (dialogues, didascalies, registres, structure) produisent des effets sur le spectateur. Le but est de révéler la richesse du texte tout en respectant sa logique dramaturgique. :contentReference[oaicite:0]{index=0}
Faut-il absolument inclure les didascalies dans l’analyse ?
Oui, les didascalies sont essentielles : elles indiquent les gestes, attitudes, mouvements et tons que l’auteur souhaite donner. Elles éclairent l’interprétation du texte dramatique et ne doivent pas être négligées. :contentReference[oaicite:1]{index=1}
Comment structurer un commentaire de texte de théâtre ?
Il faut une introduction (contexte, problématique, plan), un développement en deux ou trois axes clairs avec des sous-parties, et une conclusion qui répond à la problématique et propose une ouverture. Cette structure aide le lecteur à suivre ton raisonnement. :contentReference[oaicite:2]{index=2}
Quelles sont les erreurs les plus fréquentes à éviter ?
Parmi les erreurs fréquentes : une lecture trop superficielle du texte, une paraphrase excessive plutôt que de l’analyse, un commentaire sans structure claire, ou encore le fait de ne pas lier les procédés au sens. :contentReference[oaicite:3]{index=3}
Comment identifier le bon sujet / la bonne problématique dans un extrait de théâtre ?
On observe ce qui rend l’extrait particulier (genre dramatique, conflit, effet surprenant), on se demande pourquoi il a été choisi, puis on formule une question ouverte englobant l’ensemble du texte étudié. La problématique ne doit pas être trop étroite. :contentReference[oaicite:4]{index=4}