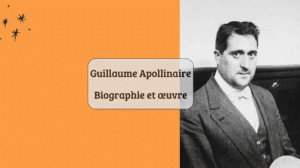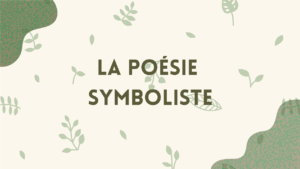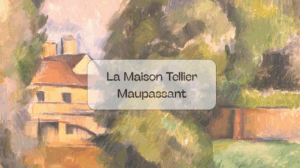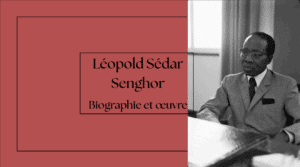Bac français 2024. Qui dit année de première, dit également… bac de français. Cette année encore, Le Malade imaginaire est au programme des œuvres sur lesquelles tu pourrais être interrogé(e). Pour que tu sois fin prêt(e) le jour de l’examen, nous te proposons un résumé et une analyse de cette pièce emblématique de Molière, le plus célèbre des dramaturges français !
Qui était Molière ?
Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière, est né en 1622 à Paris et mort en 1673. Auteur, metteur en scène et acteur, il est issu d’une famille bourgeoise et reçoit une éducation solide en humanités.
Dès 1643, il crée et mène sa propre troupe de Théâtre, l’Illustre Théâtre, mais il rencontre de nombreuses difficultés et interdictions, malgré le soutien du roi Louis XIV. Après douze ans à parcourir le sud de la France avec sa troupe, il rentre à Paris et redonne à la comédie une vitalité nouvelle. C’est en 1658, lorsqu’il intègre la troupe du roi qu’il connaît le succès devant le public parisien et bénéficie de la protection royale.
À travers des spectacles de pur divertissement ou des œuvres polémiques, il représente et dénonce les défauts des hommes et des mœurs de son temps par le rire. Molière est surtout connu pour ses comédies satiriques; véritables critiques de son temps. Notons par exemple les pièces Tartuffe ou L’Avare qui mettent en lumière l’hypocrisie, la vanité ou plus généralement les vices et travers de la société.
Tradition des farces populaires, héritées du Moyen-Âge (voir La farce de maître Patelin) avec Les Fourberies de Scapin (1671), de la comédie-ballet avec Le Bourgeois gentilhomme (1670), la comédie d’intrigue, de mœurs et de caractères avec Le Misanthrope (1666), peinture satirique de la société de caractères à travers des pièces plus graves telles que Tartuffe (1664) ou Dom Juan (1665), toutes ses pièces composent un répertoire qui ignore la contrainte des règles formelles.
Ces critiques sociales et religieuses lui ont valu certaines controverses ou oppositions. L’Église jugeait notamment ses pièces scandaleuses qui ont pour certaines été censurées. Molière meurt finalement sur scène, à l’âge de 51 ans, alors qu’il joue sa pièce du Malade Imaginaire.
Homme de théâtre de génie, ses comédies satiriques audacieuses ont grandement contribué au développement du théâtre en France, et son œuvre continue d’être largement étudiée et appréciée.
Lire aussi : Bac français 2024 : les œuvres au programme
Le Malade imaginaire : contexte
Jouée pour la première fois en 1673, Le Malade imaginaire est une pièce comique, qui est à l’origine une comédie-ballet dont la musique est composée par Marc-Antoine Charpentier. Seulement, c’est dans la vie de Molière lui-même que l’on trouve les prémices de l’écriture de cette pièce. En effet, la santé de Molière est altérée depuis près de dix ans à cette époque. Les raisons en sont multiples ; d’ordre psychologique d’abord, en raison du surmenage, la mort de son premier fils à l’âge de onze mois, mais aussi d’ordre physiologique en raison d’une faiblesse pulmonaire et d’une tuberculose. Molière s’est donc inspiré directement de ses expériences personnelles pour satiriser les pratiques médicales de l’époque et leur ironie. Il se moque aussi des croyances et potentiels remèdes qui étaient en vigueur. Qu’il ait songé à jouer les médecins qui ne l’ont pas guéri, quoi de plus logique !
La pièce de Molière a connu un franc succès immédiatement et la pièce a été publiée peu après la mort de l’auteur par sa femme.
Le fait que Molière soit mort directement sur scène en jouant le personnage d’Argan a clairement ajouté une note tragique à la pièce. Cela a sûrement contribué à son succès, ou du moins au fait qu’elle ait été largement diffusée et reprise.
Lire aussi : Bac français 2023 : comment se présentent les épreuves écrites et orales ?
Les personnages du Malade Imaginaire
Avant de rentrer dans le vif du sujet et de nous plonger dans le résumé de l’œuvre, nous te proposons ci-dessous une liste de chacun des personnages et de leur rôle dans Le Malade imaginaire :
- Argan : le personnage principal, un homme hypocondriaque et avare qui se croit gravement malade.
- Béline : la seconde épouse d’Argan, qui cherche à le manipuler pour obtenir sa fortune. Elle est souvent en conflit avec Angélique.
- Angélique : la fille d’Argan, amoureuse de Cléante mais contrainte d’épouser Thomas Diafoirus par son père.
- Béralde : le frère d’Argan, qui est l’un des seuls personnages à ne pas se laisser berner par les faux médecins.
- Toinette : la servante d’Argan, qui est débrouillarde et intelligente. Elle cherche souvent à déjouer les plans de Béline et des faux médecins.
- Monsieur Diafoirus : un médecin prétentieux et pédant, père de Thomas Diafoirus et prétendant à la main d’Angélique.
- Monsieur Fleurant : l’apothicaire qui fournit des remèdes à Argan, souvent inutiles ou dangereux.
- Monsieur Purgon : un autre médecin qui travaille pour Argan et qui est également prétentieux.
- Thomas Diafoirus : le fils de Monsieur Diafoirus, un jeune homme maladroit et ennuyeux qui courtise Angélique.
- Louison : la servante de Toinette, qui est souvent témoin des plans et des intrigues de sa maîtresse.
Malade imaginaire : résumé
La pièce, en trois actes et en prose, tourne autour d’Argan, le « malade imaginaire », éponyme (personnage qui donne son nom à la pièce). Il est veuf et a épousé pour son second mariage Béline, qui fait semblant de lui procurer des soins attentionnés. En réalité, elle n’attend que la mort de son mari pour hériter de sa fortune. Il se fait faire des saignées et des purges (voir définition plus bas) et absorbe toutes sortes de remèdes, prescrits par des médecins pédants (arrogants) plus soucieux d’être agréables à leur patient que de participer à l’amélioration de sa santé. Pour les tromper, Toinette, sa servante, se déguise en médecin et lui dispense de nombreux conseils ironiques et moqueurs pour la profession.
Angélique, sa fille, aime Cléante, ce qui contrarie Argan, car il préférerait la voir épouser Thomas Diafoirus, lui-même médecin. Pour les tirer d’affaire, Toinette recommande à Argan de faire le mort. Sa femme, appelée par Toinette, manifeste, devant celui qu’elle croit mort, sa joie d’en être débarrassée. Angélique, appelée ensuite par Toinette, manifeste un chagrin sincère à la mort de son père, qui arrête aussitôt son jeu et accepte l’union avec Cléante, à la condition que celui-ci devienne médecin. Béralde, frère d’Argan, conseille à ce dernier de devenir médecin à son tour, menant à une fin burlesque de la pièce, à savoir la cérémonie bouffonne de l’intronisation du « malade imaginaire » comme médecin.
Argan, le personnage principal, se situe au carrefour de trois tendances opposées. La première représente l’hypocrisie et les intérêts personnels. Ces deux attitudes sont notamment incarnées par Béline et M. Bonnefoi. D’un autre côté, l’hypocrisie et les intérêts professionnels sont représentés par les Diafoirus, M. Purgon et M. Fleurant, tandis que la sincérité, l’affection, le bon sens et la bonté sont incarnés par Cléante, Angélique, Toinette, Béralde, et Louison.
Lire aussi : Alcools, Guillaume Apollinaire : analyse de l’œuvre
La comédie à l’époque de Molière
En premier lieu, pour t’aider à inscrire l’œuvre de Molière dans le parcours d’étude proposé, voici quelques éléments caractéristiques de ce genre. Le terme « comédie » vient du latin comedia, dérivé du grec komoï. Il désigne le cortège animé formé à l’occasion des fêtes organisées en l’honneur de Dionysos qui évolue vers des farces et des pantomimes pour aboutir à la comédie, dont la plus ancienne est due à Aristophane (Ve – IVe siècles avant J.-C.). La comédie présente des personnages ordinaires avec leurs travers et leur ridicule sur un ton léger.
Au XVIe siècle, en Italie, la commedia dell’arte revient aux types de personnages facilement identifiables (le valet, dont Arlequin est le grand représentant, l’amoureux, le vieillard) que les acteurs mettent en scène en improvisant à partir d’un simple canevas (points principaux d’un ouvrage, trame), la gestuelle étant primordiale. Molière s’inspire de ce modèle.
En France, au XVIIe siècle, période pendant laquelle Molière écrit ses textes, le classicisme codifie la comédie et l’impose en tant que genre. À noter que le théâtre grec est la source du théâtre européen auquel il transmet ses thèmes fondateurs et des principes formels.
La commedia dell’arte italienne
En savoir un peu plus sur la commedia dell’arte
La commedia dell’arte, qui signifie littéralement comédie de l’art en italien, est une forme de théâtre populaire qui est apparue en Italie au XVIe siècle. Elle se caractérise par l’utilisation de masques et de costumes extravagants, ainsi que par l’improvisation des acteurs. La commedia dell’arte divertit le public au travers de personnages caricaturaux, de pitreries et de satire sociale.
À chaque spectacle, c’est une troupe d’une quinzaine d’acteurs qui amusent les foules. Accompagnés de jongleurs, de magiciens et d’acrobates, ils font un tabac en Italie. La première pièce de commedia dell’arte est signée Angelo Beolco (alias Ruzzante), un écrivain et dramaturge italien du XVIè siècle. Sa pièce est justement connue pour mettre en scène Ruzzante, son personnage éponyme incarnant un paysan haut en couleur.
Les pièces de commedia dell’arte mettent souvent en scène des personnages stéréotypés tels que les amoureux, les serviteurs rusés, les vieux marchands, les docteurs charlatans et les soldats fanfarons. Les acteurs de commedia dell’arte étaient généralement des artistes ambulants qui se produisaient dans les rues ou les places publiques, mais ils ont également joué dans les cours royales et les théâtres professionnels. La commedia dell’arte a eu une grande influence sur le théâtre européen et a contribué au développement de la farce, de la pantomime et du bouffon.
Molière et la commedia dell’arte
Comme tu l’as compris, la commedia dell’arte est un registre théâtral à succès. Ces codes, ces comiques et l’originalité de sa mise en scène attirent les foules. En réalité, ce sont les comédiens, plus que l’histoire, qui marquent l’esprit des spectateurs et Molière décide très vite de s’en inspirer.
Pour la petite histoire, Molière a eu l’occasion de fréquenter ces acteurs « de rues » et analyser leurs jeux. En 1658, une célèbre troupe italienne de commedia dell’arte et la troupe de Molière se voient partager différentes salles de théâtre successives. Ils tissent des liens. Molière, constamment au contact des troupes italiennes, en profitait pour regarder ses confrères et décida d’incorporer quelques-uns de leurs codes dans ses propres pièces. Molière a notamment repris l’idée :
- Du caneva : La trame de l’intrigue, le synopsis général schématisant les grandes lignes du scénario
- Des lazzi : Le jeu d’acteur des comédiens (grossièretés, grimaces, farces, plaisanteries), les silences, le comique de mots, etc.
- Des tipi fissi : Les traits de caractères des personnages types, leurs rôles très codifiés, leurs mimiques
Lire aussi : Français : Les mouvements littéraires et leurs caractéristiques
Le comique dans Le Malade imaginaire
Petite étude d’onomastique
Pour commencer, l’onomastique, c’est-à-dire l’étude des noms propres, permet d’ores et déjà de déceler le comique. Ainsi, Purgon est clairement affilié au verbe « purger ». La purge est une pratique de la médecine traditionnelle basée sur l’utilisation de plantes médicinales (ou parfois aussi sur le jeûne) et dont le but est d’améliorer les processus de détoxication et d’évacuation de l’organisme. À l’époque, la pratique du lavement pour « évacuer » les « mauvaises humeurs » du sang était courante.
Dans cette perspective, le nom de « Diafoirus » évoque le mot dérivé du terme vulgaire « foirer », en mettant en avant la dimension de dérèglement, d’échec contenu dans le nom même du potentiel médecin, voué à rater toutes les pratiques médicales qu’il entreprend.
Plusieurs formes de comique
L’héritage de la farce est représenté dans cette pièce dans toute sa splendeur. En premier lieu, le comique de geste et le comique de mots tiennent une bonne place, comme on peut le voir au moment où Argan poursuit Toinette (acte I, scène 5), qui conduit à une véritable bataille d’oreillers. Par ailleurs, la servante se déguise en médecin, avant de déboucher vers la cérémonie, réelle mascarade. Dans le comique des mots, c’est évidemment le langage professionnel qui domine, celui des médecins.
En outre, un des éléments centraux de la comédie réside dans le comique de situation, et en particulier des quiproquos. On peut citer le moment où Cléante est pris par Argan pour un authentique maître de musique. Les rencontres inattendues, les oppositions cocasses de personnages abondent également.
Le spectacle au cœur de la pièce
On l’a dit, Le Malade imaginaire est à l’origine une comédie-ballet, qui mêle chant, danse et théâtre. Il s’agit d’une forme très appréciée de Louis XIV. C’est donc un spectacle sur tous les plans, car cette pièce allie stimulation visuelle et auditive en convoquant différentes formes d’arts pour la Cour.
Par ailleurs, on peut noter que cette œuvre est aussi une pièce dans la pièce. Cette mise en abîme se manifeste notamment par les apparitions de Toinette, la domestique, qui orchestre un certain nombre de situations. Ainsi, son intervention la plus notable est le moment où elle fait simuler la mort d’Argan pour permettre de démasquer le caractère vénal de sa femme Béline, et révéler la loyauté de sa fille Angélique.
Remarquons aussi l’attitude de Béralde : il joue un rôle d’organisateur de spectacles, comme s’il était lui-même metteur en scène, intermède. Pour cela, il introduit les danseurs auprès d’Argan lorsqu’il fait face à un épisode de colère en annonçant : « Je vous amène ici un divertissement que j’ai rencontré, qui dissipera votre chagrin. »
Plus largement, le procédé de mise en abyme (peut aussi s’écrire abîme), de théâtre dans le théâtre, permet de souligner les défauts de l’homme en accentuant le comique. Celui-ci permet de conférer davantage de légèreté, dédramatiser par le mécanisme « plaire et instruire ».
La satire dans Le Malade imaginaire
L’héritage de la farce est représenté dans cette pièce dans toute sa splendeur. En premier lieu, le comique de geste et le comique de mots tiennent une bonne place, comme on peut le voir au moment où Argan poursuit Toinette (acte I, scène 5), qui conduit à une véritable bataille d’oreillers. Par ailleurs, la servante se déguise en médecin, avant de déboucher vers la cérémonie, réelle mascarade. Dans le comique des mots, c’est évidemment le langage professionnel qui domine, celui des médecins. Un des éléments centraux de la comédie réside dans le comique de situation, et en particulier des quiproquos. On peut citer le moment où Cléante est pris par Argan pour un authentique maître de musique. Les rencontres inattendues, les oppositions cocasses de personnages abondent.
Une satire des médecins : castigat ridendo mores
La pièce se moque du bourgeois naïf hypocondriaque, qui est prêt à tout croire de son médecin. Ce dernier est l’équivalent d’un Dieu pour Argante, pour lequel on finit par avoir de la pitié. Le médecin est présenté comme une personne sadique, prenant plaisir à tourmenter Argante. C’est cette figure qui est véritablement condamnée, car elle profite de l’ignorance des patients. Dans le même temps, il est reproché aux médecins leur amateurisme, leur manque complet de connaissances médicales.
Dès lors, les médecins dictent leur conduite aux patients, se placent en maîtres incontestables. M. Purgon fait ici en sorte qu’Argan se sente coupable, qu’il ait l’impression d’avoir pêché en exploitant sa crédulité.
Par conséquent, on voit donc bien dans cette pièce l’importance de la notion de castigat ridendo mores théorisée par Horace. Cette formule signifie « corriger les mœurs par le rire ». Il s’agit pour Molière de dénoncer certaines attitudes en faisant rire, pour mieux interroger les specta
teurs et les lecteurs sur ces problèmes. L’idée essentielle derrière ce concept est que les vérités sont véhiculées par le rire ; celles-ci sont accessibles au plus grand nombre. En ce sens, la comédie fait rire, divertie, mais par le rire, elle cherche à critiquer.
Le mariage dans Le Malade imaginaire
Autre thème très important dans Le Malade imaginaire : le mariage. Dans la pièce, on compte quatre types de mariages possibles :
- Le mariage de raison : Angélique et Thomas Diafoirus ;
- Le mariage d’intérêt : Béline et Argan ;
- Le mariage avec Dieu : la menace du couvent ;
- Le mariage d’amour : Angélique et Cléante.
Molière met en lumière les différents mariages envisageables et, conscient de l’injustice dont sont victimes les femmes, défend une conception du mariage dans lequel les femmes sont entendues, leur avis est pris en compte.
Encore une fois, le dramaturge se moque de ce qui existe dans la société et tourne en ridicule ses personnages et les raisons qui les poussent à se marier.
Lire aussi : Les Fausses Confidences, Marivaux : résumé et analyse de l’œuvre
Analyse de la scène 5 de l’acte II du Malade imaginaire
Le passage s’articule autour du lavement d’Argan (le lavement est une procédure lors de laquelle un liquide, ou parfois un gaz, est injecté dans le rectum par l’anus soit pour administrer un médicament, soit pour évacuer le contenu du côlon). On y voit l’utilisation du champ lexical de la scatologie, terme qui désigne des écrits ou des propos se rapportant aux excréments. Tout tourne autour de la colique, de la diarrhée, du vomi (« âcreté de votre bile »). Ces détails sont triviaux et sont inconvenants. Ils s’opposent à la bienséance qui est de mise pour ces sujets intimes et vulgaires. Cette forme de comique est empruntée à la farce du Moyen-Âge, comme dans Gargantua de Rabelais.
Tout d’abord, on note le comique de situation mené par la relation entre Argan et Monsieur Purgon, qui suscite inéluctablement le rire. Cette relation repose sur la hiérarchie entre ces deux personnages, qui se matérialise par la prise de parole plus imposante du côté de M. Purgon : Argan n’arrive pas à s’imposer dans la discussion.
De plus, M. Purgon emploie des hyperboles pour exagérer la situation d’Argan afin de lui faire peur. Il gronde son patient et le menace de l’abandonner à sa « mauvaise constitution ». Son objectif n’est pas vraiment qu’il soit guéri. Il profite de sa faiblesse et sa naïveté pour lui faire peur et s’enrichir avec le médecin. De l’autre côté, Argan a peur de ne plus avoir de médecin ; il s’excuse et accuse son frère. Cette scène met en avant la figure du bourgeois naïf qui suit aveuglément les directives et les ordres des personnes qu’ils engagent. Ces dernières sont pour eux des spécialistes qu’il n’est pas bon de contredire, ce qui conduit à des situations d’abus de pouvoir.
Dans cet extrait figure le comique de caractère : Toinette est une domestique plus avisée que son maître et qui s’en moque ouvertement. M. Purgon quant à lui est excessif et donc ridicule. Argan est ridicule également, car il a peur, il est soumis au médecin et accepte qu’on s’adresse à lui de manière irrespectueuse.
Enfin, le rythme du dialogue est rapide, comme le montrent les répliques courtes et rapides : les stichomythies. Ce sont des échanges verbaux rapides, vifs, en paroles ou en vers, généralement, qui marquent une accélération dans le dialogue. Argan ne parvient pas à terminer ses phrases. Notons que la servante Toinette fait de brèves interventions ironiques.
Pour conclure, si Le Malade imaginaire est la synthèse des opinions de Molière sur les médecins, la médecine et la faiblesse humaine, elle est aussi une anthologie, la plus complète et peut-être la plus parfaite de l’art comique de Molière.
Quelques citations à retenir du Malade imaginaire
Pour finir sur Le Malade imaginaire, nous t’avons concocté un petit florilège de citations à retenir pour les intégrer dans tes dissertations. C’est un excellent moyen d’illustrer ta compréhension de l’œuvre et de justifier et expliciter les points que tu veux développer dans tes argumentations :
- « Presque tous les hommes meurent de leurs remèdes, et non pas de leurs maladies. » Acte III, scène 3.
- « Ce ne sont point les médecins qu’il joue, mais le ridicule de la médecine. » Acte III, scène 3.
- « Je ne vois rien de plus ridicule, qu’un homme qui veut se mêler d’en guérir un autre » Acte III, scène 3.
- « Il en est comme de ces beaux songes qui ne vous laissent au réveil que le déplaisir de les avoir crus. » Acte III, scène 3.
Lire aussi : Français : les citations incontournables pour le bac français
Tu souhaiterais découvrir plus de pièces de Molière ?
Tu as apprécié la lecture du Malade imaginaire et tu souhaites continuer à découvrir les pièces de Molière et cerner le travail d’écriture du plus célèbre des dramaturges français ?
Tu peux bien entendu lire d’autres pièces de Molière. Cela te permettra non seulement de mieux comprendre et d’assimiler l’ensemble des propos avancés dans cet article, mais surtout, t’apportera des connaissances littéraires supplémentaires bénéfiques au moment de passer ton bac de français !
La rédaction d’Au Futur te conseille notamment :
- Les précieuses ridicules (1659)
- L’école des Femmes (1662)
- Les Fourberies de Scapin (1671)
- Dom Juan (1965)
Des classiques de la littérature qui te seront forcément utiles à un moment de ta scolarité.
Les œuvres au programme du bac de français 2024
Pour terminer cet article, laisse-nous te rafraîchir la mémoire sur les œuvres au programme du bac de français 2024. Cette année, comme les années précédentes, 12 œuvres seront étudiées :
- Les Fausses confidences, Marivaux ;
- Le Malade imaginaire, Molière ;
- Juste la fin du monde, Lagarce ;
- Gargantua, Rabelais ;
- Les Caractères, La Bruyère ;
- La déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, Gouges ;
- Manon Lescaut, Abbé Prévost ;
- La Peau de chagrin, Balzac ;
- Sido suivi des Vrilles de la vigne, Colette ;
- Mes forêts, Dorion ;
- La Rage de l’expression, Ponge ;
- Cahier de Douai, Rimbaud.
Bonne nouvelle pour toi, nous te proposons une fiche de lecture pour chacune des œuvres que nous venons de citer. De quoi te permettre d’avancer bien vite dans tes révisions. Alors, n’attends plus et consulte sans plus tarder notre site internet.