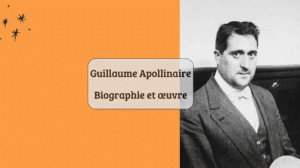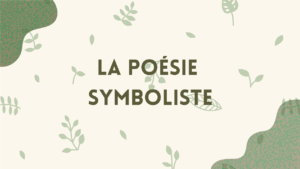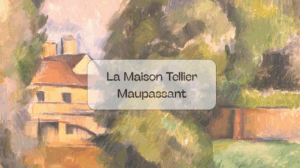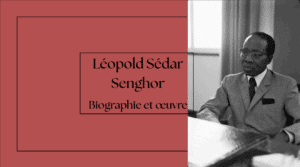Tu dois étudier Les Caractères de La Bruyère et tu cherches un résumé clair et une analyse des thèmes essentiels ? Tu es au bon endroit !
Publié en 1688, ce recueil fait partie des grandes œuvres de la littérature classique et propose une critique mordante de la société sous Louis XIV. À travers des portraits incisifs et des maximes pleines d’ironie, Jean de La Bruyère dépeint avec finesse les travers des courtisans, des nobles et du peuple.
👉 Mais pourquoi Les Caractères sont-ils toujours étudiés aujourd’hui ? Quels sont les thèmes majeurs de cette œuvre et comment analyser les portraits et maximes qui la composent ?
Prêt(e) à mieux comprendre Les Caractères et à briller en cours de français ? C’est parti ! 🎯
Jean de La Bruyère : biographie et influences sur Les Caractères
Le parcours d’un écrivain moraliste
Jean de La Bruyère était un écrivain et moraliste (auteur de réflexions sur les mœurs, la nature et la condition humaines) français né en 1645 et mort en 1696. Il fut l’instructeur du duc de Bourbon, le petit-fils du prince.
Issu d’une famille bourgeoise et janséniste (éducation religieuse très stricte), il fait ses humanités (faire des études de lettres, de grec et de latin) et obtient une licence de droit.
Ses inspirations et son regard critique sur la société
En 1684, grâce à Bossuet, un célèbre évêque, il est chargé d’instruire le duc de Bourbon en devenant son précepteur (personne chargée de l’éducation, de l’instruction d’un enfant de famille noble et/ou riche à domicile). Il s’agit d’un poste prestigieux qui lui permettra de recueillir des informations précieuses sur ce milieu. La Bruyère connaît alors une remarquable ascension sociale qui lui permet d’accéder aux hautes sphères de la société aristocratique française, et d’y obtenir une avantageuse protection. Après trois ans, il devient le bibliothécaire des Condé après que son activité de précepteur s’est achevée. Il est élu en 1693 à l’Académie française (grâce notamment au soutien des Condé et à celui des Anciens -voir contexte plus bas-), consécration de son œuvre.
Il commence à écrire Les Caractères en 1670, ouvrage qui sera publié pour la première fois en 1688. Ce dernier a fait l’objet de nombreuses corrections au fil de l’eau. Son contenu a été remanié, réorganisé, voire augmenté à plusieurs reprises également. Il s’agit en quelque sorte d’une réécriture, ou plutôt d’une poursuite des Caractères de Théophraste (auteur grec du IVe siècle avant J.-C.), qui appartient au genre de l’éthopée qui consiste à peindre des personnages ou des assemblées de personnages en peignant aussi leurs mœurs et leurs passions.
Le contexte historique et littéraire des Caractères : la France sous Louis XIV
La période pendant laquelle La Bruyère débute l’écriture des Caractères est marquée par l’affrontement entre les « Anciens » et les « Modernes ». Il s’agit d’une querelle dans laquelle s’opposent les défenseurs des codes artistiques et littéraires hérités de l’Antiquité, tandis que le second groupe met en avant la nécessité de s’affranchir de ce qui est considéré comme des contraintes.
Ainsi, on peut dire (sans mauvais jeu de mots) que la littérature change de caractère. De nouveaux sujets et enjeux émergent. Parmi eux, la religion, qui se voit de plus en plus attaquée. Les institutions politiques sont également vivement critiquées. Tout cela est permis par l’affaiblissement du pouvoir royal. La Bruyère apparaît en ce sens comme un précurseur des « philosophes » du XVIIIe siècle, même s’il prend parti pour les « Anciens ». En effet, il se réclame de l’héritage antique qu’il admire et dont il encourage l’imitation.
L’œuvre de La Bruyère reste un des témoignages les plus complets sur la société française et le déclin de Louis XIV. Le succès de cette œuvre est dû en particulier à la pensée libérale (courant de pensée qui prône la défense des droits individuels, au nom d’une vision fondée sur l’individu et la coopération volontaire entre les humains ; le système libéral repose donc sur la responsabilité individuelle) qui s’immisce progressivement.
L’œuvre d’une vie pour La Bruyère
La Bruyère a travaillé pendant dix-sept ans avant de publier ce recueil constitué de 420 remarques au total. Celles-ci sont présentées sous forme de maximes (dont nous te donnons une définition plus loin dans cet article), de réflexions et de portraits. Ce recueil, à l’instar des Fables de La Fontaine qui s’inspire de la tradition grecque, est présenté comme une simple continuation des Caractères du philosophe grec Théophraste, qu’il traduit en tête de l’ouvrage. La Bruyère aurait commencé la rédaction de cet ouvrage dès 1670. Néanmoins, ce dernier est mort en 1696 après l’avoir revu et corrigé pour une neuvième et dernière édition, posthume. Les Caractères ou les Mœurs de ce siècle sont ainsi passés de 420 remarques en 1688 à 1120 en 1694 ; il s’agit donc d’une œuvre qui a été rédigée durant toute une vie, mais également la seule œuvre que La Bruyère ait publiée.
Qui sont les personnages-types des Caractères de La Bruyère ?
L’œuvre de La Bruyère est assez particulière et ne comprend pas de personnages en bonne et due forme. L’auteur se contente de dépeindre des portraits qui lui permettent ensuite de parler de son époque et d’évoquer les problématiques du genre humain. Il s’agit là d’un essai et les figures évoquées par La Bruyère sont tirées de l’Antiquité, de comédies antiques ou bien même classiques.
- « De la Cour » : un courtisan dévoué aux jeux de pouvoir et à l’art de la flatterie.
- « Du mérite » : un homme de talent qui se sent sous-estimé et mal récompensé pour ses réalisations.
- « Des grands » : un aristocrate hautain et vaniteux qui s’attache plus à son rang qu’à ses mérites personnels.
- « Des courtisans » : un groupe de flatteurs qui cherchent à plaire au roi et à obtenir sa faveur.
- « Des femmes » : une étude de la nature féminine, avec une critique de l’hypocrisie et de la vanité des femmes.
- « Des sots » : des personnages qui sont incultes et stupides, mais qui sont souvent confiants et pleins d’eux-mêmes.
- « Des précieuses » : un groupe de femmes qui se vantent d’une culture raffinée et d’un langage affecté.
- « Des philosophes » : une critique des intellectuels qui parlent davantage que d’agir, et qui préfèrent la théorie à la pratique.
- « Des ouvrages de l’esprit » : une réflexion sur la littérature et les arts, avec une insistance sur la nécessité de l’originalité.
- « Des jugements » : une étude de la nature humaine et de la manière dont les gens jugent les autres.
Ce que tu dois retenir : les portraits dépeints par La Bruyère ne sont pas (ou très peu) décrits physiquement. L’auteur s’efforce simplement de présenter leurs mœurs et leurs comportements.
Résumé détaillé des Caractères de La Bruyère, livre par livre
Cette œuvre appartient au classicisme. Ce mouvement esthétique et artistique se développe en France, et plus largement en Europe, de 1660 à 1725. Il se définit par un ensemble de valeurs et de critères qui dessinent un idéal s’incarnant dans l’ « honnête homme » et qui développent une esthétique fondée sur une recherche de la perfection, son maître mot est la raison. 420 remarques sont faites sous forme de maximes, que l’on peut définir comme une formule exprimant une idée générale, une règle de conduite ou une règle morale.
Dans sa globalité, il s’agit d’un recueil de maximes et de portraits satiriques publié en 1688. Encore aujourd’hui, Les Caractères de La Bruyère est perçu comme l’un des plus grands chefs-d’œuvre de la littérature française classique. Tout au long de ses écrits, l’auteur analyse et critique les différentes facettes de la société du XVIIe siècle. Il y peint les comportements et les différents vices et vertus du genre humain. Orgueil, vanité, condition humaine, liberté ou encore hypocrisie, tout y passe avec une acuité et une ironie qui fait de l’œuvre, un classique.
Voici le résumé plus détaillé des livres de l’œuvre (à partir du livre V) :
Le livre V, De la société et de la conversation, fait état des qualités requises dans le monde social. Les codes de bienséances, comme la manière de se tenir et parler, la politesse et la civilité ne sont pour La Bruyère pas assez respectés.
Ensuite, le livre VI, intitulé « Des biens de fortune », montre au lecteur que la véritable richesse n’est pas liée à la fortune que l’on possède, mais relève des connaissances, de la sagesse que chaque individu doit avoir en soi. L’argent menace l’ordre social et biaise toute idée de mérite. On retrouve cette idée chez Marivaux également.
Le livre VII quant à lui, dont le titre est « De la ville », met en avant l’importance que les hommes et femmes accordent au regard de l’autre. Celui-ci influence les actions et comportements des individus. Chacun se compare, se moque avec des intentions malveillantes de l’autre, dans cet immense théâtre qu’est le monde. Tout le monde est dissimulé derrière un masque. La première remarque énonce alors que « L’on se donne à Paris […] pour se regarder au visage et se désapprouver les uns les autres ». Cet art de la dissimulation détruit le naturel, l’authenticité.
Par ailleurs, le livre VIII, « De la cour » expose l’idée selon laquelle sous des dehors brillants se cachent l’intérêt et l’égoïsme de ses membres. Y est dénoncée l’hypocrisie des courtisans, leur superficialité, ainsi que le caractère aléatoire, soumis au hasard, de la trajectoire de ces derniers. Ils sont soumis au moindre événement, événement qui peut détruire du jour au lendemain une vie, une carrière.
« Des Grands » est le livre IX, qui aborde plus particulièrement les mœurs des princes de sang et des nobles, en clair, les « Grands » de ce monde. Il souligne leur vanité, c’est-à-dire leur caractère futile et frivole. Ils ne sont grands que par leur naissance, mais pas par leurs actions. Les « Grands » méprisent le peuple, les travailleurs ; les premiers sont orgueilleux et se reposent sur leur situation confortable.
Enfin, le livre X, « Du souverain ou de la république », dresse une critique acerbe de la guerre qui fait souffrir les peuples. L’art de gouverner est particulièrement délicat sous le régime monarchique. Le bon prince, secondé par ses ministres, doit veiller au maintien de la paix, ne pas se considérer comme le maître absolu de ses sujets. Il doit éviter le faste, le luxe, et faire preuve de modestie.
Que signifie le parcours « la comédie sociale » ?
Comme le suggère d’emblée le sous-titre des Caractères, « les mœurs de ce siècle », La Bruyère entreprend de dépeindre les comportements de ses contemporains. Ce qu’il y a d’intéressant dans cette présentation est qu’elle conduit à une certaine forme de typologie des êtres humains. Cela consiste en un système de classification des individus en types physiques et/ou psychologiques où, le plus souvent, des correspondances sont établies entre des types physiques et des types psychologiques, les premiers étant supposés prédéterminer les seconds.
Ses portraits, moraux avant tout (La Bruyère ne cherchant derrière le portrait physique que la peinture et la stigmatisation des vices) forment des tableaux animés et vivants de personnages emblématiques de son époque et des passions de quelques types universels. Il utilise la satire pour mettre en lumière les défauts des hommes de son siècle. Le portrait de Gnathon dans le chapitre De L’Homme est un exemple parfait d’éthopée.
Il dénonce l’attitude des hommes qui se produiraient dans le monde comme dans un théâtre, et seraient dès lors les personnages d’une immense pièce. Tout n’est que posture, jeu de dupes et superficialité. Les hommes joueraient un rôle dans ce grand théâtre qu’est le monde. Cette idée rejoint celle qu’a énoncée Shakespeare dans Comme il vous plaira (à la scène 7 de l’acte II de la pièce de théâtre publiée en 1623) :
« Le monde entier est un théâtre,
Et tous, hommes et femmes, n’en sont que les acteurs.
Chacun y joue successivement les différents rôles
D’un drame en sept âges »
Les thèmes majeurs dans Les Caractères : satire sociale, morale et hypocrisie
La figure de l’homme honnête est au cœur de l’œuvre de La Bruyère. Ce dernier entreprend de présenter un tableau d’un homme idéal, vertueux (qui a des qualités morales), qui fait preuve de mesure (n’est pas excessif dans ses actes et ses propos), de droiture, qui est cultivé et modeste.
Les Caractères dessine un décor souvent citadin, en opposition aux campagnes, à la ruralité. Ce premier lieu, la ville, est décrit comme un endroit en proie à des mouvements de toutes natures. Cela conduit à ce que la situation de ses habitants soit perpétuellement instable, soumise aux variations, au hasard. Les hommes y sont esclaves, prisonniers de la fortune (du destin).
L’argent y est également incriminé dans la mesure où prend le pas sur la vertu. C’est un élément qui pousse à la décadence des puissants, qui corrompt les mœurs et dévalorise la notion de mérite.
Cette satire sociale est menée par divers procédés tels qu’une écriture particulièrement théâtrale. Celle-ci est en effet agrémentée de nombreux dialogues qui rendent le discours vivant. Cela permet de transmettre plus facilement les idées de La Bruyère. Ce dernier met en œuvre le principe de placere et docere, qui signifie « plaire pour instruire ».
La portée des Caractères de La Bruyère
Aux côtés de La Rochefoucauld ou de Montaigne, La Bruyère est considéré comme l’un des plus grands moralistes français. Son œuvre Les Caractères est devenue une référence de la littérature classique, et a influencé de nombreux écrivains des idées à l’instar de Voltaire ou encore Rousseau, et au développement du genre du portrait moral.
Pour conclure, les maximes satiriques de La Bruyère donnent à voir au lecteur la société de son époque. Il catégorise des « caractères » en s’adressant à eux, en leur émettant des remarques sur leurs comportements. Tout dénonce les attitudes qui ne respecteraient pas la morale, la vertu. Cet ouvrage permet une réflexion profonde sur le genre humain, et la compréhension globale de la société contemporaine, encore aujourd’hui. En effet, les traits décrits par La Bruyère sont intemporels et peuvent être observés à travers le temps, dans toutes les sociétés, et même la nôtre. Son style d’écriture mélangeant satire, réflexion morale et observation précise a marqué la littérature.
En bref, tu peux retenir que la portée de l’œuvre de La Bruyère est universelle. Elle réside dans son aptitude à offrir une analyse précise de la société, de ces travers, mais aussi des travers humains universels pour exercer une influence durable sur la littérature et la philosophie.
D’autres œuvres en lien avec Les Caractères à explorer
On l’a dit, le siècle dans lequel a vécu La Bruyère est marqué par une effervescence littéraire tournée vers une critique de plus en plus débridée (plus libre) du pouvoir et de la société. De nombreux auteurs contribuent à cette dynamique. Fénelon, les célèbres Fables de La Fontaine (dont les trois tomes ont été publiés respectivement en 1688, 1678 et 1694), les Maximes de La Rochefoucauld ou encore les Lettres de Madame de Sévigné en sont les exemples les plus marquants.
Toutes ces œuvres ont pour caractéristique de moquer par le biais de la satire (texte qui passe par la moquerie, voire la caricature, pour critiquer un sujet) les comportements humains. Il s’agit de dénoncer le manque d’honnêteté de certains individus, des attitudes basses.
Les citations à retenir des Caractères de La Bruyère
Laisse-nous également te donner quelques citations intéressantes tirées de l’ouvrage et leurs analyses. De quoi parfaire tes dissertations.
- « On se trompe souvent en amour, souvent on se trompe d’amour. » Cette citation met en évidence le fait que les relations amoureuses sont souvent complexes et que les gens peuvent se tromper dans leurs choix amoureux. Il peut être difficile de distinguer entre l’amour véritable et des sentiments moins sincères, ce qui peut entraîner des déceptions.
- « Le véritable éloge de la folie, c’est que l’homme sage est assez sage pour se bien connaître lui-même, assez bon pour ne point haïr les autres, assez sensé pour être heureux, assez fou pour être prudent. » Cette citation suggère que la sagesse réside dans un équilibre subtil entre la sagesse et la folie. Être trop sage peut rendre une personne amère ou misanthrope, tandis qu’être un peu fou peut lui permettre de vivre plus pleinement et de faire preuve de prudence quand cela est nécessaire.
- « Le silence est le plus grand des mépris. » Cette citation signifie que l’ignorance ou l’indifférence totale envers quelqu’un est la plus grande forme de mépris que l’on puisse exprimer. En refusant de parler ou de réagir, on peut montrer à quelqu’un qu’il est totalement insignifiant à nos yeux.
- « L’homme n’est ni ange ni bête, et le malheur veut que qui veut faire l’ange fait la bête. » Cette citation souligne la dualité de la nature humaine. Les êtres humains ne sont ni entièrement bons ni entièrement mauvais, et lorsque quelqu’un essaie de se comporter de manière trop vertueuse, cela peut souvent avoir des conséquences négatives et contre-productives. Elle met en garde contre l’excès de moralité ou d’hypocrisie.
Les œuvres au programme du bac de français 2025
Pour terminer cet article, laisse-nous te rafraîchir la mémoire sur les œuvres au programme du bac de français 2025. Cette année, comme les années précédentes, 12 œuvres seront étudiées.
👉🏻 Le théâtre du XVIIe siècle au XXIe siècle
- Pierre Corneille, Le Menteur / parcours : mensonge et comédie.
- Alfred de Musset, On ne badine pas avec l’amour / parcours : les jeux du cœur et de la parole.
- Nathalie Sarraute, Pour un oui ou pour un non / parcours : théâtre et dispute.
👉🏻 La poésie du XIXe siècle au XXIe siècle
- Rimbaud, Cahier de Douai (aussi connu sous les titres Cahiers de Douai, Recueil Demeny ou Recueil de Douai), 22 poèmes, de « Première soirée » à « Ma Bohème (Fantaisie) » / parcours : émancipations créatrices.
- Ponge, La rage de l’expression, de « Berges de la Loire » à « Le Mimosa » inclus / parcours : dans l’atelier du poète.
- Hélène Dorion, Mes forêts / parcours : la poésie, la nature, l’intime.
👉🏻 La littérature d’idées du XVIe siècle au XVIIIe siècle
- Rabelais, Gargantua / parcours : rire et savoir.
- La Bruyère, Les Caractères, livres V à X / parcours : la comédie sociale.
- Olympe de Gouges, Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne (du préambule au postambule) / parcours : écrire et combattre pour l’égalité.
👉🏻 Le roman et le récit du Moyen-Âge au XXIe siècle
- Abbé Prévost, Manon Lescaut / parcours : personnages en marge, plaisirs du romanesque.
- Balzac, La Peau de chagrin / parcours : les romans de l’énergie, création et destruction.
- Colette, Sido suivi de Les Vrilles de la vigne / parcours : la célébration du monde.
Tu trouveras sur notre site internet des fiches de lectures pour chacune de ces œuvres !