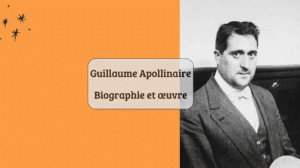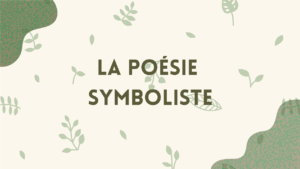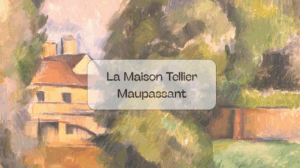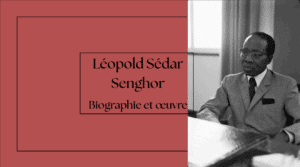Les Mains sales de Jean-Paul Sartre est un grand classique de la littérature française. Tu trouveras dans cet article un résumé de l’œuvre et un commentaire linéaire du cinquième tableau.
Le ton réaliste, pragmatique et grinçant de ce dramaturge est une particularité très intéressante qu’il faut savoir commenter.
Les personnages dans Les Mains sales, Jean-Paul Sartre
Avant de rentrer dans le vif du sujet, faisons un petit tour d’horizon des personnages présents dans l’ouvrage :
- Hugo : il est le chef du parti politique fictif appelé “Le Parti révolutionnaire prolétarien”. Hugo est un idéaliste révolutionnaire déterminé, mais il est également confronté à des dilemmes moraux et politiques.
- Jessica : c’est la compagne de Hugo. Jessica est une jeune femme idéaliste et engagée politiquement. Elle est en conflit avec Olga, sa sœur, qui représente une approche plus pragmatique de la politique.
- Olga : la sœur de Jessica, Olga est une figure politique influente et pragmatique au sein du parti. Elle est disposée à faire des compromis et à utiliser des moyens violents pour atteindre ses objectifs politiques.
- Hoederer : il est un personnage clé de la pièce et un membre éminent du parti. Hoederer est un leader charismatique et expérimenté, qui a combattu dans la résistance contre les nazis. Son personnage soulève des questions sur l’intégrité, la trahison et le réalisme politique.
- Léon : un jeune idéaliste et membre du parti, Léon admire Hoederer et le considère comme un modèle. Il est prêt à suivre ses ordres, mais est confronté à des dilemmes moraux lorsqu’il découvre certaines actions de Hoederer.
- Hugo Barine : un dirigeant politique de l’opposition au parti. Hugo Barine est un personnage cynique, opportuniste et manipulateur, prêt à utiliser tous les moyens pour atteindre le pouvoir.
- Fernandez : un membre du parti, dévoué à la cause révolutionnaire, mais qui est considéré comme peu intelligent par les autres membres.
- Olga Prim : une autre membre du parti qui se trouve dans une position de pouvoir. Olga Prim est pragmatique et souvent en désaccord avec Hugo et Jessica.
- Le Journaliste : un personnage mineur qui intervient dans la pièce et pose des questions sur les motivations et les actions des personnages.
Les Mains sales, Jean-Paul Sartre : résumé
Les Mains sales de Jean-Paul Sartre est une pièce de théâtre publiée en 1948. L’histoire se déroule dans un pays fictif appelé Illyrie et explore les dilemmes moraux et politiques auxquels sont confrontés les révolutionnaires. La pièce se concentre sur le personnage d’Hugo, le chef d’un parti politique révolutionnaire appelé Le Parti révolutionnaire prolétarien. Hugo est un idéaliste déterminé qui lutte pour la justice et la libération du peuple. Il est soutenu par sa compagne, Jessica, et sa sœur, Olga, une figure politique pragmatique et influente.
Lorsque Hugo est chargé d’assassiner un leader politique rival, Hoederer, qui est également un membre éminent du parti, il est confronté à un dilemme moral. Hugo admire Hoederer pour ses idéaux révolutionnaires et le considère comme un modèle. Cependant, il est également convaincu que l’assassinat de Hoederer servirait les intérêts du parti et de la révolution.
La pièce explore les tensions entre les idéaux et la réalité politique, mettant en évidence les compromis que les révolutionnaires doivent faire pour atteindre leurs objectifs. Les personnages principaux, Hugo, Jessica, Olga et Hoederer, sont confrontés à des choix difficiles et à des conflits internes entre leurs convictions idéologiques et les réalités de la lutte pour le pouvoir.
Au fur et à mesure que l’intrigue se développe, des secrets et des trahisons sont révélés, remettant en question les motivations et les actions des personnages. La pièce met en lumière les dilemmes moraux et éthiques auxquels les révolutionnaires sont confrontés, ainsi que les questions plus larges de la responsabilité, de la trahison et de l’intégrité.
Lire aussi : Bac français 2023 : les œuvres au programme
Les Mains sales, Jean-Paul Sartre : analyse
La pièce explore les thèmes de l’engagement politique, de la trahison, de la culpabilité et de la responsabilité individuelle. Hugo est confronté à des choix moraux difficiles tout au long de la pièce, et sa décision finale d’assassiner Hoederer a des conséquences dramatiques.
La pièce est un commentaire sur les mouvements politiques et les choix que les individus doivent faire lorsqu’ils s’engagent dans la politique. Elle explore également les thèmes de la culpabilité et de la responsabilité individuelle, soulignant que les choix que nous faisons ont des conséquences sur nous-mêmes et sur les autres.
Dans l’ensemble, Les Mains sales est une pièce de théâtre complexe qui explore des thèmes profonds et philosophiques. Elle offre une critique de la politique et des mouvements révolutionnaires, tout en explorant les conséquences morales et psychologiques des choix que nous faisons dans la vie.
Les Mains sales, Jean-Paul Sartre (cinquième tableau)
HUGO – Vous…vous avez l’air si vrai, si solide ! Ça n’est pas possible que vous acceptiez de mentir aux camarades.
HOEDERER – Pourquoi ? Nous sommes en guerre et ça n’est pas l’habitude de mettre le soldat heure par heure au courant des opérations.
HUGO – Hoederer, je… je sais mieux que vous ce que c’est que le mensonge : chez mon père tout le monde se mentait. Je ne respire que depuis mon entrée au Parti. Pour la première fois j’ai vu des hommes qui ne mentaient pas aux autres hommes. Chacun pouvait avoir confiance en tous et tous en chacun, le militant le plus humble avait le sentiment que les ordres des dirigeants lui révélaient sa volonté profonde, et s’il y avait un coup dur, on savait pourquoi on acceptait de mourir. Vous n’allez pas…
HOEDERER – Mais de quoi parles-tu ?
HUGO – De notre Parti.
HOEDERER – De notre Parti ? Mais on y a toujours un peu menti. Comme partout ailleurs. Et toi Hugo, tu es sûr que tu ne t’es jamais menti, que tu ne mens pas à cette minute même ?
HUGO – Je n’ai jamais menti aux camarades. Je…À quoi sert de lutter pour la libération des hommes, si on les méprise assez pour leur bourrer le crâne ?
HOEDERER – Je mentirai quand il faudra et je ne méprise personne. Le mensonge, ce n’est pas moi qui l’ai inventé : il est né dans une société divisée en classes et chacun de nous l’a hérité en naissant. Ce n’est pas en refusant de mentir que nous abolirons le mensonge : c’est en usant de tous les moyens pour supprimer les classes.
HUGO – Tous les moyens ne sont pas bons.
HOEDERER – Tous les moyens sont bons quand ils sont efficaces.
HUGO – Alors de quel droit condamnez-vous la politique du Régent ? Il a déclaré la guerre à l’U.R.S.S parce que c’était le moyen le plus efficace de sauvegarder l’indépendance nationale.
HOEDERER – Est-ce que tu t’imagines que je la condamne ? Il a fait ce que n’importe quel type de sa caste aurait fait à sa place. Nous ne luttons ni contre des hommes ni contre une politique mais contre la classe qui produit cette politique et ces hommes.
HUGO – Et le meilleur moyen que vous ayez trouvé pour lutter contre elle, c’est de lui offrir de partager le pouvoir avec vous ?
HOEDERER – Parfaitement. Aujourd’hui, c’est le meilleur moyen. (Un temps) Comme tu tiens à ta pureté, mon petit gars ! Comme tu as peur de te salir les mains. Eh bien, reste pur ! A quoi cela servira-t-il et pourquoi viens-tu parmi nous ? La pureté, c’est une idée de fakir et de moine. Vous autres, les intellectuels, les anarchistes bourgeois, vous en tirez prétexte pour ne rien faire. Ne rien faire, rester immobile, serrer les coudes contre le corps, porter des gants. Moi, j’ai les mains sales. Jusqu’aux coudes. Je les ai plongées dans la merde et dans le sang. Et puis après ? Est-ce que tu t’imagines qu’on peut gouverner innocemment ?
Lire aussi : Comment j’ai eu 20 au bac en français : mes conseils
Les Mains sales, Sartre : commentaire linéaire
Introduction
Le correcteur doit y trouver les premières observations générales sur le texte selon l’ordre suivant :
- Le titre et la date de publication de l’œuvre dont est extrait le texte, sa nature ;
- Le thème, le type de narrateur, le registre, les outils majeurs de l’argumentation ;
- La structure du texte, le plan et la problématique.
Ici, il s’agit d’un extrait d’une pièce de théâtre existentialiste de Sartre, Les Mains sales (1948). C’est un dialogue de deux hommes, Hoederer et Hugo. Il traite de la philosophie politique à adopter pour construire un monde juste, les deux personnages débattent à ce sujet. Le ton est tendu et argumentatif.
Le texte est structuré en deux parties : l’admiration d’Hugo face à la force et à la morale exemplaire (qu’il croit) d’Hoederer puis la révélation des mensonges du Parti qui adopte une posture utilitariste.
Dans quelle mesure ce passage apparaît-il comme une réflexion politique, éthique et morale ?
Les deux personnages
I.1. Hoederer
C’est le chef du parti prolétaire, un des partis opposés au dictateur fasciste qui dirige l’Illyrie (pays fictif). Il en est donc la personnalité principale, l’incarnation de ses idées. Une première remarque : Hoederer est au-dessus d’Hugo dans la hiérarchie du parti, et le vouvoiement que celui-ci emploie en est un signe.
C’est un homme sûr de lui, pragmatique, déterminé et prêt à tout pour atteindre son objectif : “HUGO – Vous…vous avez l’air si vrai, si solide ! Ça n’est pas possible que vous acceptiez de mentir aux camarades.” (l 1-2), “HOEDERER – Je mentirai quand il faudra et je ne méprise personne. Le mensonge, ce n’est pas moi qui l’ai inventé : il est né dans une société divisée en classes et chacun de nous l’a hérité en naissant.” (l 18-20), “HOEDERER – Tous les moyens sont bons quand ils sont efficaces.” (l 23). Il a d’ailleurs prévu de s’associer au Pentagone (parti opposé au régime en place ainsi qu’au parti prolétaire) pour gagner la guerre contre le dictateur : “HOEDERER – (…) Nous ne luttons ni contre des hommes ni contre une politique, mais contre la classe qui produit cette politique et ces hommes. / HUGO – Et le meilleur moyen que vous ayez trouvé pour lutter contre elle, c’est de lui offrir de partager le pouvoir avec vous ? / HOEDERER – Parfaitement. Aujourd’hui, c’est le meilleur moyen.” (l 28-32).
Il n’a, comme il l’affirme, pas peur d’avoir “les mains sales”.
I.2. Hugo
C’est le personnage principal de l’œuvre, membre du parti prolétaire et secrétaire principal d’Hoederer jusqu’à ce qu’il l’assassine. Si l’on en croit ce que disent les deux personnages, la famille d’Hugo ne fait pas vraiment partie du prolétariat. Elle serait plutôt bourgeoise : “HUGO – Hoederer, je… je sais mieux que vous ce que c’est que le mensonge : chez mon père tout le monde se mentait. Je ne respire que depuis mon entrée au Parti.” (l 5-6), “HOEDERER – La pureté, c’est une idée de fakir et de moine. Vous autres, les intellectuels, les anarchistes bourgeois, vous en tirez prétexte pour ne rien faire.” (l 34-36). Il faisait donc partie d’un autre monde et a un caractère plus réflexif, honnête et moral qu’Hoederer.
Dans les Mains sales, deux théories politiques qui s’affrontent
II.1. La théorie politique de Machiavel
C’est la théorie politique qu’incarne Hoederer. La formule “la fin justifie les moyens” lui colle à la peau. Il la reformule à maintes reprises : “”HOEDERER – Je mentirai quand il faudra” (l 18), “HOEDERER – Tous les moyens sont bons quand ils sont efficaces.” (l 23).
Il nous donne sa conception d’un bon pouvoir politique dans sa dernière longue réplique : “HOEDERER – (…) Moi, j’ai les mains sales. Jusqu’aux coudes. Je les ai plongées dans la merde et dans le sang. Et puis après ? Est-ce que tu t’imagines qu’on peut gouverner innocemment ?” (l 35-36). La dernière phrase semble condenser la totalité de son argumentaire, nous pourrions la reformuler ainsi : En politique, il faut savoir se salir les mains. Cette conception de la politique, où tous les moyens sont bons pour parvenir à ses fins, vient de Machiavel.
II.2. La théorie moraliste
Au contraire, Hugo incarne le moralisme politique. Il rejette le mensonge et prône l’intégrité morale des dirigeants politiques : “Je ne respire que depuis mon entrée au Parti. Pour la première fois j’ai vu des hommes qui ne mentaient pas aux autres hommes. Chacun pouvait avoir confiance en tous et tous en chacun, le militant le plus humble avait le sentiment que les ordres des dirigeants lui révélaient sa volonté profonde, et s’il y avait un coup dur, on savait pourquoi on acceptait de mourir.” (l 6-10), “HUGO – Je n’ai jamais menti aux camarades. Je…À quoi sert de lutter pour la libération des hommes, si on les méprise assez pour leur bourrer le crâne ?” (l 16-17), “HUGO – Tous les moyens ne sont pas bons.”(l 22).
Or l’honnêteté totale et inconditionnelle, l’intégrité morale et la transparence sont précisément les valeurs prônées par le moralisme politique.
La question de la morale et de l’éthique au théâtre
III.1. L’amoralité d’Hoederer contre la pureté morale d’Hugo
Les réflexions des deux personnages ne sont pas uniquement politiques, elles sont aussi morales et éthiques. Hoederer prône l’amoralité, c’est-à-dire l’absence de préoccupation morale dans le champ de l’action politique et de l’intérêt général. Selon lui, il ne faut pas s’encombrer de questions morales quand on veut agir dans l’intérêt général. Au contraire, Hugo défend la pureté morale dans les champs du social et de la politique. Toute action n’est pas défendable, même si cette action est faite dans un but que l’auteur pense positif.
Or la question de l’amoralité et de la moralité en société et en politique est une question éthique que l’on se pose depuis des siècles. Sartre, en mettant en scène ce débat dans ce passage de dialogue, propose de nouvelles réflexions à ce sujet.
III.2. La question du mensonge et de la vérité
La deuxième question éthique essentielle de ce passage est celle du mensonge et de la vérité. Faut-il se mentir ou au contraire être honnêtes les uns envers les autres pour constituer une société harmonieuse ? Le mensonge est-il inné ou acquis ? Est-il bon ou mal ? Ces questions existentielles et éthiques ont traversé les siècles et Sartre nous propose des nouvelles réponses.
Hoederer considère que le mensonge est inévitable en société, parfois nécessaire, et que nous l’héritons tous de la société dans laquelle on vit : “HOEDERER – Je mentirai quand il faudra et je ne méprise personne. Le mensonge, ce n’est pas moi qui l’ai inventé : il est né dans une société divisée en classes et chacun de nous l’a hérité en naissant. Ce n’est pas en refusant de mentir que nous abolirons le mensonge : c’est en usant de tous les moyens pour supprimer les classes.” (l 18-21), “HOEDERER – Tous les moyens sont bons quand ils sont efficaces.” (l 23).
Quant à Hugo, il condamne sérieusement le mensonge et trouve qu’il a une mauvaise influence en société. Il l’associe au mal : “HUGO – Hoederer, je… je sais mieux que vous ce que c’est que le mensonge : chez mon père tout le monde se mentait. Je ne respire que depuis mon entrée au Parti. Pour la première fois j’ai vu des hommes qui ne mentaient pas aux autres hommes. Chacun pouvait avoir confiance en tous et tous en chacun, le militant le plus humble avait le sentiment que les ordres des dirigeants lui révélaient sa volonté profonde, et s’il y avait un coup dur, on savait pourquoi on acceptait de mourir. Vous n’allez pas…” (l 5-10), “HUGO – Je n’ai jamais menti aux camarades. Je…À quoi sert de lutter pour la libération des hommes, si on les méprise assez pour leur bourrer le crâne ?” (l15-16).
Deux conceptions du mensonge et de la vérité se font face dans ce passage.
III.3. Un passage à vocation cathartique
Enfin, nous pouvons penser que ce passage a une portée cathartique pour le spectateur/lecteur.
Le personnage d’Hoederer incarne un gouvernement que le peuple ne veut pas, un parti où les mensonges et les mauvaises actions sont toujours justifiés et justifiables par la recherche de l’intérêt commun. Tous les gouvernements violents et destructeurs ont justifié leurs actions ainsi (Adolf Hitler et l’extermination des juifs par exemple).
Ce passage a donc une portée cathartique dans le sens où il montre au spectateur ce qu’il ne doit pas accepter à la tête de son pays, un message d’autant plus compris étant donné l’année de publication de la pièce de théâtre (1948). Et par la voie d’Hugo, il propose une alternative aux pouvoirs corrompus et violents précédents et en place.
Conclusion
Conseil méthodologique : synthétiser les grandes idées du commentaire de manière chronologique.
Dans le cas présent, évoquer les deux personnages principaux du passage, puis les théories politiques qu’ils incarnent et l’importance de la thématique de la moralité dans le théâtre de Sartre. Il y traite des questions éthiques et essentialistes, ses pièces ont le plus souvent une valeur instructive.
Tu as à présent toutes les clefs en main pour traiter cette œuvre dramatique de Jean-Paul Sartre ! Retrouve la biographie de Sartre, sa vie et son œuvre ici.
Lire aussi : Bac français 2023 : comment se présentent les épreuves écrites et orales ?