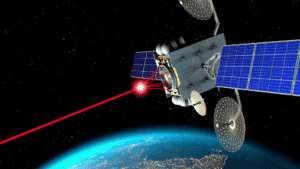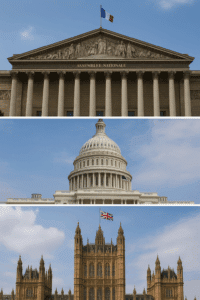Depuis l’effondrement de l’Union soviétique en 1991, la Russie cherche à retrouver un rang mondial qu’elle estime légitime. Si elle conserve certains attributs d’une grande puissance — arsenal nucléaire, siège au Conseil de sécurité de l’ONU, vastes ressources naturelles — elle reste confrontée à un dilemme stratégique : comment redevenir une puissance reconnue sans en avoir toujours les moyens économiques, diplomatiques ou technologiques ? Cette quête de reconnaissance passe par une politique étrangère offensive, un soft power assumé et une instrumentalisation des ressources énergétiques. Mais elle se heurte aussi à de fortes limites structurelles et à un isolement croissant.
Un héritage impérial toujours revendiqué
La Russie moderne se perçoit comme l’héritière d’un double empire : celui des tsars et celui de l’URSS. Dès son arrivée au pouvoir en 1999, Vladimir Poutine a défendu l’idée que la fin de l’URSS constituait « la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle ». Cette nostalgie impériale s’est traduite par une volonté de restaurer la puissance russe dans son « étranger proche » — les anciennes républiques soviétiques.
L’exemple le plus flagrant de cette stratégie est l’annexion de la Crimée en 2014, qui a marqué une rupture dans les relations entre la Russie et l’Occident. L’intervention militaire en Géorgie en 2008, puis en Ukraine à partir de 2014, s’inscrit dans une logique de reconquête d’influence dans l’espace post-soviétique.
Par cette posture, la Russie affirme son refus de l’expansion de l’OTAN à ses frontières. Elle tente ainsi de se positionner comme une puissance « révisionniste », contestant l’ordre international issu de la fin de la guerre froide.

Une puissance militaire au service du prestige
La Russie conserve une armée puissante et modernisée, héritée de la logique de superpuissance soviétique. Avec un budget de défense autour de 100 milliards de dollars (environ 4 % de son PIB), elle demeure la deuxième puissance nucléaire mondiale, avec plus de 6000 ogives.
Son armée est intervenue à plusieurs reprises à l’étranger, notamment :
- En Syrie (2015), pour soutenir le régime de Bachar al-Assad, marquant le retour militaire de la Russie au Moyen-Orient.
- En Ukraine (depuis 2022), avec une guerre totale contre un pays souverain, qui vise à déstabiliser l’Europe et redéfinir les zones d’influence.
Par ces interventions, Moscou cherche à montrer sa capacité à influer sur les grands dossiers internationaux, malgré des moyens économiques limités. Cette politique de projection militaire s’accompagne d’une intense propagande, renforçant l’image d’un État fort et souverain.
L’arme énergétique : une diplomatie du gaz
La Russie est l’un des premiers producteurs mondiaux de gaz et de pétrole. Ces ressources constituent un levier de puissance majeur. À titre d’exemple, avant 2022, l’Union européenne importait près de 40 % de son gaz de Russie.
Les grandes entreprises comme Gazprom ou Rosneft jouent un rôle politique autant qu’économique. L’oléoduc Nord Stream 2, qui devait relier directement la Russie à l’Allemagne, a été suspendu à la veille de l’invasion de l’Ukraine, révélant la dépendance énergétique européenne et le bras de fer diplomatique qui en découle.
Face aux sanctions occidentales, la Russie tente de réorienter ses exportations vers l’Asie, notamment la Chine, via les projets de gazoducs comme Power of Siberia. Mais cette reconversion est complexe, longue et implique une perte d’influence en Europe.

Une économie sous pression
Malgré ses ressources naturelles, la Russie reste une puissance économique moyenne : son PIB est équivalent à celui de l’Espagne. Elle souffre de plusieurs fragilités structurelles :
- Une économie très dépendante des hydrocarbures.
- Une faible diversification industrielle.
- Une fuite des cerveaux accentuée depuis le début de la guerre en Ukraine.
- Un climat des affaires instable, marqué par la corruption et l’oligarchie.
Depuis 2014, les sanctions occidentales ont renforcé l’isolement économique du pays. En 2022, l’invasion de l’Ukraine a provoqué une vague de désinvestissements étrangers, la déconnexion du système bancaire SWIFT pour plusieurs banques russes, et une chute du rouble.
Même si l’État russe a su amortir certains chocs grâce à ses réserves, le coût économique de ses ambitions géopolitiques est considérable, et pourrait à terme fragiliser la stabilité du régime.
Le retour d’un soft power autoritaire de la Russie
En parallèle de sa puissance dure (hard power), la Russie développe un soft power à la fois conservateur et anti-occidental. À travers des médias comme Russia Today (RT) ou Sputnik, elle diffuse une vision du monde fondée sur le rejet du libéralisme occidental, la valorisation de la souveraineté des États, et la critique des élites européennes.
La Russie joue également la carte des valeurs traditionnelles (famille, Église orthodoxe, patriotisme) face à un Occident jugé décadent. Cette stratégie séduit certains partis populistes en Europe, ainsi que des régimes autoritaires en Afrique ou en Asie.
Dans les pays du Sud, Moscou se présente comme l’héritière de l’URSS, soutien historique des luttes anticoloniales, et renforce sa présence par des accords militaires (Centrafrique, Mali) ou des livraisons de céréales et d’armements.
Une diplomatie de rupture
La diplomatie russe s’inscrit désormais dans une logique de confrontation plus que de coopération. Depuis 2022, la Russie est exclue de nombreuses enceintes internationales (Conseil de l’Europe, G8 devenu G7) et fait face à une condamnation massive de l’ONU sur la question ukrainienne.
Néanmoins, elle conserve des soutiens : la Chine, avec qui elle partage une vision multipolaire du monde ; l’Iran, dans une logique anti-occidentale ; ou encore certains pays africains séduits par un discours souverainiste.
Mais cette diplomatie du contournement se heurte à des limites : perte d’accès aux marchés occidentaux, défiance croissante dans l’espace post-soviétique (Kazakhstan, Arménie), et isolement croissant sur la scène mondiale.
La Russie : une puissance fragmentée
En définitive, la Russie reste une puissance paradoxale : capable de bloquer des décisions au Conseil de sécurité, de faire vaciller l’ordre international, mais limitée dans ses capacités économiques, technologiques et diplomatiques. Elle peut déséquilibrer, mais peine à construire.
Sa quête de reconnaissance s’apparente à un retour contrarié : nostalgie d’un passé impérial, affirmation brutale dans le présent, mais incertitude sur l’avenir. Le conflit en Ukraine agit comme un révélateur de cette impasse stratégique.