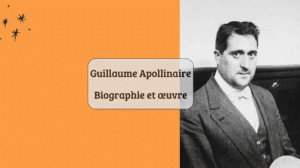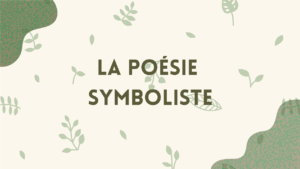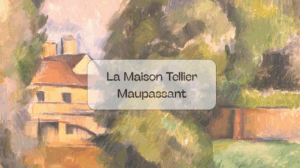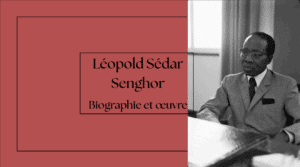Sais-tu commenter un texte de théâtre ? Dans cet article, nous te donnons nos meilleurs conseils pour briller au bac de français si tu tombes sur un texte de théâtre.
👉🏻 Pour rappel : le bac de français aura lieu le vendredi 13 juin 2025, et le théâtre est un incontournable de l’épreuve. Dans cet article, on fait le point avec toi sur le commentaire de texte théâtral et toutes ses subtilités, avec nos meilleurs conseils pour briller le jour J.
La méthodologie du commentaire de texte de théâtre
La problématique d’un texte de théâtre
Pour trouver la problématique d’un extrait de théâtre, il faut commencer par saisir la spécificité du texte. Qu’est-ce qui le rend intéressant et exceptionnel (trouver la raison pour laquelle les jurés l’ont choisi) ?
Plusieurs axes sont possibles pour un texte de théâtre :
- Le texte est-il particulièrement représentatif d’un genre ou d’un mouvement littéraire ?
- Se distingue-t-il au contraire des autres dans un genre ?
- Quels outils littéraires sont utilisés et dans quel but ?
L’important est de trouver un ou plusieurs axes (attention à ne pas t’éparpiller non plus, un ou deux suffisent) qui concernent le texte dans sa totalité.
Comment construire un commentaire de texte de théâtre ?
Dans ton développement, tu devras toujours partir d’observations basiques pour aboutir à quelque chose de plus subtil, pointu et réfléchi.
Le premier niveau d’analyse est important pour permettre à celui qui lira ton travail de saisir la nature du texte, ce qu’il contient, etc. et pour montrer que vous l’avez bien compris.
Il faut veiller à construire son analyse de manière composée, c’est-à-dire en retenant les grandes idées du texte et en construisant son plan à partir de deux ou trois grands axes.
🤓 Exemple : Tout d’abord, ensuite, enfin, toutefois, cependant, en revanche, de plus, de même, etc.
Il faut tout d’abord faire attention au rythme du texte, à la place du narrateur et de l’auteur dans le texte ! Il faut ensuite ne pas oublier de bien citer le texte pour prouver ce que l’on déclare (en précisant à chaque fois la ligne). Enfin, veillez à utiliser le vocabulaire spécifique au théâtre (on ne parle pas de ligne, mais de vers ; ne pas oublier les didascalies).
Vocabulaire du théâtre : les termes que tu dois connaître
Nous t’avons concocté un petit florilège de termes à connaître pour étayer ta copie de commentaire de texte de théâtre.
Définition dramaturge
Tu connais sans doute déjà ce terme, mais un petit rappel ne fait jamais de mal. Le dramaturge est l’auteur d’une pièce de théâtre. François Mauriac (l’auteur du célèbre roman Thérèse Desqueyroux) disait justement : « Ce qui distingue un romancier, un dramaturge, du reste des hommes, c’est justement le don de voir de grands arcanes dans les aventures les plus communes. »
Définition acte
Au théâtre, l’acte est un grand découpage de la pièce. Un acte se décompose lui-même en scène. C’est pour cette raison que, dans une pièce de théâtre, tu peux lire en haut des pages « Acte I, scène 3 » par exemple. Ce découpage permet au lecteur de se retrouver dans l’ensemble de la pièce.
Définition scène
Comme nous venons de le voir, les pièces de théâtre sont découpées selon une logique : les actes et les scènes. Les scènes sont le découpage qui intervient à l’intérieur des actes. Tu peux alors comparer cette organisation à celle d’un roman composé de parties et de chapitres.
Homonymie oblige, la scène est également le lieu où se déroule la pièce de théâtre, mais ça, je pense que je n’ai pas besoin de te le rappeler !
Définition hors scène
Comme son nom l’indique, il s’agit du lieu où se déroule tout ce qui n’est pas visible par le spectateur lors de la représentation théâtrale. On inclut également dans le hors scène les paroles prononcées par un personnage qu’on ne voit pas.
Définition règle des trois unités
Très connue dans le milieu du théâtre, cette règle est imposée par le théâtre classique et elle concerne l’unité de lieu (la pièce doit avoir lieu dans un seul et même espace), l’unité de temps (en 24 heures seulement) et l’unité d’action (une seule action peut avoir lieu), ainsi que la vraisemblance de la pièce. Nicolas Boileau disait : « Qu’en un lieu, en un jour, un seul fait accompli tienne jusqu’à la fin le théâtre rempli. »
Définition vraisemblance
Dans les pièces de théâtre classique, la règle de vraisemblance a toute son importance. Elle oblige les auteurs à ce que leur pièce soit ressemblante à la réalité et donne aux spectateurs une impression de vérité. Le but est que les spectateurs se sentent concernés par la pièce de théâtre, car ils peuvent s’identifier à ce qu’ils voient. Il faut donc faire preuve de crédibilité dans l’histoire racontée. C’est l’une des règles du théâtre classique.
Définition bienséance
La bienséance correspond aux règles morales et éthiques que le dramaturge doit respecter selon le théâtre classique, par exemple : pas de sang sur scène, pas de mort sur scène, pas de scène de nudité, etc. La bienséance est présente pour ne pas heurter la sensibilité du public et maintenir les bonnes mœurs sur scène.
Définition chœur
Le chœur est un groupe de personnes qui intervient dans la pièce sous la forme de chant ou de danse à l’unisson (d’où l’expression « chanter en chœur ». Il vient animer le discours des personnages. Le chœur est généralement composé de 10 à 15 personnes. Il n’est pas obligatoire dans une pièce de théâtre.
Définition confident
Dans le théâtre tragique, le confident est le personnage à qui se confient les autres personnages. Il a bien généralement un rôle clé dans le dénouement de la tragédie. Par exemple, dans la tragédie de Jean Racine, Andromaque, le personnage de Pylade est à la fois le confident et l’ami d’Oreste, tandis que Céphise est le confident d’Andromaque. Même chose dans la tragédie Phèdre du même auteur, le personnage principal Phèdre se confie à Œnone.
Définition didascalie
La didascalie est une indication ou instruction scénique qui est insérée dans le corps du texte en italique et/ou entre parenthèses.
Définition monologue
Le monologue est un moment de la pièce de théâtre dans lequel le personnage, seul sur scène, se parle à lui-même. Le monologue révèle généralement les sentiments du personnage, qui n’a pas peur d’être surpris par un autre. On peut citer par exemple le monologue d’Arnolphe dans L’École des femmes de Molière (acte IV, scène 1) : « J’ai peine, je l’avoue, à demeurer en place». La pièce le Cid de Corneille comporte également plusieurs monologues du personnage Don Diègue :
- Acte I, scène 4 : « Ô rage ! Ô désespoir ! Ô vieillesse ennemie ! » ;
- Acte I, scène 6 : « Percé jusques au fond du cœur ».
Définition tirade
La tirade est une longue réplique qui ressemble à un monologue, à la seule différence qu’elle n’est pas prononcée par un personnage seul sur la scène. Parmi les tirades les plus connues et reconnues du théâtre classique, on compte la tirade de Phèdre dans la pièce du même nom Racine. Elle déclare alors son amour à Hippolyte ( « Oui, prince, je languis, je brûle pour Thésée (…) », acte II, scène 5). Dans un registre plus comique, on retrouve la tirade du nez de Cyrano de Bergerac dans la pièce éponyme d’Edmond Rostand : « Ah ! non ! C’est un peu court, jeune homme ! » (acte I, scène 4).
Définition stichomythie
La stichomythie se traduit par un échange de répliques courtes et sèches entre des personnages. La stichomythie marque une accélération dans le dialogue. Elle sert aussi à mettre en avant des sentiments intenses chez les personnages. Elle est souvent utilisée lors de scènes de badinages amoureux. Elle fait ressortir l’escalade des émotions fortes telles que la violence ou la passion lors de scènes de mise sous tension. Tu peux retrouver des exemples de stichomythie à acte I, scène 3 du Cid de Corneille ou bien dans l’École des femmes de Molière, acte II, scène 1.
Définition réplique
Tu connais sans doute déjà ce terme, les répliques sont les paroles prononcées par un personnage sur scène, lors d’un monologue ou d’un dialogue.
Définition aparté
L’aparté est un mot ou une réplique prononcés à part du dialogue par un personnage qui n’est entendu que par les spectateurs. Lors de l’aparté, le personnage en question révèle bien souvent des informations au public quant à ses sentiments, ses ressentis et ses intentions sans filtre (puisque les autres personnages ne sont pas censés l’entendre). L’aparté peut également avoir un effet comique. C’est souvent le cas dans les pièces de Molière par exemple.
Définition soliloque
Là, les choses se corsent… Le soliloque est un discours prononcé par un personnage qui ne cesse de parler, même lorsque les autres personnages sont présents. Il existe aujourd’hui le verbe « soliloquer » qui veut ainsi dire : se parler à soi-même. Il s’agit donc d’un cas particulier de monologue. Tu peux le reconnaître facilement, notamment dans les comédies, car il est introduit par des didascalies qui indiquent « à lui-même » /« à elle-même ».
Définition quiproquo
Tu connais déjà ce terme, il s’agit d’un malentendu au théâtre. Le quiproquomène généralement à des scènes comiques ou encore tragiques. Un personnage est par exemple pris pour un autre, les intentions des personnages ne sont pas les bonnes, etc. Molière met en scène un parfait exemple de quiproquo comique dans L’Avare, acte V, scène 3. Alors que le personnage de Valère est amoureux d’Élise, la fille d’Harpagon, Harpagon, lui, est obnubilé par la cassette qui renferme son argent. Il s’agit d’un véritable dialogue de sourds.
Définition grotesque
Le grotesque est un type de comique qui se caractérise par la caricature et la déformation de la réalité.
Définition burlesque
Tout comme le grotesque, le burlesque est un type de comique qui, cette fois-ci, ne respecte pas l’adéquation de la classe sociale et des manières du personnage et inverse ce rapport. Des personnages de la haute société qui agissent avec bassesse et inversement par exemple. On peut aussi appeler cette caractéristique « carnavalesque ».
Définition satire
La satire est une œuvre qui ridiculise et se moque des mœurs d’une personne ou d’un groupe. Elle est bien souvent en vers. Le Malade imaginaire de Molière est un exemple de satire au théâtre.
Définition saynète
La saynète (eh oui, c’est bien la bonne orthographe !) est une petite pièce comique avec peu de personnages. Si tu trouves le mot orthographié de la manière suivante : « scènette », c’est qu’il s’agit d’une erreur, malheureusement fort répandue. Adam et Eve de David-Olivier Defarges est un exemple de saynète.
Définition scène d’exposition
La scène d’exposition est une scène introductive de l’œuvre théâtrale, dans laquelle apparaissent les clés de compréhension de celle-ci (les personnages principaux ou protagonistes, l’espace, le temps, l’intrigue, etc.).
Définition prologue
Dans les œuvres antiques, le prologue est la présentation du sujet avant l’intervention du chœur (dont nous avons parlé un peu plus tôt). Parmi les prologues célèbres, on peut notamment citer celui de la comédie Amphitryon de Molière qui est essentiel pour que les spectateurs puissent reconnaître les personnages.
Définition intrigue
L’intrigue désigne les événements qui constituent la plus grosse partie de la pièce (le déroulement) et qui font avancer grâce à plusieurs rebondissements.
Définition péripétie
La péripétie est un changement de situation subi par un ou plusieurs personnages. Les péripéties permettent de faire avancer l’intrigue jusqu’au dénouement (ci-dessous).
Définition dénouement
Le dénouement désigne la résolution des nœuds de l’intrigue, souvent à la fin de la pièce. Il s’agit souvent de la scène finale d’une pièce de théâtre, qui apporte la solution au problème rencontré jusqu’alors par les personnages.
Nos conseils pour un bon commentaire de texte de théâtre
Tu n’es pas encore très à l’aise avec cet exercice ? Nous te prodiguons nos meilleurs conseils.
Comprendre le contexte de la pièce
Avant même de te plonger dans l’extrait qui t’est proposé, assure-toi bien de comprendre le contexte de la pièce. Pour ça, interroge-toi sur l’auteur (que sais-tu sur lui ? a-t-il un engagement particulier ?), le mouvement littéraire de la pièce et le contexte historique (à quelle époque est-on ? que s’est-il passé à cette époque ?). En répondant à ces quelques questions, tu devrais pouvoir élaborer le cadre de la pièce.
Ce sont des données métatextuelles, mais qui pourraient te permettre de bien mieux comprendre l’œuvre.
Lis bien l’extrait plusieurs fois
Une fois devant ta copie d’examen, première chose à faire : la lire et la relire. La première lecture doit être globale pour que tu puisses saisir le sens général. Lis ensuite attentivement pour analyser les détails, comme les dialogues, les répliques, les indications scéniques, etc. Tout ce qui pourrait te mettre sur une piste d’analyse.
Essaie de placer l’extrait dans la pièce
Si tu as les indications nécessaires, essaie de comprendre comment l’extrait s’insère dans la pièce de théâtre. Où se situe-t-il ? Après quel événement ? Au début ? À la fin de la pièce ? Ça te permettra de comprendre un peu mieux l’extrait.
Identifier les éléments dramatiques de l’extrait
Lors de tes lectures, identifie les éléments dramatiques du texte comme les personnages, les actions, les conflits, les enjeux et, surtout, l’intrigue. Une fois que tu auras déterminé tous ces éléments, tu pourras commencer à analyser à proprement parlé le texte.
Analyse le langage théâtral
Tu le sais, le théâtre a ses propres codes, alors essaie d’analyser ce que tu lis. Tu peux alors parler des procédés utilisés par l’auteur, comme les répliques, les apartés, les monologues ou encore les didascalies. Sois attentif à la manière dont le langage contribue à l’expression des émotions et des thèmes dans l’extrait.
Garde bien à l’esprit que si les choses sont dites de cette manière, avec tel ou tel effet, ce n’est pas anodin.
Sois attentif(ve) aux références culturelles
C’est un conseil qui demande une culture littéraire et historique fournie certes, mais qui te permet de ne pas passer à côté d’une analyse. Le théâtre (notamment le théâtre antique) emploie fréquemment des références à des mythes ou à des événements historiques. En passant à côté, tu risques de manquer des éléments de compréhension et donc de passer à côté du sujet.
Les 5 erreurs à éviter dans un commentaire de texte de théâtre
Ne pas considérer le registre littéraire
Comme tout registre littéraire, le théâtre possède ses codes. Tu ne peux pas commenter un texte de théâtre comme un texte de roman par exemple.
Le registre théâtral, bien que paraissant plus facile à étudier, se révèle être, en réalité, bien codifié. Montre que tu maîtrises les outils littéraires vus en cours : les différents comiques, le vocabulaire (aparté, monologue, didascalies, tirade, etc.), le champ lexical, les figures de style, etc. Des mots techniques doivent apparaître dans ton devoir.
Ne pas suivre la méthodologie
Ce n’est pas parce que le commentaire de texte te laisse un peu plus de liberté de rédaction qu’il n’existe pas de méthodologie. Au contraire, tu dois appliquer la méthode du commentaire vu en cours et la mettre en application.
Paraphraser le texte théâtral
Évidemment, tu dois illustrer ton analyse en reprenant, avec parcimonie, quelques répliques des personnages qui montrent bien ton propos. Cependant, tu ne peux pas répéter l’intégralité du passage. Le correcteur a déjà lu le texte, il veut juste voir si tu l’as bien compris.
Paraphraser peut être vu comme un manque de connaissances sur le sujet, alors évite de laisser planer le doute.
Ne pas structurer ton commentaire
C’est primordial d’organiser ton analyse, ça permet d’y voir plus clair à la fois pour toi et pour le correcteur. Il aura une centaine de copies à relire alors si la tienne peut faciliter son travail, il t’en sera peut-être reconnaissant dans la notation !
Même pour toi, structurer ta copie, c’est structurer tes idées alors n’oublie pas : introduction, corps de texte (avec parties et sous parties) et conclusion !
Ne pas aérer ta copie
Dans la même logique, aérer ta copie, c’est faciliter la lecture du correcteur. Ta copie doit respirer ! D’abord, parce que ça la rend plus esthétique, mais surtout parce que ça crée un fil conducteur appréciable pour le correcteur.
Alors, n’hésite pas à sauter des lignes, faire des alinéas, etc. Aussi, on te conseille de rendre une copie propre alors, Tipp-ex et rayures à la règle sont à favoriser !
Astuce 🤓 Nous te conseillons de sauter deux lignes entre chaque partie et une entre chaque sous-partie pour structurer ton commentaire de texte de théâtre.
Commenter un texte de théâtre : exemples de commentaires
Pour que tu y voies un peu plus clair, nous avons listé ci-dessous plusieurs exemples d’analyses de commentaire d’extrait de textes de théâtre :
- En attendant Godot, Samuel Beckett (scène dernière du second acte). Tu peux trouver une analyse ici.
- Bérénice, Racine (scène dernière de l’acte V). Tu peux trouver une analyse ici !
- Les fourberies de Scapin, Molière (acte III, scène 2) avec son analyse ici.
- Les mains sales, Jean-Paul Sartre (5e tableau) avec son analyse ici.
- Dom Juan, Molière (acte I, scène 3) avec son analyse ici.
- Les Fausses confidences, Marivaux, (acte II, scène 2). Retrouve l’analyse ici.
Le programme du bac de français 2024
Cette année, au programme du baccalauréat 2024 de la voie générale, tu retrouveras les pièces suivantes concernant le théâtre du XVIIe siècle au XXIe siècle :
- Molière, Le Malade imaginaire, sous la thématique : spectacle et comédie ;
- Marivaux, Les Fausses Confidences, sous la thématique : théâtre et stratagème ;
- Jean-Luc Lagarce, Juste la fin du monde, sous la thématique : crise personnelle, crise familiale.
Pour la voie technologique, seule l’œuvre de Marivaux diffère et est remplacée par L’Île des esclaves du même auteur, sous la thématique « maîtres et valets ».
Un exercice pour tester tes connaissances sur le vocabulaire de théâtre
Question 1 :
Comment appelle-t-on l’auteur d’une pièce de théâtre ?
a) Un metteur en scène
b) Un dramaturge
c) Un scénariste
d) Un auteur dramatique
Question 2 :
Que signifie « acte » au théâtre ?
a) Une division d’un roman
b) Un ensemble de scènes formant une partie de la pièce
c) Une longue réplique d’un personnage
d) Un élément du décor
Question 3 :
Qu’est-ce que le « hors scène » ?
a) Un espace destiné aux spectateurs
b) La partie de la scène réservée aux acteurs principaux
c) Tout ce qui se passe en dehors de ce que le spectateur peut voir
d) Une méthode de jeu d’acteur
Question 4 :
Quelle est l’une des règles des trois unités du théâtre classique ?
a) La pièce doit être jouée par trois personnages minimum
b) L’action doit se dérouler en moins d’une heure
c) L’histoire doit se limiter à un seul lieu, en 24 heures, et à une seule intrigue
d) Les décors doivent rester identiques tout au long de la pièce
Question 5 :
À quoi sert la vraisemblance dans le théâtre classique ?
a) À rendre l’histoire poétique
b) À donner l’illusion de réalité et à impliquer les spectateurs
c) À introduire des éléments surnaturels
d) À ajouter de l’humour dans la pièce
La correction de l’exercice sur le vocabulaire de théâtre
- b) Un dramaturge
- b) Un ensemble de scènes formant une partie de la pièce
- c) Tout ce qui se passe en dehors de ce que le spectateur peut voir
- c) L’histoire doit se limiter à un seul lieu, en 24 heures, et à une seule intrigue
- b) À donner l’illusion de réalité et à impliquer les spectateurs
🎭 FAQ – Commentaire de texte théâtral au bac de français
Qu’attend-on d’un commentaire de texte de théâtre ?
Tu dois analyser en profondeur un extrait de pièce en montrant comment il fonctionne : construction des dialogues, intentions des personnages, tonalité, registre, enjeux dramaturgiques… L’objectif est de faire apparaître la richesse de l’écriture théâtrale.
Faut-il parler des didascalies ?
Oui, absolument. Les didascalies (indications de mise en scène, gestes, tons, déplacements…) sont essentielles pour comprendre l’attitude des personnages et les intentions de l’auteur. Elles ne doivent pas être négligées dans l’analyse.
Dois-je structurer mon commentaire en trois parties ?
Oui, le commentaire de texte suit la même structure que pour les autres genres : une introduction, un développement organisé en trois axes cohérents et une conclusion. Chaque partie doit répondre à la problématique que tu as posée.
Quels procédés spécifiques au théâtre dois-je repérer ?
Pense à analyser les types de répliques (tirade, monologue, dialogue), les effets comiques ou dramatiques, les apartés, la double énonciation, la tension ou les retournements de situation. Le théâtre a ses codes, à toi de les décrypter !
Dois-je faire référence à la mise en scène ?
Tu peux, si cela te permet d’enrichir ton analyse. Mais attention : reste toujours ancré dans le texte. Les références à la mise en scène doivent servir ton propos, pas l’alourdir.