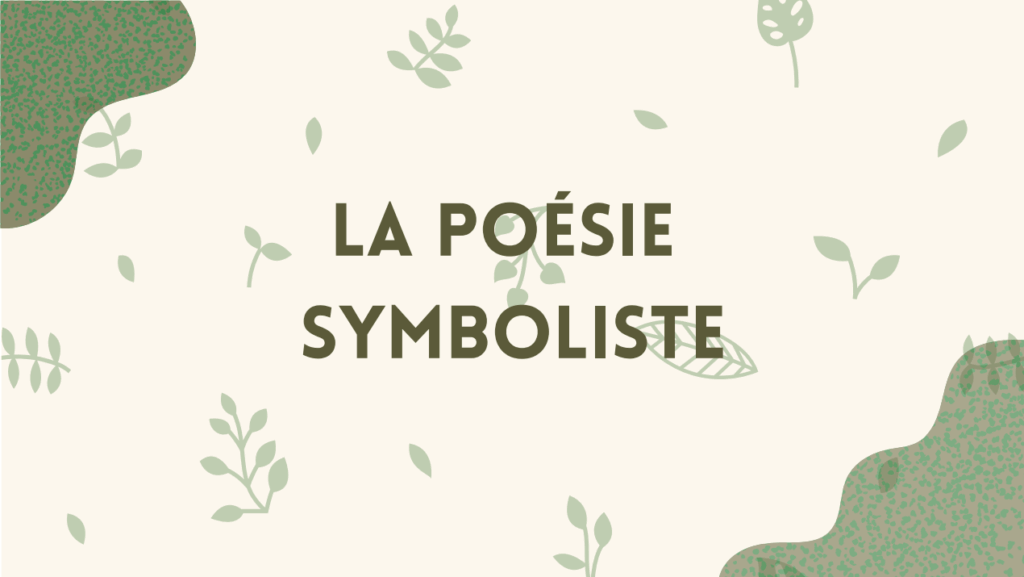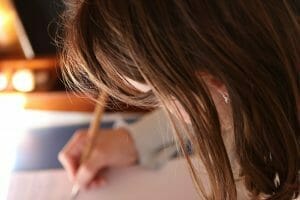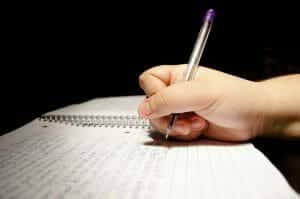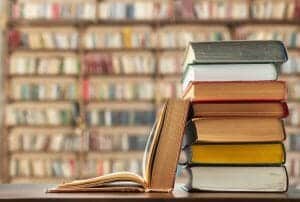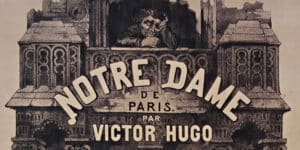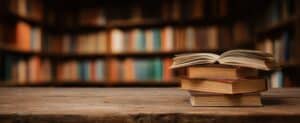Alors que la poésie romantique est un incontournable des programmes de français en Seconde et en Première, la poésie symboliste est quant à elle souvent moins abordée. Pour remédier à cela, nous te proposons dans cet article de faire un point sur les caractéristiques de ce courant, ses figures importantes et sa portée.
🌙 Ce qu’il faut retenir de la poésie symboliste
- Origine : Mouvement né à la fin du XIXᵉ siècle en réaction au réalisme et au naturalisme, pour proposer une poésie tournée vers l’invisible et le mystère.
- Principes : Suggestion plutôt que description, usage du symbole, musicalité du vers, fusion des sensations (synesthésie), ambiguïté assumée.
- Figures majeures :
- Charles Baudelaire, précurseur avec Les Fleurs du mal.
- Paul Verlaine, maître des nuances et de la musicalité.
- Arthur Rimbaud, poète visionnaire et rebelle avec Une saison en enfer.
- Héritage : Influence majeure sur la poésie moderne et les arts : surréalisme, poésie contemporaine, peinture symboliste, musique impressionniste.
- Objectif : Dépasser le monde visible, éveiller les sens et l’imaginaire, explorer les profondeurs de l’âme à travers le langage poétique.
Introduction : une révolution poétique à la fin du XIXᵉ siècle
La fin du XIXᵉ siècle est un moment charnière dans l’histoire de la littérature française. Alors que le réalisme et le naturalisme dominent les scènes romanesques et théâtrales, un autre courant, plus souterrain, plus insaisissable, s’élève en réaction à cette littérature trop centrée sur les faits, les descriptions minutieuses et les explications rationnelles du monde. Ce courant, c’est le symbolisme, porté par une poésie nouvelle, méditative, musicale, à la recherche d’une vérité cachée sous les apparences.
La poésie symboliste se conçoit comme une tentative de percer le voile du monde sensible pour accéder à une réalité plus profonde, plus spirituelle. Elle fait appel aux symboles, aux images suggestives, à une langue riche en sonorités et en rythmes. Elle ne décrit pas, elle suggère ; elle ne nomme pas, mais elle préfère évoquer plutôt que raconter.
Le symbolisme, annoncé par Baudelaire, théorisé par Jean Moréas et illustré par Verlaine, Rimbaud ou Mallarmé, est bien plus qu’un style : c’est une manière de penser la création poétique comme un acte mystique, une alchimie des mots et de l’âme. C’est ce que nous allons explorer dans cet article.
Le contexte de naissance du symbolisme
Pour comprendre le symbolisme, il faut revenir sur le climat intellectuel et artistique de la seconde moitié du XIXᵉ siècle. Le positivisme triomphe dans les sciences, les sociétés industrielles se modernisent rapidement, et la littérature tente de refléter ces transformations. Le roman devient un instrument de dissection sociale et psychologique, à la manière de Balzac, Flaubert, Zola.
Mais certains écrivains ressentent un malaise face à cette volonté de tout expliquer. L’art, selon eux, ne doit pas être une simple reproduction du réel. Il doit viser l’invisible, l’indicible. La poésie, en particulier, doit s’éloigner de la logique, de la démonstration. C’est ainsi que naît une littérature de la suggestion, qui cherche à créer des correspondances entre les sens, les images, les idées.
Les grands principes esthétiques du symbolisme
Le symbole comme outil de connaissance
Le symbolisme repose sur une conviction fondamentale : le monde visible n’est qu’un reflet d’une réalité supérieure, spirituelle, souvent inaccessible directement. Le poète a pour mission de déchiffrer ce monde caché, en utilisant le symbole. Contrairement à la métaphore ou à l’allégorie, le symbole ne traduit pas une idée de façon directe, mais l’évoque par une image, une atmosphère, un rythme.
Charles Baudelaire définit cette vision dans son sonnet « Correspondances » :
« La nature est un temple où de vivants piliers
Laissent parfois sortir de confuses paroles ».
La nature devient ici un sanctuaire rempli de signes à interpréter. Le poète n’est plus un simple observateur, mais un médium.
La musicalité du vers dans la poésie symboliste
Un autre pilier du symbolisme est la place centrale de la musicalité. Paul Verlaine, dans son fameux « Art poétique », donne le ton :
« De la musique avant toute chose,
Et pour cela préfère l’Impair ».
Le vers devient un instrument de musique, où les sonorités, les rythmes impairs, les allitérations et les assonances comptent parfois davantage que le sens littéral. Il s’agit de créer une « chanson grise », où le sens se fond dans la sonorité.
La synesthésie : la fusion des sensations
Le poète symboliste est aussi un synesthète, c’est-à-dire qu’il mêle les sens, associe les couleurs aux sons, les parfums aux formes. Rimbaud va jusqu’à attribuer une couleur à chaque voyelle dans son poème « Voyelles » :
« A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu : voyelles, […] »
Cette fusion sensorielle est censée provoquer une expérience unique, déstabilisante, propre à ouvrir des horizons intérieurs.
L’ambiguïté, la suggestion
Enfin, le symbolisme se caractérise par une certaine obscurité volontaire. Le sens n’est jamais donné d’emblée. Il faut le découvrir, le ressentir. Le poème devient un mystère, un labyrinthe où l’on se perd autant qu’on s’émerveille. Mallarmé dit à cet effet que :
« Nommer un objet, c’est supprimer les trois quarts de la jouissance du poème ».
Il faut donc « suggérer », plutôt que d’énoncer.
Les figures majeures du symbolisme
Charles Baudelaire : le précurseur
Bien qu’il précède chronologiquement les symbolistes, Charles Baudelaire est souvent considéré comme leur père spirituel. Dans Les Fleurs du mal, il explore déjà les correspondances entre les mondes sensibles et spirituels, comme dans le poème éponyme « Correspondances ». Son travail de mise en relation entre les sensations et les idées, entre la beauté et le mal, préfigure toute l’esthétique symboliste.
Baudelaire écrit :
« Les parfums, les couleurs et les sons se répondent ».
Cette fameuse formule illustre son intuition que le langage poétique doit permettre une perception nouvelle du monde, plus intuitive que rationnelle.
Paul Verlaine
Verlaine est sans doute le plus emblématique du style symboliste. Sa poésie délicate, évocatrice, évite l’explication au profit de la sensation. Dans Romances sans paroles ou Fêtes galantes, il joue avec les nuances, les demi-teintes, les rythmes impairs, les sonorités liquides.
Dans « Il pleure dans mon cœur », Verlaine fait rimer l’intériorité mélancolique avec le chant de la pluie :
« Il pleure dans mon cœur
Comme il pleut sur la ville ».
Cette mélancolie douce, cette musique de l’âme, sont typiquement symbolistes.
Arthur Rimbaud
Rimbaud, bien que fugace dans sa carrière littéraire, est un météore qui marque profondément le symbolisme. Il veut « changer la vie » et pour cela, il propose une « alchimie du verbe ». Dans Une saison en enfer ou Les Illuminations, il fait exploser les formes poétiques traditionnelles.
Dans sa « Lettre du voyant », il écrit :
« Je dis qu’il faut être voyant, se faire voyant. Le poète se fait voyant par un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens ».
Par là, il prône une quête d’inspiration qui passe par la désorganisation de la perception ordinaire, pour atteindre un niveau supérieur de conscience.
L’héritage et la postérité du symbolisme
Le symbolisme a profondément marqué la poésie moderne. Après lui, plus aucun poète ne peut écrire comme avant. Le goût de l’obscur, de l’inachevé, de l’ellipse traverse tout le XXᵉ siècle. Des surréalistes comme Paul Éluard ou André Breton reprendront à leur manière cette idée d’une poésie qui explore l’inconscient et les zones cachées de l’âme.
La poésie de Saint-John Perse, de René Char, voire d’Yves Bonnefoy, hérite aussi de ce refus de la transparence, de cette foi en la puissance évocatrice des images.
En dehors de la poésie, le symbolisme influence également les arts plastiques (Gustave Moreau, Odilon Redon), la musique (Debussy), et la pensée littéraire tout entière, préparant l’avènement de la modernité.
Afin de vérifier tes connaissances après la lecture de cet article, nous te proposons de réaliser ce quiz, proposé par le site Lumni !
Ce que tu dois retenir sur la poésie symboliste
La poésie symboliste n’est pas une école figée, ni une méthode. Elle est avant tout une attitude, un rapport au langage et au monde. Elle affirme que le visible n’est qu’un écran, et que le langage poétique permet de percer ce voile, d’approcher des vérités intérieures, indicibles.
En cela, elle continue de parler à nos sensibilités modernes. Dans un monde empreint d’informations, de discours techniques, de mots et expressions en tous genres, la poésie symboliste offre un espace de retrait, d’écoute, de lenteur. Elle nous apprend à voir autrement, à entendre ce qui murmure dans l’ombre.