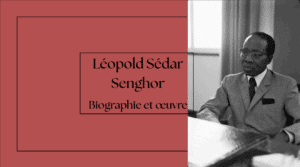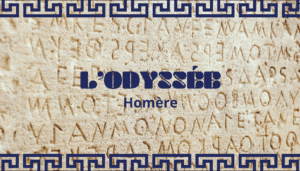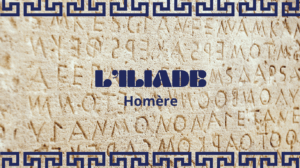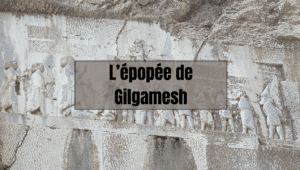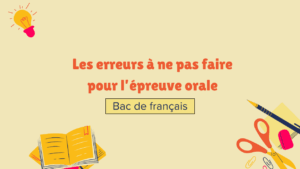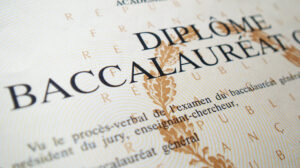Emile Zola est un écrivain, journaliste et critique d’art qui appartenait au mouvement naturaliste. Ses écrits et ses productions en général, hyper réalistes et noirs, défrayèrent la chronique. Tout au long de sa vie, il ne cessera de faire scandale avec ses oeuvres, discours et articles profondément réalistes et engagés.
Sa vie en quelques mots
Emile Zola, fils d’un père italien et d’une mère française, a principalement été élevé par sa mère. Son père meurt de pneumonie à ses sept ans alors que sa société de travaux publics est en train de couler. Sa mère et sa grand-mère l’élèveront à Paris, seules et dans des conditions plutôt précaires. Il effectue son collège à Aix-en-Provence où il rencontre Paul Cézanne et Jean-Baptiste Baille. C’est à cette époque que naît en lui la vocation de l’écrivain.
En 1858, Emile Zola rejoint sa famille à Paris et tente de se faire connaître en tant qu’écrivain. Ses inspirations se multiplient : les écrits humanistes, Jules Michelet et Balzac plus tard. Il développe peu à peu une fascination pour la peinture, notamment impressionniste. Il fait la rencontre de Manet, de Mallarmé, de Renoir et d’autres. C’est en 1862 qu’il parvient finalement, malgré son absence de qualifications (il n’a pas son baccalauréat), à entrer dans le monde de l’édition dans la librairie Hachette. Il y est commis. Dans cette librairie, il acquerra des traits de ses prochaines oeuvres : le positivisme et l’anticléricalisme.
Il travaille beaucoup afin d’apprendre toutes les ficelles du métier d’écrivain et publie son premier roman, Les Contes à Ninon, en 1864. Il se fera peu à peu connaître en publiant régulièrement des articles de critiques littéraires et artistiques. Il commence ensuite à publier des chroniques dans le journal “L’Evénement” et “L’Illustration”. De fait, la presse a eu un rôle fondamental dans la carrière littéraire d’Emile Zola : tous ses articles y ont été publiés, ainsi que ses romans d’abord sous forme de feuilletons. Se premières oeuvres appartiennent plutôt au courant réaliste, romantique, puis il dérive vers le naturalisme.
Une des caractéristiques d’Emile Zola et de sa production est son ton polémique et critique. C’était un écrivain et un journaliste engagé, prêt à lutter pour ses idées et ses convictions. Il fera par exemple des satires anti-impérialistes dans le journal “La Tribune” à la fin des années 1880. Lors de la chute de l’Empire napoléonien et de la constitution de la Commune, il sera inquiété mais s’en sortira indemne.
C’est à partir de 1868 que l’écrivain fera les rencontres décisives pour la production de ses romans. Il rencontre les frères Goncourt, Gustave Flaubert, Alphonse Daudet, Ivan Tourgueniev, Guy de Maupassant… C’est une période qu’il n’oubliera jamais, la dynamique de travail étant exceptionnelle entre ces auteurs. 1868 est aussi l’année où il élabore son projet du cycle des Rougon-Macquarts. Dans ces années-là, Emile Zola publie en moyenne un roman par an, des articles de journaux et quelques pièces de théâtre.
Le cycle qu’il a démarré représente un travail colossal, Zola voulant représenter la société toute entière dans ses oeuvres. Il est à ce moment-là le maître incontesté du courant naturaliste qui tend à représenter l’humain et son existence telles qu’ils sont. Ses oeuvres, en plus de cette portée encyclopédique, ont un message politique et satirique. Enfin, en plus de son engagement dans ses oeuvres naturalistes, l’auteur est engagé en politique, notamment contre l’affaire Dreyfus. Son article “J’accuse” (13 janvier 1898), construit sous la forme d’une lettre ouverte au Président de la République M. Félix Faure, lui vaudra des démêlées avec la justice et un exil en Angleterre.
Pour finir, ce que l’on retiendra d’Emile Zola est tout d’abord sa posture engagée, tant dans ses écrits qu’en politique. Ensuite, il fut le chef de file du réalisme puis du naturalisme. Enfin, cet homme acharné de travail a produit une quantité impressionnante d’oeuvres, dans le cadre de cycles ou non, qui étaient vouées à un objectif démiurgique et totalisant : peindre la totalité de la société de son temps.
Lire aussi : Marguerite Donnadieu, dite Marguerite Duras (1914-1996)
Les oeuvres majeures d’Emile Zola
Parmi les nombreuses oeuvres d’Emile Zola, nous pouvons citer Le Roman expérimental (1880), la lettre ouverte “J’accuse…!” contre l’affaire Dreyfus en 1898, Thérèse Raquin (1867), et le cycle des Rougon-Macquarts parmi lequel figurent ses plus fameux romans (La Curée en 1872, Le Ventre de Paris en 1873, L’Assommoir en 1878, et d’autres).
Thérèse Raquin (1867)
Thérèse Raquin est un roman naturaliste écrit par Émile Zola et publié en 1867. L’histoire se déroule dans le Paris du XIXe siècle et raconte l’histoire tragique de Thérèse Raquin, une jeune femme malheureuse dans son mariage, qui tombe amoureuse de Laurent, l’ami de son mari.
Les deux amants décident de tuer le mari de Thérèse pour pouvoir vivre leur amour librement. Cependant, leur crime ne les mène qu’à une vie de remords et de souffrance, car ils sont hantés par la mémoire de leur acte.
Thérèse Raquin est considéré comme un chef-d’œuvre du mouvement naturaliste, qui prônait une littérature scientifique et objective, mettant en évidence les aspects les plus sombres de la condition humaine. Zola y décrit avec précision et minutie les personnages et leur environnement, en s’appuyant sur des observations et des analyses de données.
Le roman a été adapté plusieurs fois pour le théâtre et le cinéma, et il reste aujourd’hui l’une des œuvres les plus célèbres d’Émile Zola. Thérèse Raquin est également considéré comme l’un des romans les plus sombres et les plus pessimistes de l’écrivain, qui explore les limites de la morale et de la culpabilité humaines.
Le Roman expérimental (1880)
Le Roman expérimental est un essai écrit par l’écrivain français Émile Zola en 1880. Il s’agit d’un texte dans lequel Zola développe une théorie littéraire visant à renouveler le roman en y intégrant les idées du positivisme et de la science.
Selon Zola, le roman devrait être un laboratoire dans lequel l’écrivain mène des expériences pour découvrir les lois qui régissent le comportement humain. Il préconise une approche scientifique de la littérature, en utilisant des observations et des analyses de données pour décrire le monde réel et les comportements humains.
Dans Le Roman expérimental, Zola propose également l’idée que l’hérédité et l’environnement ont une influence sur la personnalité et le comportement des personnages. Il s’oppose ainsi à la tradition romanesque qui avait pour habitude de décrire les personnages comme des êtres exceptionnels, à part des autres.
Cet essai a suscité de nombreuses réactions, parfois violentes, à l’époque de sa publication. Zola était en effet considéré comme un provocateur, en raison de son style réaliste et naturaliste qui dépeignait souvent la société sous un jour peu flatteur. Cependant, son travail a contribué à l’évolution de la littérature et a ouvert la voie à de nouvelles formes d’écriture, qui ont influencé de nombreux écrivains à travers le monde.
Lire aussi : Françoise Quoirez, dite Françoise Sagan (1935-2004)
Le cycle des Rougon-Macquarts (1871-1893)
Les Rougon-Macquarts est un cycle formé de vingt romans naturalistes. Il est sous-titré “Histoire Naturelle et Sociale d’une famille sous le Second Empire”. Ces romans forment un portrait panoramique de la société française sous le Second Empire à travers le récit des trajectoires de vie d’une famille, les Rougon-Macquart. Au fil des romans, différentes générations se succèdent. Ce cycle a été la plus grande oeuvre d’Emile Zola, un travail colossal qui lui a pris 22 ans.
Largement inspiré de La Comédie Humaine de Balzac, les Rougon-Macquarts prétend étudier l’influence du milieu sur l’Homme, sur ses qualités et ses défauts. Il étudie aussi les tares héréditaires de la famille Rougon-Macquarts à titre exemplaire de la société française sous le Second Empire. Zola, avec ce cycle, cherche à rendre cette société de manière exhaustive. Il adopte une posture démiurgique, totalisatrice.
Entre 1871 et 1893, se succèdent vingt romans parmi lesquels figurent les oeuvres les plus connues d’Emile Zola : le cycle démarre avec La Fortune des Rougon, puis La Curée, Le Ventre de Paris, en passant par L’Assommoir, Nana, Germinal, L’Oeuvre, La Bête Humaine et Le Docteur Pascal (qui clôt le cycle). Les romans forment des unités indépendantes, bien que pour comprendre la complexité des intrigues il soit préférable de les lire tous dans l’ordre de publication. Chaque oeuvre est centrée sur un ou plusieurs personnages et quatres générations se succèdent entre 1871 et 1893.
La Fortune de Rougon introduit les personnages principaux du cycle, les points de départs de la trajectoire des membres de cette famille (comme Adélaïde Fouque par exemple). Y sont présentes les trois premières générations du cycle. Ce roman explore les couches basses de la société, les pauvres gens atteints de tares (Adélaïde est qualifiée de “cerveau fêlé”) et les jeunes idéalistes. Les romans à venir explorent tous différentes couches et classes de la société : les riches bourgeois, les courtisans, les pauvres gens de Paris, les prostituées (Nana), les estropiés, les artistes (L’Oeuvre) etc. Les espaces eux-même sont très diversifiés : le cadre rural (exemple : L’Assommoir), la province ainsi que les grandes villes comme Paris (exemple : L’Oeuvre) avec leurs paysages très diversifiés en leur sein (les beaux appartements, les rues pavées, les rues crasseuses où règne la pauvreté, les grands magasins etc).
C’est en ce sens que nous pouvons dire que les Rougon-Macquarts est une peinture de la société sous le Second Empire. Zola accomplit ici un travail de cartographie et de recensement romanesque de la société française sous le Second Empire. Avec un style à la fois transparent, documentaire et recherché en terme d’esthétique et de vocabulaire, l’auteur parvient à peindre avec justesse et poésie la société qui l’entoure.
Lire aussi : Sidonie-Gabrielle Colette, dite Colette (1873-1954)
“J’accuse…!” (13 janvier 1898) – article de journal, lettre ouverte
L’analyse de cet article de journal présenté sous la forme d’une lettre ouverte, me semble très importante pour saisir la spécificité des écrits d’Emile Zola. En effet, l’article “J’accuse…!” publié dans le cadre de l’affaire Dreyfus et du procès qui en a découlé condense bien des caractéristiques du style d’écriture de Zola.
Tout d’abord, cet article est particulièrement critique, polémique et satirique. Dans cette lettre ouverte, l’auteur dénonce l’antisémitisme de l’armée française et de certains acteurs politiques et judiciaires. Il met en évidence le fait qu’on a piégé le soldat Dreyfus pour le faire accuser de trahison pour la seule et unique raison qu’il était juif. Il ne prend pas la peine de maquiller les noms qu’il donne, il dévoile au grand jour sa version des faits et la manipulation d’informations et de preuves par un des supérieurs du soldat Dreyfus. Son engagement est évident. Et cet engagement est d’autant plus dangereux que des hautes personnalités de l’armée et du gouvernement ont trempé dans les magouilles qu’il évoque.
Pourtant, l’aspect polémique du Zola journaliste n’est pas la seule chose à révéler dans cette lettre ouverte. Il nous faut aussi signaler le caractère écrit et littéraire de l’article. L’écrivain use d’un ton pathétique, tragique et démontre une recherche esthétique dans le choix des termes et des formulations de phrases. Il met en réalité le style au service du message critique et polémique de l’article. L’association d’un style journalistique dans le cadre du récit des faits et d’un style plus littéraire à la fois esthétique et poignant donne du poids aux mots. De fait, Emile Zola utilise cette même méthode dans ses romans naturalistes tels que Le Ventre de Paris (1873). Cette lettre ouverte, bien qu’étant un article de journal, condense ainsi les traits caractéristiques de l’écriture et de la posture de Zola.
Découvre également notre portrait sur la vie et les œuvres de Victor Hugo.