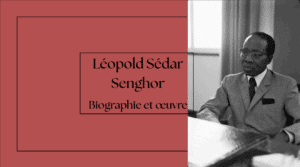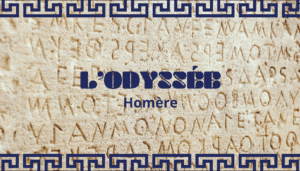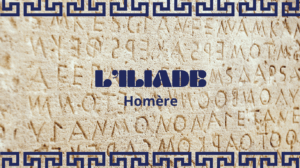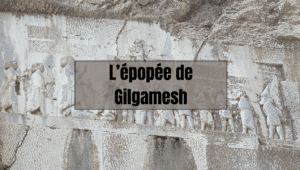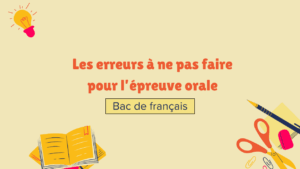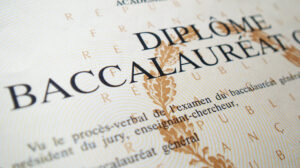Dans cet article, nous faisons le point avec toi sur la métaphore, une figure de style que tu croises bien plus souvent que tu ne le penses.
Avec son nom un peu barbare à première vue, la métaphore n’est pas toujours simple à saisir et pourtant, tu comprendras très vite qu’elle est omniprésente dans la littérature, que ce soit dans la poésie, au théâtre ou encore dans les romans. C’est pourquoi il est nécessaire de savoir l’identifier et de comprendre son utilisation.
Qu’est-ce qu’une métaphore ? Définition et explications
Avant d’aller plus loin, un petit point vocabulaire s’impose. Une métaphore, késako ? Il s’agit d’une figure de style qui consiste à employer un mot ou un groupe de mots pour désigner un autre terme, ou bien même une idée. L’étymologie du mot métaphore est à ce titre intéressante : metaphora signifie « transport » en latin.
La différence avec la comparaison ? Ces deux figures de style, si elles paraissent similaires, ne le sont pas attention. La comparaison utilise un outil comparatif (tel que, comme, similaire à, etc.), alors que la métaphore n’en utilise pas. Les deux termes sont ainsi liés l’un à l’autre par un effet d’analogie : ils se ressemblent ou l’un évoque l’autre. Une métaphore peut porter sur un nom, un verbe ou un adjectif.
Maintenant que tu en sais un peu plus sur la définition de la métaphore, n’attendons plus et rentrons dans le vif du sujet ! Utilisation, formes, exemples, etc. Nous passons la métaphore au peigne fin !
L’emploi de la métaphore dans la littérature
Commençons par un exemple simple : « Vous êtes mon lion superbe et généreux », dit dona Sol à Hernani dans la pièce éponyme de Victor Hugo. Ici, le mot « lion » désigne Hernani, il s’agit donc d’une métaphore qui permet de mettre en valeur le courage du personnage.
Une métaphore sert toujours à révéler un aspect, un trait de personnalité ou une caractéristique de ce qu’il désigne. Cet aspect peut être positif, mais également négatif.
Prenons cet exemple : « Quel vieil ours mal léché tu fais ! » peut être utilisé pour se moquer d’une personne.
La métaphore doit donc faire passer au lecteur une forte impression.
Quelles différences entre la métaphore et la comparaison ?
La métaphore et la comparaison ont deux éléments en commun : le comparé et le comparant.
Tout d’abord, le comparé est le terme que l’on veut désigner métaphoriquement. Ensuite, le comparant est, au contraire, le terme qui sert à désigner l’autre.
Dans la métaphore suivante : « Les yeux sont le miroir de l’âme », « les yeux » est le comparé, « le miroir de l’âme » est le comparant.
👉🏻 Comparaison et métaphore sont deux figures de style différentes (même si elles peuvent paraître très similaires !). À la différence de la métaphore, la comparaison lie le comparé et le comparant par un outil de comparaison, tel que « comme, autant que, tel que, etc. ». Tu l’auras compris, la métaphore est une comparaison sans outil de comparaison explicite.
Comment reconnaître une métaphore ?
Comme déjà dit, la métaphore est une comparaison implicite (autrement dit, « cachée ») entre deux parties d’une phrase. Elle est donc plus difficile à repérer qu’une comparaison. C’est pourquoi, le team AuFutur te donne deux/trois astuces pour la repérer facilement.
- Ne cherche pas de mots de comparaison dans la phrase (comme, tel que, semblable à, etc.), il n’y en a pas. C’est d’ailleurs pour ça qu’on précise bien que la métaphore est implicite (à l’inverse de la comparaison qui est explicite). En gros, la métaphore, c’est comme la comparaison, mais sans l’élément de comparaison !
- Repère le « langage figuré ». La plupart du temps, la métaphore exprime une idée d’une manière imagée. Si tu arrives à te dessiner la phrase dans la tête, c’est bon signe. La métaphore s’appuie sur des images.
- Ne cherche pas forcément de cohérence. En littérature, le non-sens est monnaie courante alors ne cherche pas forcément à comprendre où l’auteur a voulu en venir. Tente juste de discerner une mise en rapprochement entre deux éléments distincts
Les différents types de métaphore
On peut différencier plusieurs types de métaphore, selon l’impression qu’elles servent à donner.
- Les métaphores animalières : elles utilisent un animal pour décrire un être humain (être un âne, faire une tête de chien battu) ;
- Les métaphores qui utilisent des qualités inanimées ou des éléments naturels à des êtres animés : une voix de crécelle, un rire cristallin ;
- Les métaphores utilisant des associations d’idées : être pétrifié par la peur, avoir le cœur brisé.
Métaphore filée : définition et exemple
Tu as peut-être déjà entendu parler de métaphore filée, en poésie notamment. Une métaphore filée est une métaphore qui se poursuit le long d’un texte, en reprenant le même thème.
En voici un exemple, développé par Jean Anouilh dans Antigone. Nous avons sous les yeux la tirade de Créon :
« Mais, bon Dieu ! Essaie de comprendre une minute, toi aussi, petite idiote ! J’ai bien essayé de te comprendre, moi. Il faut pourtant qu’il y en ait qui disent oui. Il faut pourtant qu’il y en ait qui mènent la barque. Cela prend de l’eau de toutes parts, c’est plein de crimes, de bêtise, de misère…et le gouvernail est là qui ballottent. L’équipage ne veut plus rien faire, il ne pense qu’à piller la cale et les officiers sont déjà en train de se construire un petit radeau confortable, rien que pour eux, avec toute la provision d’eau douce pour tirer au moins leurs os de là. Et le mât qui craque, et le vent siffle et les voiles vont se déchirer, et toutes ces brutes vont crever toutes ensemble, parce qu’elles ne pensent qu’à leur peau, à leur précieuse peau et à leurs petites affaires. Crois-tu, alors, qu’on a le temps de faire le raffiné, de savoir s’il faut dire « oui » ou « non », de se demander s’il ne faudra pas payer trop cher un jour et si on pourra encore être un homme après ? On prend le bout de bois, on redresse devant la montagne d’eau, on gueule un ordre et on tire dans le tas, sur le premier qui s’avance. Dans le tas ! Cela n’a pas nom. C’est comme la vague qui vient de s’abattre sur le pont devant vous ; le vent qui vous gifle, et la chose qui tombe dans le groupe n’a pas de nom. C’est peut-être celui qui t’avait donné du feu en souriant la veille. Il n’a pas de nom. Et toi non plus, tu n’as plus de nom, cramponné à la barre. Il n’y a plus que le bateau qui ait un nom et la tempête. Est-ce que tu le comprends, cela ? »
Il s’agit ici d’une métaphore filée qui reprend un champ lexical maritime. En effet, l’équipage désigne ainsi le gouvernement, le bateau désigne la nation et la tempête les remous politiques auxquels le peuple d’Athènes est confronté. Une métaphore filée renforce donc l’impression faite sur le lecteur, et fait appel à son imagination.
La métaphore dans la littérature
La métaphore est une figure de style très répandue dans la littérature. On la retrouve d’ailleurs dans les romans d’amour courtois du Moyen-Âge, elle permet de flatter la dame, dans le surréalisme, qui fait appel aux associations d’idées, mais également dans le mouvement de la préciosité (dont La Princesse de Clèves fait partie). En effet, visant à embellir la langue française, ce courant littéraire du XVIIe siècle défend un raffinement du langage qui passe notamment par la métaphore. Les précieuses parlent ainsi du « conseiller des grâces » pour désigner un miroir, ou des « commodités de la conversation » pour évoquer les fauteuils.
Exemples célèbres de métaphores
Exemples célèbres métaphores dans la littérature française
Maintenant que les métaphores n’ont plus aucun secret pour toi, laisse-nous te présenter les plus célèbres de la littérature française !
« Le temps n’a point de rive/ Il vole », Le lac, Lamartine
« C’est un trou de verdure où chante une rivière », Le dormeur du val, Rimbaud
« La vie est un voyage plein d’aventures », Baudelaire
« Ma valise m’accompagne au massif de la Vanoise , et déjà ses nickels brillent et son cuir épais embaume. Je l’empaume , je lui flatte le dos, l’encolure et le plat. » La valise, Ponge
Exemples célèbres métaphores dans la musique française
Peut-être qu’avec ces quelques exemples, tu arriveras à mieux reconnaître une métaphore filée (l’image perdure tout au long de la phrase) :
Exemples de métaphores filées dans des musiques de variété
👉🏻 « Elle a les yeux révolver, elle a le regard qui tue, elle a tiré la première m’a touché c’est foutu » dans « Les yeux revolver » de Marc Lavoine
👉🏻 « Comme un volcan devenu vieux, mon cœur bat lentement la chamade, la lave tiède de tes yeux coule dans mes veines malades » dans « Le Cœur volcan » de Julien Clerc
👉🏻 « Dix ans de chaîne sans voir le jour c’était ma peine forçat de l’amour / J’ai refusé mourir d’amour enchaîné » dans « Gabrielle » de Johnny Hallyday
Exemples de métaphores dans des musiques de rap
- « Dans le rap j’écris et produis, j’suis chauffeur, livreur » dans « Numéro 10 » de Booba
- « Le ciel pleure, les nuages sont ses mouchoirs » dans « Banlieusards » de Kery James
- « Dans ma tête y’a un zoo, j’suis l’tigre qui s’balade » dans « Le poids d’un gravillon » de Disiz
- « La vie est une cour d’école immense » dans « Lucy » de Lomepal
- « Le monde est un PMU » dans « SAN » d’Orelsan
Exercice sur la métaphore – Figure de style incontournable
Exercice 1 – Métaphore
Pour t’entraîner, on te laisse avec quelques phrases. À toi de reconnaître s’il s’agit ici d’une métaphore, d’une métaphore filée ou d’une comparaison. 3,2,1 à toi de jouer !
- « Le temps est un voleur qui emporte nos souvenirs. »
- « La nuit était calme comme mon chat. »
- « Ses paroles étaient comme des flèches qu’on me lance droit au cœur.»
- « Ses yeux sont des phares qui brillent en pleine nuit. »
- « Tel un hibou, cette fille ne dort jamais la nuit.»
- « Tes cheveux sont doux comme la soie. »
- « Son rire est ma chanson préférée. »
- « Le monde est une jungle. »
- « Sa voix est si douce qu’elle est semblable a du miel. »
- « Mon cœur est un océan de tristesse. »
- « La ville était un océan de lumières. »
- « T’as un cœur de pierre. »
Réponses – Métaphore
- Métaphore
- Comparaison
- Comparaison
- Métaphore
- Comparaison
- Comparaison
- Métaphore
- Comparaison
- Comparaison
- Métaphore
- Métaphore
- Métaphore
FAQ : La Métaphore
Qu’est-ce qu’une métaphore ?
Une métaphore est une figure de style qui consiste à désigner une chose par une autre, en établissant une comparaison implicite. Contrairement à la comparaison, la métaphore n’utilise pas de mot de comparaison comme “comme” ou “tel”. Exemple : “Cet homme est un lion” (l’homme est comparé à un lion, mais sans utiliser le mot “comme”).
Quelle est la différence entre une métaphore et une comparaison ?
La principale différence réside dans l’utilisation ou non d’un mot de comparaison. Dans une comparaison, on utilise des termes comme “comme”, “tel”, “pareil à”, etc. Exemple : “Elle est douce comme une plume”. En revanche, une métaphore n’utilise pas de mot de comparaison et se base sur une assimilation directe. Exemple : “Elle est une plume”.
Pourquoi utilise-t-on des métaphores ?
Les métaphores sont utilisées pour rendre un discours plus imagé, plus poétique, ou plus percutant. Elles permettent d’exprimer une idée de manière plus originale, de créer des images mentales fortes, et d’ajouter de la profondeur au langage.
Peut-on trouver des métaphores dans la vie quotidienne ?
Oui, les métaphores sont courantes dans le langage quotidien. Par exemple, on peut dire “Il a le cœur sur la main” pour signifier qu’une personne est généreuse, ou “Cette situation est un véritable champ de mines” pour décrire un contexte délicat et dangereux.
Donne-moi un exemple de métaphore célèbre ?
Un exemple célèbre de métaphore vient de William Shakespeare dans sa pièce “Comme il vous plaira” : “Le monde est un théâtre, et les hommes et les femmes ne sont que des acteurs.” Ici, le monde est comparé à un théâtre, et les individus à des acteurs, créant une image puissante de la vie humaine.