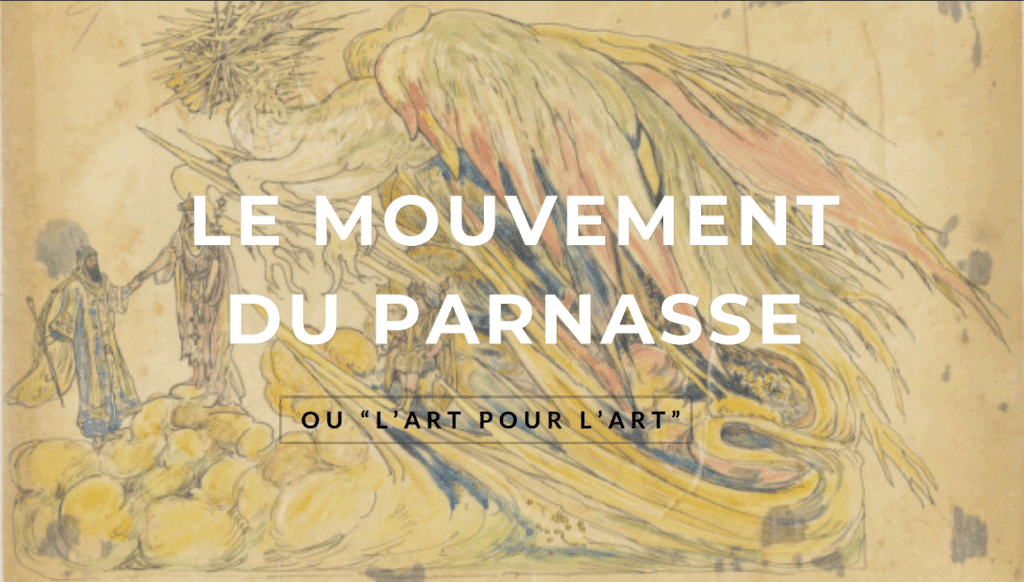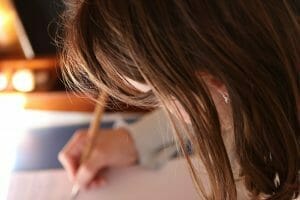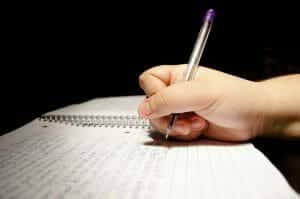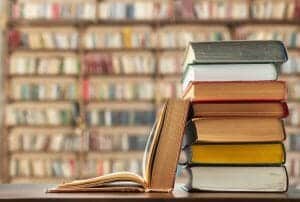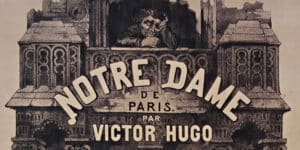Le mouvement littéraire et artistique du Parnasse est souvent évoqué mais parfois insuffisamment étudié dans le cadre des cours de lettres ou d’Histoire. Pourtant, celui-ci mérite de s’y intéresser en raison de sa richesse et sa diversité. Nous te proposons donc dans cet article de te présenter ce courant, en abordant le contexte historique dans lequel il émerge, ses grandes figures et son intérêt.
🎨 Ce qu’il faut retenir sur le mouvement du Parnasse
- Contexte : Le Parnasse apparaît dans la seconde moitié du XIXᵉ siècle, en réaction au lyrisme romantique et à la poésie engagée.
- Principe fondateur : Culte du beau pour le beau, sans but moral, politique ou social. L’art se suffit à lui-même.
- Esthétique : Impersonnalité, rigueur formelle, travail minutieux du vers (préférence pour le sonnet et l’alexandrin), descriptions précises et universelles.
- Thèmes privilégiés : Antiquité, Orient, nature décrite avec objectivité, histoire de l’art. Rejet de l’actualité et de l’intime.
- Figures majeures : Leconte de Lisle, Théophile Gautier, Théodore de Banville, José-Maria de Heredia, Sully Prudhomme, Catulle Mendès, François Coppée.
- Critiques : Mouvement jugé parfois froid et désengagé, surtout après les événements de 1870.
- Héritage : Influence durable sur les symbolistes (Verlaine, Mallarmé), les formalistes et les poètes attachés à la maîtrise technique.
Le Parnasse : un mouvement né d’une réaction face au tumulte romantique
Lorsque la seconde moitié du XIXᵉ siècle s’ouvre, la littérature française porte encore l’empreinte des grandes voix romantiques. Victor Hugo poursuit son œuvre depuis son exil, tandis qu’Alphonse de Lamartine et Musset élaborent une poésie fidèle à ce courant.
Pourtant, peu à peu, une génération de poètes se lasse de l’emphase pathétique, du « je » omniprésent et du militantisme lyrique. Dans les cafés littéraires, puis dans les bureaux de l’éditeur Alphonse Lemerre, naît alors un idéal neuf : hisser la poésie à la hauteur du marbre, froide, parfaite, éternelle, indifférente à l’agitation du siècle. C’est cette exigence d’un art conçu pour sa seule beauté – un « art pour l’art » théorisé par Théophile Gautier – qui donne son nom et sa cohérence au Parnasse, ainsi baptisé en hommage à la montagne sacrée des Muses.
Porté par trois livraisons successives du Parnasse contemporain (1866, 1871, 1876), ce courant bouleverse la conception même du poète : l’inspiration devient travail, le cri devient sculpture, la sensibilité cède le pas à la forme ; et la postérité, fascinée ou rétive, retiendra ce moment où la beauté se voulut plus forte que la passion.
Genèse d’un mouvement : contexte historique et naissance éditoriale
La France des années 1850-1870 traverse des mutations politiques incessantes – chute de la monarchie de Juillet, Seconde République, Second Empire, puis déflagrations de 1870. Dans ce fracas, les écrivains s’interrogent : faut-il chanter la tourmente ou, au contraire, protéger la littérature et plus largement l’art, de la fièvre de l’Histoire ? Ceux qui seront bientôt appelés parnassiens optent résolument pour la seconde voie. C’est autour des Réunions littéraires du lundi chez Leconte de Lisle puis, surtout, autour d’Alphonse Lemerre que se cristallise l’idée d’un volume collectif susceptible d’imposer un canon esthétique intransigeant.
Le premier Parnasse contemporain paraît à l’automne 1866. Le tirage est modeste, mais l’impact immédiat : le public découvre une constellation de signatures – Gautier, Banville, Leconte de Lisle, Sully Prudhomme, Catulle Mendès, Coppée – unies par la même ambition formelle. Deux autres séries, publiées en 1871 et 1876, parachèvent la renommée du groupe et fixent le mot « parnassien », déjà employé par quelques chroniqueurs facétieux, comme un terme générique. En moins de dix ans, le Parnasse est devenu plus qu’une anthologie : un mot d’ordre, une posture, une marque de fabrique.
Fondement esthétique : le culte du beau dans le Parnasse
Au cœur de la doctrine parnassienne réside la formule lapidaire de Théophile Gautier : « Il n’y a de vraiment beau que ce qui ne peut servir à rien ; tout ce qui est utile est laid ». Par-là se dessine une conception presque sacrée de l’œuvre d’art, affranchie de toute finalité morale, sociale ou politique. Le poète, en conséquence, devient artisan : tel le sculpteur qui polit son bloc inlassablement, il lime, cisèle, sculpte – injonction récurrente dans les textes théoriques du groupe.
L’impersonnalité est l’autre pilier du programme. Contre le lyrisme débridé, les parnassiens prônent une diction objective ; la première personne s’efface, le poème se fait tableau ou bas-relief. Cette impassibilité, loin d’être froideur, vise à l’universalité : si le moi se retire, la beauté, elle, subsiste, souveraine. Cette ambition explique la préférence accordée aux formes fixes (sonnet, sextine, ballade) et aux vers strictement scandidés – souvent l’alexandrin classique. Le vers devient alors un moule, et la virtuosité consiste à épouser sa rigueur tout en trouvant un timbre personnel.
Enfin, les parnassiens cultivent le culte du travail. On se plaît à rappeler la vignette « Fac et spera » – « Agis et espère » – affichée chez Lemerre et représentant un paysan penché sur son sillon : image d’une poésie qui serait, elle aussi, un long labour de la langue. La spontanéité romantique laisse place à la patience du joaillier.
Le Parnasse : des thèmes à distance du présent
Parce qu’ils refusent l’actualité et la plainte intime, les parnassiens cherchent des matières poétiques qui les tiennent à l’écart du fracas contemporain. L’Antiquité, magnifiée par Leconte de Lisle dans Poèmes antiques (1852) puis dans Poèmes barbares (1862), leur offre un réservoir d’images monumentales : marbres polis, dieux hiératiques, gestes héroïques. L’Orient et son imaginaire sensuel prolongent ce dépaysement ; Heredia, plus tard, consacrera nombre de ses sonnets à la splendeur des conquistadors ou aux fastes de l’Inde moghole.
La nature, chez eux, n’est jamais le miroir du sentiment, mais l’occasion d’une description précise, presque scientifique. Dans « Le rêve du jaguar », Leconte de Lisle détaille le pelage et la musculature avec la minutie d’un naturaliste. De même, lorsque Banville évoque un soleil couchant, il s’attache moins à la mélancolie du poète qu’aux couleurs pures, aux lignes nettes, à la géométrie du ciel.
L’histoire de l’art inspire également les Parnassiens. Dans les vers d’Heredia ou de Mendès, un temple grec, une statue de Phidias, un vase étrusque deviennent prétextes à célébrer la perfection technique du passé ; ils rappellent au lecteur que tout chef-d’œuvre résulte d’un labeur réglé, non d’une effusion.
Portraits de figures majeures du Parnasse
Théophile Gautier (1811-1872)
Déjà célèbre pour Émaux et Camées (1852), Gautier n’appartient pas strictement à la génération du Parnasse, mais il en fournit la charpente théorique. À ses yeux, la poésie doit être un bijou parfaitement serti, « une fleur rare dont la tige serait de cristal ». Son influence se mesure à l’omniprésence de sa devise dans les préfaces et les manifestes du groupe.
Leconte de Lisle (1818-1894)
Poète réunionnais d’origine, traducteur de l’Iliade, Leconte de Lisle devient rapidement la figure tutélaire. Sa diction ample, ses alexandrins impeccablement balancés, ses références savantes incarnent l’idéal d’objectivité. Chez lui, la Grèce archaïque, l’Orient sauvage ou les bêtes de la jungle se déploient dans la même lumière crue, indifférente à la pitié.
Théodore de Banville (1823-1891)
Moins solennel, Banville célèbre la virtuosité pour elle-même. Ses Odes funambulesques (1857) défient la versification par un jeu constant sur les rimes riches et les mètres rares. Sa gaieté, sa faconde, son sens de la pirouette introduisent un contre-poids charmant à la gravité lisléenne.
Sully Prudhomme, Catulle Mendès, François Coppée
Sully Prudhomme, premier prix Nobel de littérature (1901), apporte à la troupe un accent méditatif ; Mendès, lui, cultive l’exotisme flamboyant ; Coppée, enfin, adopte un réalisme sage qui annonce ses futurs succès populaires. Tous participent à l’archipel parnassien, chacun illustrant à sa manière la suprématie de la forme.
José-Maria de Heredia (1842-1905)
Avec Les Trophées (1893), Heredia propose quatre-vingt-dix-neuf sonnets que Stéphane Mallarmé saluera comme « diamants sculptés par la flamme ». Chacun est un tableau historique condensé ; en quatorze vers, le poète fait luire un empire, une bataille, une ruine, avant de clore sur un flamboiement d’images. L’exploit réside dans la densité : aucun adjectif n’est superflu, aucun enjambement lâche ; le sens même semble se plier aux contraintes du carcan métrique.
Réception et critiques du Parnasse
Dès 1866, la presse se divise. Les défenseurs, tel Barbey d’Aurevilly, louent la « pureté de ligne » et l’érudition des poèmes. Les détracteurs, en revanche, moquent un art « réfrigéré », « à force de fuir la vie, exsangue ». On reproche aux Parnassiens de confondre beauté et froideur, perfection et stérilité.
Ces réserves s’intensifient après la guerre de 1870 ; la défaite, la Commune, la Troisième République appellent, croit-on, des voix engagées. Les poètes romantiques attardés et les naturalistes montants accusent le Parnasse d’indifférence sociale : comment célébrer ces œuvres dénuées de toute souffrance quand Paris brûle ?
Héritage et postérité du Parnasse
Malgré les satires, le legs du Parnasse demeure considérable. En redonnant à la prosodie (la musicalité des mots) son prestige, les parnassiens offrent aux symbolistes un instrument affûté : Verlaine, Mallarmé, Valéry méditent leurs leçons de ciselure avant de défaire la syntaxe à leur tour. Plus tard, l’avant-garde de la première moitié du XXᵉ siècle – les formalistes russes, le groupe Oulipo, dont Georges Pérec est une des figures de proue – reconnaît dans la devise « contraintes fécondes » un lointain écho parnassien.
Au XXᵉ siècle encore, alors que la poésie s’ouvre à la prose, au vers libre, à la performance, l’idéal d’un poème-objet, minutieusement poli, ne disparaît jamais complètement. Les recréations néo-classiques, de Claudel à Segalen, prouvent la vitalité d’un modèle où fond et forme se confondent dans une quête d’absolu.
Nous te proposons cet article mis en ligne par le site Lumni, qui te permettra de faire un récapitulatif de ces notions !
Ce que tu dois retenir sur Le Panasse
Le Parnasse, rarement enseigné sans présenter ce mouvement comme une simple « transition » ou « parenthèse » dans l’art, mérite que l’on mesure l’ampleur de son apport. En affirmant que l’œuvre d’art se justifie par son seul rayonnement, il libère la poésie de toute sujétion didactique ; en exigeant l’impersonnalité, il rompt avec le mythe romantique du génie souffrant ; en magnifiant la forme, il rappelle que la langue française n’est pas qu’un véhicule, mais une matière à sculpter, à « limer » jusqu’au scintillement. L’objectif est ainsi de mettre en avant la beauté, qui peut être sa propre raison, sans considération morale ou éthique aucune.