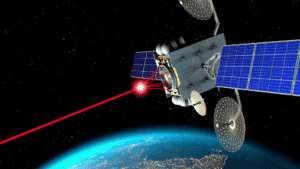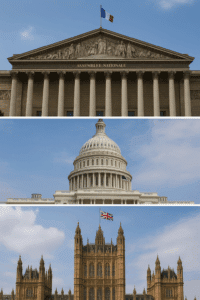Depuis plusieurs années, un paradoxe intrigue les analystes politiques : comment des pays organisant des élections régulières peuvent-ils, en parallèle, restreindre la liberté de la presse, affaiblir la justice et concentrer le pouvoir entre les mains d’un seul homme ? C’est pour décrire cette tension entre apparence démocratique et dérives autoritaires que le terme de démocratie illibérale a vu le jour. Popularisé à la fin des années 1990, il désigne des régimes où les institutions démocratiques existent formellement, mais où les libertés fondamentales sont remises en cause. Comment définir précisément cette notion ? Quels pays en sont les symboles aujourd’hui ? Et surtout, ces régimes constituent-ils une réelle menace pour les démocraties libérales traditionnelles ? Nous faisons le point dans cet article.
Concept et définition(s) de démocratie illibérale
Le terme démocratie illibérale a été formulé pour la première fois par Fareed Zakaria en 1997 dans un article de Foreign Affairs dans un contexte post-guerre froide : « De la démocratie illibérale ». Il y définit ce néologisme de la manière suivante : régime pluraliste qui organise des élections (apparence de démocratie) mais dans lequel l’indépendance de la justice, la liberté de la presse et plus généralement l’État de droit sont remis en cause. Autrement dit, ces régimes respectent la forme électorale de la démocratie, mais bafouent ses valeurs libérales. Ce paradoxe apparent soulève des interrogations majeures : ces régimes politiques constituent-ils une réelle menace pour les démocraties libérales traditionnelles ou s’agit-il d’un concept vague, difficile à cerner et potentiellement galvaudé ?
Contexte historique de l’apparition du terme démocratie illibérale
Dans les années 1990, lors de la période de la transition post-soviétique, plusieurs États issus de l’ancien bloc de l’URSS (Union des Républiques Socialistes soviétiques) adoptent formellement des constitutions démocratiques : la Slovaquie (Constitution de 1992), la Roumanie (Constitution en 1991) la Bulgarie (Constitution démocratique en 1991) ou encore les pays baltes (Estonie, Lettonie, Lituanie). Tous rétablissent ou adoptent des constitutions démocratiques dès leur indépendance (1991–1992). Ces textes reconnaissent le pluralisme politique, les libertés individuelles, la séparation des pouvoirs, et l’organisation d’élections libres.
Cependant, dans des pays comme la Russie, la Hongrie ou la Turquie, on assiste à une consolidation du pouvoir autour d’un homme fort, souvent par des moyens légaux, mais peu transparents ou délibérément restrictifs pour les contre-pouvoirs . Ces pays ont vu émerger des dirigeants concentrant progressivement le pouvoir entre leurs mains, souvent en contournant ou modifiant les institutions démocratiques.
Russie : Vladimir Poutine
- Arrivé au pouvoir comme Premier ministre en 1999, puis Président dès 2000.
- Il a renforcé l’exécutif, affaibli les gouverneurs régionaux, mis au pas les médias et la justice.
- Les réformes constitutionnelles (2020) lui permettent de rester potentiellement au pouvoir jusqu’en 2036.
- Il a réintroduit un autoritarisme puissant, tout en organisant des élections contrôlées.
Hongrie : Viktor Orbán
- Premier ministre entre 1998 et 2002, puis depuis 2010.
- Chef du parti Fidesz, il a instauré un régime illibéral, selon ses propres mots.
- Il a modifié la Constitution (2011), restreint l’indépendance des médias, de la justice et renforcé l’influence de l’exécutif.
- Contrôle des universités, durcissement contre les ONG et opposition.
Turquie : Recep Tayyip Erdoğan
- Premier ministre de 2003 à 2014, puis Président depuis 2014.
- D’abord élu démocratiquement, il a progressivement centralisé les pouvoirs, notamment après le référendum constitutionnel de 2017 qui transforme la Turquie en régime présidentiel.
- Arrestations massives après le coup d’État manqué de 2016, mise au pas des médias, de la justice, de l’armée.
- L’opposition est très affaiblie, bien que des élections continuent d’avoir lieu.
Des caractéristiques qui posent question sur la nature démocratique de ces régimes
Au vu des caractéristiques des démocraties illibérales que nous venons d’énumérer et d’étudier, n’est-il pas légitime de se demander à quel point les États qui peuvent être définis ou qui s’auto-définissent comme tels demeurent encore et toujours des démocraties ? En effet, il apparaît nécessaire de se demander si cette terminologie n’est pas un simple oxymore : peut-on être illibéral (au sens de négation de la démocratie libérale) et démocratique ?
A. Une démocratie uniquement électorale
Dans les démocraties illibérales, les élections sont organisées, parfois avec un taux de participation élevé. Toutefois, elles sont souvent truquées de manière subtile : redécoupage électoral, contrôle des médias, harcèlement de l’opposition, clientélisme. La Russie de Vladimir Poutine en est un exemple : les scrutins y sont réguliers, mais l’opposition politique y est muselée, la presse largement contrôlée, et la société civile affaiblie.
| « La démocratie illibérale ne met en place ni censure ni parti unique, mais elle assèche l’écosystème du pluralisme. » Sylvain Kahn et Jacques Lévy – Les pays des Européens, 2019 |
B. Atteintes à l’État de droit
Ces régimes fragilisent la séparation des pouvoirs, en mettant au pas le pouvoir judiciaire ou en marginalisant les parlements. Les cours constitutionnelles sont parfois remaniées pour être plus dociles, comme en Pologne où le parti Droit et Justice (PiS) a profondément modifié la composition du Tribunal constitutionnel. Le recul des libertés individuelles est également caractéristique : réduction de la liberté de la presse, lois restreignant la liberté de réunion ou d’association, censure sur les réseaux sociaux, etc.
B. Une rhétorique populiste et nationaliste
Les dirigeants illibéraux se présentent souvent comme les défenseurs du peuple face à des élites corrompues ou des institutions internationales trop intrusives (comme l’Union européenne ou la Cour européenne des droits de l’homme). Ils mobilisent une rhétorique identitaire et traditionaliste, comme en Hongrie (Orban) ou en Turquie (Erdogan), pour justifier des politiques autoritaires.
Aujourd’hui, existe-t-il des États que l’on pourrait qualifier comme tels ?
L’exemple hongrois semble être le plus emblématique. Le Premier ministre Viktor Orbán revendique ouvertement depuis 2014 une « démocratie illibérale », qu’il oppose au modèle libéral occidental, jugé décadent et inefficace. En effet, l’évolution de la politique intérieure hongroise a contribué à faire du pays une démocratie dite « illibérale » (selon l’expression utilisée dès 1997 par Fareed Zakaria) et a rapproché la Hongrie du narratif de Vladimir Poutine présentant la Russie comme le rempart contre les déviances et l’effondrement moral des sociétés occidentales. Dans le même sens, d’autres régimes correspondent en grande partie à la définition que nous avons formulée : la Pologne de Andrezj Duda ,le Brésil de Jair Bolsonaro, les USA de Donald Trump, l’Inde, Les Philippines, ou encore le Venezuela.
Ces démocraties illibérales représentent-elles une menace pour les démocraties libérales ?
A. L’exportation d’un modèle autoritaire
Ces régimes peuvent inspirer d’autres pays ou mouvements politiques. Le succès de la démocratie illibérale en Hongrie a servi de modèle à d’autres gouvernements en Europe centrale ou en Afrique, et a contribué à la crise de légitimité des institutions libérales.
En ce sens, la démocratie illibérale peut être vue comme une menace réelle : elle fragilise le consensus autour des valeurs démocratiques et offre une alternative séduisante pour les régimes autoritaires cherchant une façade électorale.
B. Le recul mondial de la démocratie
Selon les rapports annuels de Freedom House ou The Economist Intelligence Unit, le nombre de démocraties libérales est en recul depuis plus d’une décennie. La montée en puissance de régimes hybrides ou illibéraux participe de ce phénomène, que certains qualifient de récession démocratique.
Des pays considérés il y a peu comme des modèles démocratiques (comme l’Inde sous Modi ou le Brésil sous Bolsonaro) ont montré des tendances autoritaires préoccupantes. Cela pose la question de la résilience des démocraties libérales face aux logiques populistes et au rejet des institutions.
C. Le paradoxe européen : tolérance ou complaisance ?
L’Union européenne, fondée sur des principes démocratiques, est confrontée à une crise interne : certains de ses membres (Hongrie, Pologne) ne respectent plus les standards démocratiques tout en bénéficiant des subventions européennes.
Ce paradoxe soulève une interrogation : la démocratie illibérale est-elle tolérée par les démocraties libérales au nom du pluralisme, ou est-ce un cheval de Troie qui sape leurs fondements ? La lenteur de l’UE à sanctionner ces régimes montre la fragilité des mécanismes de défense des valeurs démocratiques.
Dans un article publié dans la revue Études (« Les démocraties illibérales en Europe centrale », 2019), Roman Krakovsky cherche à présenter les facteurs de la montée du populisme dans les PECO (Pays d’Europe Centrale et Orientale). Il montre que la cause n’est pas exclusivement économique et met en exergue différents facteurs, au premier rang desquels le facteur économique puisque la transition économique vers le modèle libéral a été rude (chômage, inégalités sociales, etc.) et a pu nourrir une déception vis-à-vis du modèle occidental.
Un concept flou et contesté ?
A. Des frontières mouvantes entre démocratie et autoritarisme
Certains politologues critiquent le terme même de démocratie illibérale, qu’ils jugent oxymorique, une interrogation que nous avons formulée dans la partie sur la remise en cause du caractère démocratique de ces régimes : si un régime ne respecte pas les libertés fondamentales, peut-on encore parler de démocratie, même avec des élections ?
Pour eux, le terme masque la réalité : il vaudrait mieux parler de régimes hybrides, autocraties électorales, ou autoritarismes compétitifs. La notion de démocratie illibérale risquerait alors de banaliser des pratiques antidémocratiques.
B. Une utilisation politique à géométrie variable
L’expression est parfois utilisée de manière idéologique pour discréditer des gouvernements conservateurs ou nationalistes, même s’ils restent dans le cadre démocratique. Cela contribue à flouter les frontières entre divergence politique et dérive autoritaire.
Ainsi, certains courants politiques accusent les critiques du libéralisme économique ou de l’intégration européenne d’être « illibéraux », alors qu’il peut s’agir de débats légitimes dans un cadre démocratique.
Conclusion
Le concept de démocratie illibérale met en lumière une tension croissante entre la légitimité électorale et le respect des droits fondamentaux. Si certaines pratiques politiques menacent clairement les fondements des démocraties libérales, la notion elle-même reste floue, souvent instrumentalisée et parfois contestée. Néanmoins, les faits sont là : dans de nombreux pays, les libertés reculent, les institutions s’affaiblissent et l’autoritarisme progresse sous couvert de légitimité populaire. Il appartient aux démocraties libérales de renforcer leurs valeurs, d’éduquer leurs citoyens et de défendre l’état de droit pour éviter que la démocratie ne devienne un simple décor.
Les démocraties illibérales sont des régimes politiques où des élections ont lieu, mais où les libertés fondamentales (presse, justice indépendante, pluralisme) sont limitées. Popularisé par Fareed Zakaria, ce concept s’applique notamment à des pays comme la Hongrie (Viktor Orbán), la Russie (Vladimir Poutine) ou la Turquie (Recep Tayyip Erdoğan). Ces régimes représentent une menace réelle pour les démocraties libérales, car ils fragilisent l’état de droit tout en gardant une façade démocratique. Toutefois, le terme est parfois jugé flou ou contradictoire, car il associe deux notions opposées.