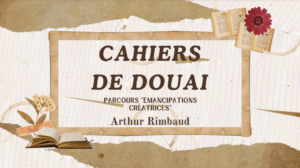Dans cet article, nous te proposons un résumé et une analyse de l’œuvre emblématique de François Rabelais, Gargantua, au programme du bac de français 2026.
À retenir sur Gargantua
- Auteur : François Rabelais (1534)
- Courant : Humanisme
- Thèmes : éducation, savoir, liberté, critique de la guerre
- Œuvre étudiée dans le cadre du bac de français
Célèbre pour avoir donné naissance à l’adjectif « gargantuesque », qui qualifie quelque chose de démesuré, le roman de François Rabelais, Gargantua, est une œuvre unique par bien des aspects. Humour, satire sociale, politique, etc. Autant de caractéristiques qui font de Gargantua un classique à lire absolument !
Pour optimiser tes révisions sur Gargantua, nous te recommandons également de jeter un œil à la vidéo ci-dessous.
Dates du bac de français 2026
L’épreuve écrite du bac de français aura lieu le jeudi 11 juin 2026. L’oral de français, quant à lui, se déroulera entre la fin du mois de juin et le début du mois de juillet prochain.
Le contexte de parution de Gargantua
Gargantua est le deuxième ouvrage de François Rabelais, qui propose au lecteur de suivre l’éducation du personnage éponyme (se dit d’un ouvrage qui prend le nom de son personnage principal), ses aventures et son développement. Gargantua, publié pour la première fois en 1535, raconte ainsi l’histoire du père de Pantagruel, en décrivant la naissance extraordinaire du géant, sorti par l’oreille gauche de sa mère après onze mois de grossesse. Il s’agit du deuxième livre de la série que Rabelais a écrite « La vie très horrifique du grand Gargantua, père de Pantagruel », après Pantagruel, publié en 1532.
Rabelais a publié Gargantua sous le même pseudonyme que Pantagruel : Alcofribas Nasier (anagramme de François Rabelais), « abstracteur de quinte essence ».
La biographie de François Rabelais
François Rabelais (1494-1553) est un des auteurs majeurs de la littérature d’idées et de l’humanisme du XVIe siècle. Rabelais, avant d’être écrivain, est d’abord moine. Il fréquente des écrivains et humanistes qui incarnent ce courant de pensée apparu à la Renaissance. Sa principale caractéristique ? Il fait la synthèse de l’héritage gréco-romain et chrétien en insistant sur les capacités intellectuelles humaines et non plus sur l’observation du monde compris comme création divine. En effet, cette époque se traduit par la redécouverte de la culture antique, notamment par le biais de l’imprimerie qui permet de diffuser plus facilement des textes.
Rabelais commence des études de médecine à l’université de Montpellier. Vieille de 800 ans, elle est déjà très renommée à l’époque où Rabelais la fréquente, en 1530. Il est nommé médecin à Lyon deux ans après, avant de suivre l’évêque de Paris, Jean du Bellay (grand-oncle du poète Joachim du Bellay) auprès du pape à Rome. C’est à cette époque qu’il entame la rédaction de son autre œuvre phare, Pantagruel, avant de se lancer dans la rédaction de Gargantua.
Les personnages principaux de Gargantua de Rabelais
Les personnages principaux de Gargantua
Avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit tour d’horizon des personnages principaux de Gargantua s’impose ! Nous avons donc listé ci-dessous les personnages récurrents du roman, histoire de ne pas être trop perdu(e) pour le reste de ta lecture et tes révisions.
- Gargantua : le personnage principal du roman. Géant incroyablement grand et fort, fils de Grandgousier et de Gargamelle, il est éduqué par Ponocrates et devient un sage et un chef juste.
- Grandgousier : le père de Gargantua, seigneur de la région de Touraine. Il incarne la générosité, la bonté et la sagesse.
- Gargamelle : la mère de Gargantua, une femme gigantesque qui meurt en accouchant de son fils à cause de sa taille hors norme.
- Pantagruel : le fils de Gargantua, lui aussi géant. Il est éduqué par son père et devient un héros et un leader courageux.
- Panurge : l’un des amis les plus proches de Pantagruel, personnage rusé et comique souvent au cœur d’aventures burlesques.
- Frère Jean des Entommeures : moine franciscain connu pour son appétit insatiable et sa force incroyable.
- Épistémon : sage et philosophe, il est l’un des conseillers les plus respectés de Gargantua.
- Ponocrates : éducateur humaniste de Gargantua, il lui enseigne les arts et les sciences selon les idéaux de la Renaissance.
- Hélène de Tournon : l’épouse de Pantagruel, belle et vertueuse dame.
- Xenomanes : voyageur grec haut en couleur, connu pour ses récits d’aventures exotiques et extravagantes.
- King Anarchus : roi tyrannique et ennemi de Pantagruel, finalement vaincu par le héros géant.
À savoir : Rabelais a réalisé un grand travail autour des noms pour son roman (ce qu’on appelle l’onomastique). Ils n’ont pas été choisis au hasard ! Chacun a sa petite signification, bien souvent comique. Notons par exemple celui de Grandgousier, qui évoque un Grand Gosier, soit l’appétit de la vie au sens large, du personnage.
Résumé Gargantua : les Aventures du Géant

Le livre suit les aventures du géant Gargantua, de son fils Pantagruel et de leurs amis alors qu’ils naviguent à travers un monde fantastique rempli d’humour, de satire et de critique sociale.
Le livre commence par le récit de la naissance de Gargantua, fils du seigneur Grandgousier et de sa femme Gargamelle. Il naît dans des conditions exceptionnelles puisqu’il sort de l’oreille de sa mère, après neuf mois de grossesse. Gargantua vient au monde en réclamant à boire, ce qui lui vaut son prénom (quel (gosier) grand tu as).
Gargantua est un géant qui grandit rapidement et développe une grande soif de connaissances. Il est confié à l’éducateur humaniste Ponocrates, qui lui enseigne les arts et les sciences.
Après avoir terminé son éducation, Gargantua retourne chez son père et règne sur le pays avec sagesse et justice. Cependant, il est bientôt impliqué dans des guerres avec les ennemis de son père et est capturé par les ennemis de son pays.
Gargantua parvient à s’échapper et rencontre son fils, Pantagruel, qui est également un géant. Ensemble, ils naviguent à travers des mers dangereuses, combattent des ennemis féroces et rencontrent des personnages étranges et comiques.
Au cours de leurs aventures, ils rencontrent des philosophes, des moines, des voyageurs, des rois tyranniques et des gens ordinaires qui ont tous quelque chose à dire sur la vie, la mort, la religion, la politique et la société.
Le livre se termine par une série de conseils et de maximes sages qui résument les idées principales de l’auteur sur la nature humaine et la société.
Quelles sont les caractéristiques de Gargantua ? Analyse du personnage et du roman
L’éducation de Gargantua
Le roman retrace trois étapes de la construction de Gargantua. Tout d’abord, celui-ci reçoit dans son enfance plusieurs formations qui ont pour objectif de l’éduquer, de l’élever. Cela commence par une éducation au sens physique du terme, c’est-à-dire l’apprentissage de la manière dont on se nourrit, dont on se vêt, etc. Puis ce dernier reçoit une instruction plus large, notamment pendant l’adolescence. Enfin, Gargantua suit une formation guerrière, qui le présente tout à la fois comme un prince défenseur et protecteur.
Le roman Gargantua se développe en suivant un dynamisme ascensionnel : au début, les descriptions partent du bas (du vulgaire, du cru) pour s’élever progressivement jusqu’à l’affirmation du libre arbitre du personnage principal qui se matérialise par la phrase « fais ce que tu voudras » à la fin du livre.
Les jeux de mots
La première remarque que l’on peut émettre à propos de Gargantua, en lien avec la thématique du rire, est que Rabelais est aussi connu pour son goût pour la langue française. Il a ainsi inventé de nombreux mots qui permettent d’illustrer sa pensée, dont certains participent de l’humour rabelaisien.
Dans cette perspective, on peut évoquer une technique employée dans Gargantua qui illustre cet appétit des mots : il s’agit de l’onomastique, qui se penche sur l’étude des noms propres. La construction des noms propres dans le roman est en effet essentielle, car elle constitue une étape capitale dans la construction du personnage, premier facteur d’identification grâce auquel le lecteur va pouvoir reconnaître le personnage.
La richesse littéraire de l’œuvre
Le roman de Rabelais est connu autant pour le fond que pour la forme.
En effet, Rabelais a écrit tout son roman dans un style très particulier. Écriture flamboyante, langage inventif, jeux de mots, néologismes, etc. La multiplication des procédés littéraires utilisés fait la caractéristique de l’œuvre. Rabelais fait également appel à différents genres littéraires : poésie, éloge, pamphlet, parodie ou encore dialogue philosophique.
Les procédés qui suscitent le rire
Dans cette perspective, tout lecteur aura remarqué que le texte de Rabelais est empreint de procédés divers qui déclenchent le rire. Ainsi, le prologue de cet ouvrage regorge d’illustrations de motifs qui entraînent le rire ; parmi eux, on peut noter le lexique ordurier, qui consiste à énoncer un grand nombre de mots vulgaires et scatologiques (qui ont rapport aux excréments). De la même manière, on peut évoquer le processus par lequel Rabelais ramène sans cesse l’homme à ses envies primaires et réduit le corps à ses fonctions physiologiques (manger, boire, dormir et se soulager).
Le thème de l’ivresse, de la boisson, du vin ainsi que les nombreuses images régressives et parodies font également partie des éléments qui invitent le lecteur à rire. En outre, les premiers mots que prononce Gargantua sont « À boire ! », ce qui ne manque pas de faire sourire le lecteur. Ces registres sont à mettre en relation avec toutes les formes d’excès qui sont mentionnées, souvent traduites par des hyperboles (figure de style qui consiste à exagérer, grossir les traits de quelque chose).
Par ailleurs, Rabelais entend se moquer de la scolastique, une école médiévale au service du religieux uniquement, en se moquant des discours dogmatiques prononcés par l’Église, interprétations souvent hasardeuses et bancales dont la vérité reste discutable. Il se moque ainsi des « glossateurs », ceux qui utilisent par exemple des expressions latines inventées qui ne veulent rien dire (comme dans le chapitre XIX). Il y caricature ainsi ceux qui proclament détenir le savoir, incarnés par Janotus, un faux savant.
La transmission du savoir par le rire : « Rire est le propre de l’homme »
Dans cette œuvre très imagée, Rabelais utilise le rire afin d’éduquer le lecteur. Les personnages du livre eux-mêmes sont joyeux : Grandgousier est décrit comme « bon raillard », c’est-à-dire grand rieur. L’auteur tourne en dérision les pseudo-savants, qui utilisent souvent leur savoir pour avoir de l’autorité et ainsi obtenir ce qu’ils veulent. Rabelais présente ici une éducation princière, mais qui vaut pour tout le monde, en proposant de bâtir une société vertueuse.
Rabelais tourne en dérision ses héros en les mettant dans des situations risibles (qui provoquent le rire) et burlesques par leur caractère comique. Dès lors, on peut évoquer dans le chapitre XXI le moment où il lui est demandé de faire du sport dans son lit, ce qui apparaît comme complètement contre-productif et inutile, ainsi que l’absence de réflexion à propos de l’adaptation des vêtements à la saison.
Néanmoins, un tournant s’opère au chapitre XXIII, dans lequel Gargantua prend progressivement connaissance de la notion de pudeur, d’une certaine hygiène de vie, avec la mise en place d’une diète et d’activités physiques qui contrebalancent la première partie du roman dans laquelle tous les excès semblaient être permis. Ce changement de cap peut se traduire par la locution grecque « meden agan » qui signifie : « rien de trop », et valorise dès lors le sens de la mesure.
De plus, il occupe désormais son temps d’une façon rationalisée avec l’aménagement d’un emploi du temps dévolu à certaines activités de l’esprit notamment. Rabelais couche ici sur papier les principes issus des observations médicales de l’époque, qui associent la santé du corps à celle de l’esprit et dont il se réclame.
Quelle est la morale de Gargantua de Rabelais ?
Rabelais se sert du rire pour transmettre un message profond à ses lecteurs : comprendre le monde, cultiver la raison et respecter certains principes pour éviter le chaos. Sous ses airs comiques, Gargantua cache une réflexion humaniste sur l’éducation, le pouvoir et la sagesse.
À travers des scènes burlesques, comme celle du roi transporté sur une charrette à bœufs (chapitre XXI), Rabelais critique la monarchie héréditaire et dénonce l’injustice d’un pouvoir attribué par la naissance plutôt que par le mérite. Il appelle à une réforme à la fois politique et éducative, en accord avec les idéaux humanistes de la Renaissance.
Enfin, les nombreuses hyperboles présentes dans le roman soulignent la critique d’un savoir vide et mécanique. Rabelais rappelle ainsi que l’éducation ne doit pas se limiter à l’accumulation de connaissances, mais viser la compréhension et la conscience. Comme il l’écrit dans Pantagruel : « Science sans conscience n’est que ruine de l’âme. »
Quelle est la portée de Gargantua de Rabelais ? Influence et héritage de l’œuvre
En plus de son style littéraire unique, Rabelais a fait de Gargantua une œuvre majeure, profondément critique de la société et du pouvoir politique du XVIe siècle. Le personnage de Gargantua est utilisé pour se moquer autant des travers de la noblesse, que ceux du clergé, de l’éducation non humaniste ou encore de la bêtise de la guerre. Excès, corruption, abus de pouvoir font face à la vision alternative et utopiste de la société que dresse Rabelais.
Par sa spécificité, cette œuvre a eu une influence durable sur la littérature occidentale. Que ce soit sur le fond, grâce à une satire sociale audacieuse, ou sur la forme, grâce à un mélange des genres littéraires surprenant, l’œuvre de Rabelais a inspiré de nombreux intellectuels et écrivains.
Roman audacieux à la fois humoristique et satirique, Gargantua met en avant l’aventure d’un personnage rocambolesque au service de la critique de l’époque. Il s’agit d’un plaidoyer pour le développement de la culture humaniste en réponse à l’enseignement religieux figé en vigueur.
Un quiz pour réviser Gargantua – Bac de français
Teste tes connaissances sur Gargantua de François Rabelais.
Œuvres au programme du bac de français 2026 – Voie générale
Voici la liste officielle des œuvres à étudier en première pour l’épreuve anticipée du bac de français en 2026, classées par objet d’étude :
Littérature d’idées (du XVIe au XVIIIe siècle)
- Étienne de La Boétie, Discours de la servitude volontaire
→ Parcours associé : « Défendre » et « entretenir » la liberté - Bernard Le Bouyer de Fontenelle, Entretiens sur la pluralité des mondes
→ Parcours associé : Le goût de la science - Françoise de Graffigny, Lettres d’une Péruvienne (édition augmentée de 1752, incluant l’introduction historique et les Lettres XXVIII, XXIX, XXX et XXXIV)
→ Parcours associé : Un nouvel univers s’est offert à mes yeux
Théâtre (du XVIIe au XXIe siècle)
- Pierre Corneille, Le Menteur
→ Parcours : Mensonge et comédie - Alfred de Musset, On ne badine pas avec l’amour
→ Parcours : Les jeux du cœur et de la parole - Nathalie Sarraute, Pour un oui ou pour un non
→ Parcours : Théâtre et dispute
Poésie (du XIXe au XXIe siècle)
- Arthur Rimbaud, Cahier de Douai (22 poèmes, de « Première soirée » à « Ma Bohème (Fantaisie) »)
→ Parcours : Émancipations créatrices - Francis Ponge, La rage de l’expression
→ Parcours : Dans l’atelier du poète - Hélène Dorion, Mes forêts
→ Parcours : La poésie, la nature, l’intime
Roman et récit (du Moyen Âge au XXIe siècle)
- Abbé Prévost, Manon Lescaut
→ Parcours : Personnages en marge, plaisirs du romanesque - Honoré de Balzac, La Peau de chagrin
→ Parcours : Les romans de l’énergie : création et destruction - Colette, Sido suivi de Les Vrilles de la vigne
→ Parcours : La célébration du monde
N’oublie pas : pour chaque objet d’étude, ton professeur choisira une œuvre à travailler en classe. Commence dès maintenant à te familiariser avec les titres au programme !
Bonne nouvelle pour toi, nous te proposons une fiche de lecture pour chacune des œuvres que nous venons de citer. De quoi te permettre d’avancer bien vite dans tes révisions. Alors, n’attends plus et consulte sans plus tarder AuFutur.
Pourquoi Gargantua est-il considéré comme un roman humaniste ?
Parce qu’il valorise le savoir, la raison, l’éducation et l’harmonie entre l’homme et le monde. Rabelais critique les enseignements scolastiques figés et plaide pour une pédagogie fondée sur l’expérience, la curiosité et l’esprit critique.
Qu’est-ce que la guerre picrocholine dans le récit ?
La guerre picrocholine oppose Gargantua à Picrochole pour des raisons futiles. Elle symbolise les conflits absurdes et destructeurs déclenchés par la vanité, l’orgueil ou l’absurde rivalité politique.
Qui est Thubal Holoferne et quel rôle critique-t-il ?
Thubal Holoferne est un précepteur scolastique rigide que Rabelais critique. Sa pédagogie mécanique, faite de récitation et de contraintes, contraste avec l’approche humaniste de Ponocrates. Il représente l’enseignement figé et inutile. :contentReference[oaicite:0]{index=0}
Qu’est-ce que la « coquecigrue » dans Gargantua ?
La « coquecigrue » est une créature imaginaire mentionnée par Rabelais. Elle symbolise le merveilleux, l’absurde et l’esprit carnavalesque. Le mot a aussi pris un sens figuré : ce qui n’existe pas ou est illusoire. :contentReference[oaicite:1]{index=1}
Qui est Hurtaly dans Gargantua et que symbolise-t-il ?
Hurtaly est un ancêtre de Gargantua mentionné dans l’œuvre. Il aurait survécu au Déluge en s’asseyant sur l’Arche de Noé. Il incarne le thème de la longévité, du merveilleux et renforce la dimension familiale et mythique de l’univers gargantuesque. :contentReference[oaicite:2]{index=2}
Comment « picrocholine » est-il passé dans le langage courant ?
Le mot « picrocholine » vient du nom du roi Picrochole et désigne désormais un conflit absurde pour des raisons futiles. L’expression « guerre picrocholine » est encore utilisée aujourd’hui pour qualifier des querelles sans fondement. :contentReference[oaicite:3]{index=3}