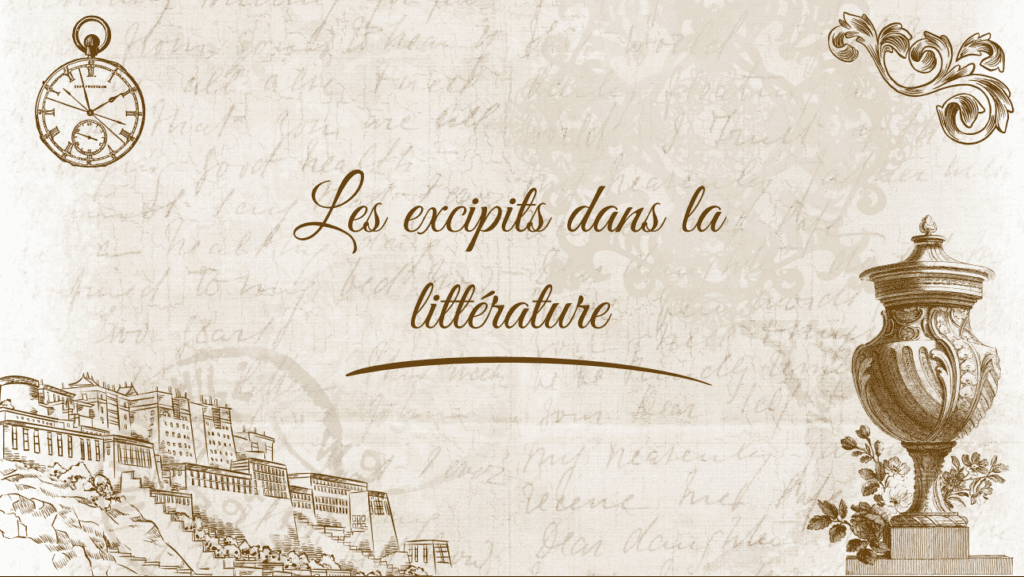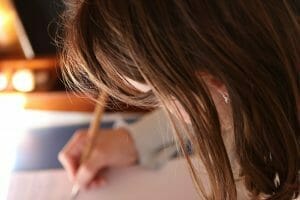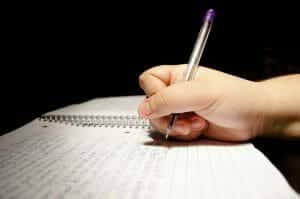Si l’incipit ouvre la porte d’un roman, l’excipit en est la dernière empreinte, celle qui résonne longtemps après la lecture. Parfois tragique, parfois lumineux, souvent chargé de sens, l’excipit scelle le destin des personnages et offre au lecteur une ultime réflexion. Voici une sélection des excipits les plus marquants de la littérature, analysés pour leur puissance évocatrice et leur impact durable.
L’excipit de Le Rouge et le Noir de Stendhal (1830)
« Mme de Rênal fut fidèle à sa promesse. Elle ne chercha en aucune manière à attenter à sa vie ; mais, trois jours après Julien, elle mourut en embrassant ses enfants ».
Cet excipit clôt le destin tragique de Julien Sorel et de Mme de Rênal. La brièveté de la phrase souligne la fatalité des événements. La mort de Mme de Rênal, survenue peu après celle de Julien, accentue le caractère inéluctable de leur séparation et la profondeur de leur amour. Stendhal offre ici une conclusion poignante, où l’amour et la mort se confondent dans une ultime étreinte.
L’excipit de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo (1831)
« Il n’avait d’ailleurs aucune rupture de vertèbre à la nuque, et il était évident qu’il n’avait pas été pendu. L’homme auquel il avait appartenu était donc venu là, et il y était mort ».
L’excipit de Notre-Dame de Paris révèle la mort de Quasimodo, retrouvé auprès du corps d’Esmeralda. La sobriété du récit contraste avec l’intensité émotionnelle de la scène. Victor Hugo souligne la fidélité posthume de Quasimodo, dont l’amour transcende la mort. Cette fin tragique renforce le message humaniste du roman, mettant en lumière la beauté intérieure face aux apparences.
L’excipit de La Princesse de Clèves de Madame de La Fayette (1678)
« Enfin, des années entières s’étant passées, le temps et l’absence ralentirent sa douleur et éteignirent sa passion ».
Dans l’excipit de La Princesse de Clèves, Madame de La Fayette dépeint l’extinction progressive de la passion du duc de Nemours. La métaphore du feu qui s’éteint symbolise la fin d’un amour intense mais contrarié. La princesse, quant à elle, choisit la retraite et la vertu, refusant de céder à ses sentiments. Cette conclusion met en avant le conflit entre passion et devoir, illustrant la rigueur morale de l’époque.
L’excipit de Gatsby le Magnifique de F. Scott Fitzgerald (1925)
« C’est ainsi que nous avançons, barque à contre-courant, sans cesse ramenés vers le passé ».
L’excipit de Gatsby le Magnifique offre une métaphore puissante sur la condition humaine. La barque à contre-courant symbolise la lutte constante contre le temps et la nostalgie. Fitzgerald souligne l’impossibilité de recréer le passé, thème central du roman. Cette phrase finale, poétique et mélancolique, laisse une impression durable sur le lecteur.
L’excipit de Candide de Voltaire (1759)
« Il faut cultiver notre jardin ».
Cette conclusion lapidaire résume la philosophie de Voltaire. Après de nombreuses aventures et désillusions, que nous te décrivons dans cet article, Candide adopte une attitude pragmatique. Le jardin symbolise l’espace personnel à entretenir pour trouver le bonheur. Voltaire prône ici le travail et la responsabilité individuelle comme remèdes aux maux du monde.
L’excipit de L’Étranger d’Albert Camus (1942)
« Pour que tout soit consommé, pour que je me sente moins seul, il me restait à souhaiter qu’il y ait beaucoup de spectateurs le jour de mon exécution et qu’ils m’accueillent avec des cris de haine ».
L’excipit de L’Étranger reflète l’absurdité de la condition humaine, thème cher à Camus. Meursault, confronté à sa mort imminente, accepte l’indifférence du monde. Son désir d’être accueilli par des cris de haine souligne son refus de se conformer aux normes sociales. Cette fin provocante incite à la réflexion sur le sens de la vie et de la mort.
L’excipit de Le Père Goriot de Honoré de Balzac (1835)
« Il lança sur cette ruche bourdonnante un regard qui semblait par avance en pomper le miel, et dit ces mots grandioses : – À nous deux maintenant ! »
Dans l’excipit du Père Goriot, Rastignac, jeune provincial ambitieux, défie la société parisienne. La métaphore de la ruche souligne la complexité et l’effervescence de la capitale. Balzac annonce ici l’ascension sociale de son personnage, prêt à affronter les défis du monde mondain. Cette conclusion ouvre la voie à d’autres récits de la Comédie humaine.
L’excipit de Manon Lescaut de l’Abbé Prévost (1731)
« Nous avons passé deux mois ensemble à la Nouvelle-Orléans pour attendre l’arrivée des vaisseaux de France ; et nous étant enfin mis en mer, nous avons débarqué à Saint-Malo, d’où je suis venu vous raconter mes malheurs ».
L’excipit de Manon Lescaut prend la forme d’un récit rétrospectif, où le narrateur, le chevalier Des Grieux, confie ses douleurs au lecteur. Après la mort tragique de Manon, le retour en France n’a plus de saveur pour lui. Le style sobre et la mélancolie contenue donnent à cette fin une dignité poignante. C’est une manière pudique de clore une histoire d’amour marquée par la passion, la transgression et la fatalité. L’excipit illustre le désespoir calme de celui qui a tout perdu — et qui n’attend plus rien, sinon d’être entendu.
L’excipit de Les Misérables de Victor Hugo (1862)
« Il dort. Quoique le sort fût bien étrange,
Il vivait. Il mourut quand il n’eut plus son ange,
La chose simplement d’elle-même arriva,
Comme la nuit se fait lorsque le jour s’en va ».
Victor Hugo termine Les Misérables avec un poème gravé sur la tombe de Jean Valjean, devenu un homme juste après tant d’errance et de souffrance. Cette poésie incarne la rédemption, la paix retrouvée et le lien indéfectible entre Valjean et Cosette. L’image de la nuit remplaçant le jour symbolise une mort douce, naturelle, presque attendue. C’est un excipit d’une immense tendresse, un adieu apaisé à un personnage qui a incarné l’humanité dans toutes ses contradictions.
L’excipit de 1984 de George Orwell (1949)
« Il aimait Big Brother ».
Cette dernière phrase lapidaire de 1984 est glaçante. Elle illustre la victoire absolue du régime totalitaire sur l’individu. Winston Smith, autrefois rebelle, a été brisé psychologiquement, jusqu’à aimer son bourreau. Orwell montre ainsi que l’oppression peut aller jusqu’à transformer les pensées elles-mêmes. L’excipit est terrifiant par sa simplicité : en sept mots, il incarne la mort de la liberté, la soumission totale. C’est une fin qui laisse le lecteur dans un vertige amer et sans illusion.
L’excipit de La Peste d’Albert Camus (1947)
« Il savait que cette chronique ne pouvait pas être une victoire définitive et qu’elle ne pouvait être qu’un témoignage, que le fléau peut réveiller ses rats et les envoyer mourir dans une cité heureuse ».
Dans la conclusion de La Peste d’Albert Camus, le docteur Rieux, narrateur de l’œuvre, livre une leçon universelle : la peste, métaphore du mal, peut ressurgir à tout moment. L’excipit n’offre pas de résolution mais une mise en garde. Camus invite à la vigilance, à la solidarité et à la conscience face aux dangers toujours latents. C’est une fin ouverte, empreinte de lucidité et de responsabilité collective, qui donne à l’œuvre une portée intemporelle.
L’excipit de À la recherche du temps perdu de Marcel Proust (1927)
« Ainsi je comprenais que ce plaisir, que je venais d’éprouver à entendre le bruit d’une fourchette, me venait du souvenir de tout un repas, et que ce souvenir ne se détachait que comme une écaille de la surface d’un passé immense ».
L’excipit de À la Recherche du temps perdu boucle le cycle monumental entamé avec Du côté de chez Swann. La mémoire involontaire, révélée à travers des sensations infimes, offre un sens à l’existence du narrateur. Proust achève son œuvre dans une boucle presque parfaite : la révélation esthétique devient salvatrice. Le passé, loin d’être un fardeau, devient matériau de création. L’excipit donne ainsi naissance à l’œuvre elle-même, dans un geste quasi métaphysique où le narrateur devient écrivain.
Pourquoi les excipits marquent-ils autant la littérature et les esprits ?
L’excipit est un seuil : il nous fait passer du monde fictionnel à notre réalité, souvent chargé d’une émotion condensée. Là où l’incipit promet, l’excipit conclut, tranche, révèle, ou ouvre de nouvelles perspectives. Il peut conforter, bouleverser ou laisser en suspens. Il agit comme une empreinte définitive, celle que le lecteur emporte avec lui.
Un bon excipit est souvent :
- Symbolique : il condense le sens du récit (ex : Candide ou 1984).
- Émotionnellement fort : il offre une résolution (ou non) qui touche (ex : Le Rouge et le Noir).
- Philosophique : il donne matière à réflexion (ex : La Peste).
- Poétique : il enchante et élève le lecteur (ex : À la recherche du temps perdu).
Ce que tu dois retenir sur les excipits
Les excipits, bien plus qu’une simple fin, sont les véritables clés de voûte d’un roman. Ils peuvent tout transformer, même rétroactivement, en donnant une signification nouvelle à ce qui a précédé. Ils accompagnent le lecteur hors du livre, mais parfois aussi, ils le retiennent dans l’univers de l’auteur bien après la dernière page. En cela, ils sont des objets littéraires fascinants, dignes d’analyse autant que de contemplation.