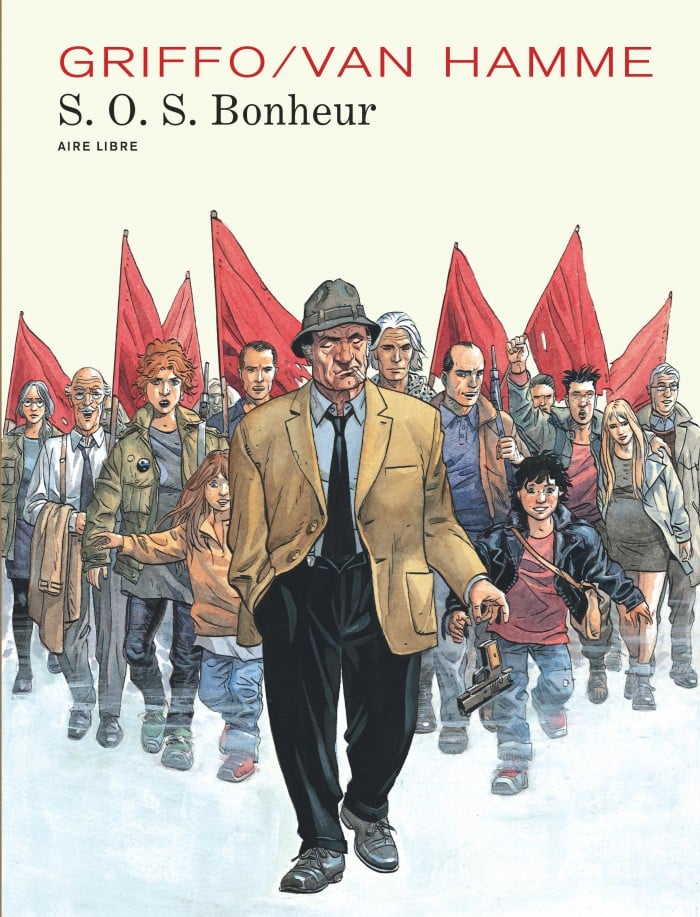Le bonheur fait depuis toujours l’objet de nos interrogations les plus profondes. Dans SOS Bonheur, Jean Van Hamme explore avec lucidité les paradoxes de notre quête contemporaine du bien-être, souvent confrontée à la complexité des relations humaines. Cette réflexion nous invite à nous demander : peut-on être vraiment heureux sans autrui ? Ce questionnement traverse l’histoire de la philosophie, des anciens Grecs à nos sociétés modernes, en passant par la voix des penseurs chrétiens, révolutionnaires et contemporains. Faire l’état des lieux de cette interrogation revient à sonder ce qui fait la nature même de notre condition humaine : sommes-nous des individus autonomes, capables de trouver le bonheur seuls, ou bien le bonheur naît-il au contraire du lien avec les autres ? Cette double perspective, individuelle et collective, guidera notre exploration.
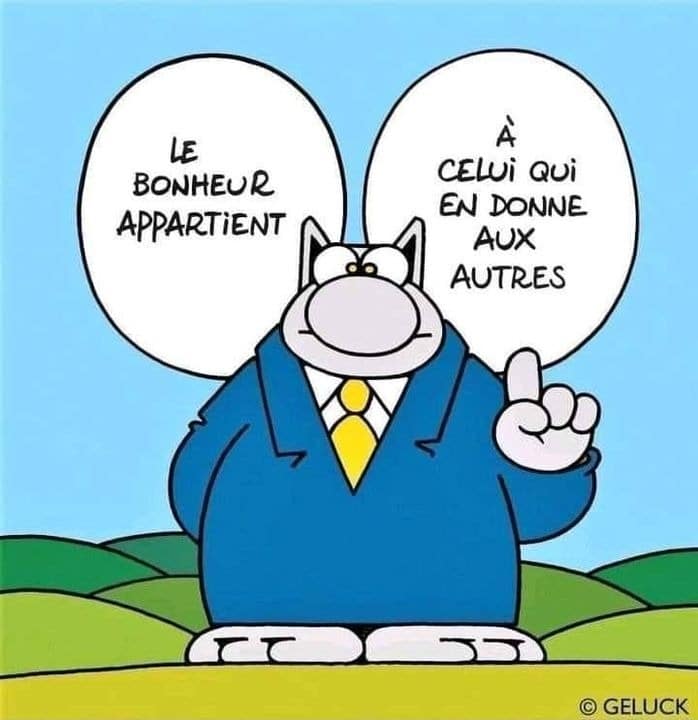
L’eudémonisme antique : Le bonheur, quête individuelle mais dimension sociale
A. Aristote et la communauté humaine
Chez Aristote, la recherche du bonheur s’enracine dans la nature sociale de l’homme. Dans l’Éthique à Nicomaque, il écrit que « l’homme est par nature un animal politique » (zôon politikon). Cela signifie que vivre en dehors de la cité, volontairement, n’est pas humain. Le bonheur, ou eudaimonia, ne relève donc pas seulement d’un épanouissement individuel, mais s’inscrit dans une dynamique collective. Un individu isolé ne peut accomplir toutes les vertus puisque la justice, la générosité ou le courage ne prennent sens qu’en lien avec autrui. Par exemple, la justice exige de traiter l’autre équitablement.
Aristote souligne : « L’amitié constitue le bien le plus nécessaire à la vie » (Éthique à Nicomaque, VIII). Seule l’amitié offre un terrain d’épanouissement moral où les vertus, telles que la loyauté et l’empathie, deviennent réelles et actives. Dans la cité, chaque personne prend part à un projet commun, trouve sa place et reçoit la reconnaissance de ses pairs. L’isolement prive l’homme du regard d’autrui, nécessaire à la construction de son identité et à l’évaluation de ses actes. Ainsi, même le sage, chez Aristote, a besoin d’amis pour partager, réfléchir et progresser vers le bien. Autrui n’est pas un simple compagnon d’existence : il est le miroir nécessaire où se réfléchit le chemin vers le bonheur.
B. Épicure : le bonheur simple, mais jamais sans amis
Épicure propose une conception sobre du bonheur, centré sur la tranquillité de l’âme – l’ataraxie. Cette paix intérieure ne se confond pas avec la solitude totale. Au contraire, Épicure fait de l’amitié le pilier central d’une vie heureuse. Dans sa Lettre à Ménécée, il conseille de cultiver les relations sincères, car « de tous les biens que la sagesse procure, l’amitié est le plus précieux ». Chez lui, la jouissance des plaisirs naturels passe par le partage. Il fonde « Le Jardin », une communauté où l’égalité, la confiance et le dialogue sont privilégiés. Même les plaisirs simples, pour Épicure, n’atteignent d’intensité durable que dans l’échange : un repas frugal, pris en bonne compagnie, vaut bien mieux qu’un festin en solitaire.
Se protéger des troubles de la vie suppose donc la présence de personnes fiables, aptes à offrir soutien et sécurité. L’ami permet de dissiper la peur, notamment celle de la mort, grâce à la parole et à la solidarité. L’absence d’amis expose à l’insécurité et à l’angoisse, ce qui rend tout bonheur fragile. L’idéal épicurien n’est pas la fuite du monde, mais la construction d’un espace de confiance partagée. Ainsi, pour Épicure, le bonheur véritable ne peut se penser sans autrui : il naît du lien, de la réciprocité, et de la complicité entre amis.
La religion chrétienne : solitude, péché et salut en commun

A. La condition pécheresse de l’âme humaine
Dans la Bible, la condition humaine se caractérise par une séparation profonde d’avec Dieu et d’avec autrui. Cette rupture remonte au récit de la Genèse où Adam et Ève, en désobéissant, provoquent la chute. Leur acte engendre non seulement l’éloignement de Dieu, mais aussi la discorde entre les humains. Dès lors, la solitude et l’angoisse deviennent les marques d’un monde blessé par le péché. Selon Saint Paul, « tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu » (Lettre aux Romains, 3, 23). Pourtant, la tradition chrétienne ne s’arrête pas à ce constat pessimiste. Elle invite à rechercher le pardon, la réconciliation et le vivre ensemble.
Le Christ, dans l’Évangile, appelle à aimer son prochain comme soi-même (Matthieu, 22, 39). Le Christ sera reconnu par les chrétiens (et non par les juifs) comme ce sauveur attendu, comme l’Emmanuel, fils de la Promesse. Ce dernier sacrifiera sa vie sur la croix pour sauver l’humanité : la résurrection est à ce prix. Pour autant, Il ne ramène pas avec Lui le Paradis perdu mais annonce le salut et le retour au bonheur et à la joie dans l’au-delà, dans la cité de Dieu, dans l’eschatologie après le jugement final où chacun sera jugé et rétribué selon sa vie. Le bonheur éternel est donc une promesse obtenue consécutivement à une conduite conforme aux attentes de l’Évangile, au souci de l’autre, et à l’amour de Dieu (théologie de la grâce). Ainsi, la relation à Dieu passe aussi par la qualité du lien à autrui.
B. Pascal : le divertissement contre le vide de la solitude
Blaise Pascal, dans ses Pensées, insiste sur la misère de la condition humaine. Pour lui, la véritable béatitude n’est pas accessible ici-bas. La souffrance, la solitude et la mort découlent de la condition pécheresse de l’humanité. La Bible l’exprime dès la Genèse : après la faute d’Adam et Ève, Dieu leur adresse une « malédiction ». Adam entend : « tu gagneras ton pain à la sueur de ton front », « tu mangeras de l’herbe sauvage », « la terre te donnera épines et chardons », et surtout : « tu mourras ». Ève reçoit aussi son lot de peines : « je multiplierai les douleurs de tes grossesses » et « tu mourras ». La souffrance, la peine et la mort inscrivent ainsi l’humanité dans une malé-diction — une parole de malheur posée sur le berceau de l’homme et de la femme.
Pascal souligne que les hommes fuient cette détresse existentielle par le divertissement. Nombreux cherchent à échapper à la solitude qui révèle notre misère profonde. Il écrit : « Tout le malheur des hommes vient d’une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre » (Pensées, fragment 139). Pourtant, ce divertissement n’apporte qu’un répit illusoire et n’efface pas la réalité de la condition humaine. Pour Pascal, le bonheur parfait ne peut être trouvé en ce monde. La « malédiction » s’accompagne cependant d’une promesse de salut et d’espérance : il s’agira, dans la perspective chrétienne, de faire ses preuves dans cette vie pour bénéficier du bonheur ultime dans le monde futur. Le lien à autrui garde alors toute son importance. La relation, marquée par la solidarité, la charité, et la quête commune de sens, devient un chemin vers cette espérance de salut. Ici, la solitude n’offre qu’angoisse ; c’est par l’ouverture à l’autre, vécue dans la reconnaissance de sa propre fragilité, que le croyant trouve du sens et prépare la promesse d’une béatitude à venir.
La politique : Autrui garant ou obstacle du bonheur ?
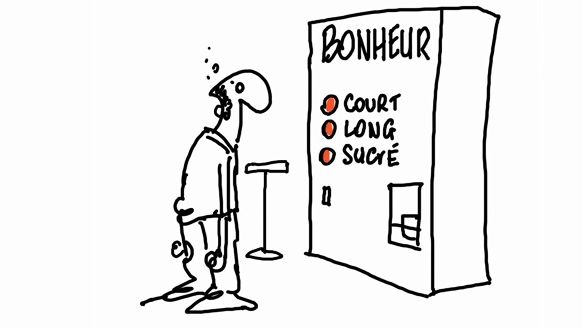
A. Promesse de bonheur politique : Saint-Just et le bonheur commun
La Révolution française marque une rupture profonde dans la conception du bonheur. Saint-Just, porte-parole du Comité de salut public, proclame dans son discours du 13 ventôse an II (13 mars 1794) : « Que l’Europe apprenne que vous ne voulez plus un malheureux ni un oppresseur sur le territoire français ; que cet exemple fructifie sur la terre. Le bonheur est une idée neuve en Europe. » Cette phrase illustre la volonté de réinscrire le bonheur dans le champ politique de façon radicale. Pour Saint-Just, le bonheur ne relève plus de la sphère privée, individuelle ou religieuse, mais devient une fin collective, un projet politique à construire.
La nouvelle société révolutionnaire promet d’éradiquer la misère et l’injustice par l’instauration d’un ordre fondé sur la liberté, l’égalité et la vertu. Ainsi, le bonheur individuel dépend de cette organisation collective, au sein d’une cité où nul ne domine ni n’est dominé. Pourtant, cette promesse s’accompagne d’une tension : atteindre le bonheur commun nécessite parfois violence et sacrifice, comme le montre la Terreur. Le bonheur devient alors un idéal politique fragile, toujours à conquérir, où autrui n’est pas seulement garant du bonheur, mais aussi potentiellement son obstacle. Ce paradoxe souligne combien la politique s’impose comme un lieu de luttes autour du bonheur partagé.
B. Eugène Enriquez : le lien social comme condition du sujet heureux
À l’heure où s’effondrent les grands récits politiques du passé – utopies révolutionnaires, philosophies hégéliennes, promesses marxistes – la pensée d’Eugène Enriquez s’impose comme une analyse critique des nouvelles formes du lien social. Dans L’homme singulier pluriel (2001), Enriquez insiste sur le rôle fondamental des relations interpersonnelles dans la construction du bonheur. Le « sujet pluriel » qu’il décrit se définit par sa capacité à vivre ses contradictions au sein d’un réseau complexe d’échanges. Le bonheur ne surgit pas dans l’isolement, mais dans la reconnaissance mutuelle, dans la confrontation parfois conflictuelle avec autrui.
Enriquez décrit deux positions issues du siècle dernier. La première, dite « paranoïaque », rêve d’une société parfaite où nul conflit n’existe – un idéal utopique porté par des figures messianiques. L’échec de ces projets fut catastrophique. La seconde, dite « perverse », s’appuie sur la maîtrise technique et l’expertise pour prétendre résoudre tous les problèmes humains. Cette position s’incarne dans la société numérique actuelle, où le bonheur serait le fruit d’une gestion rationnelle et d’une optimisation algorithmique. Enriquez met en garde contre cette réduction du lien à un calcul d’efficacité. Pour lui, le bonheur véritable ne peut s’accomplir sans l’irréductible singularité du sujet en dialogue avec autrui, dans une communauté vivante, où la dimension éthique et spirituelle ne se réduit pas à la doxa. Il rappelle ainsi que malgré les illusions et les échecs, le lien social reste la condition sine qua non d’une vie heureuse et authentique.
Technique et promesse d’un bonheur absolu : illusion ou progrès ?

A. Huxley et le bonheur technique : « Le Meilleur des mondes »
Aldous Huxley a imaginé dans Le Meilleur des mondes une société où le bonheur résulte d’un contrôle technologique strict, auquel le lien humain authentique fait défaut. Aujourd’hui, cette perspective semble de plus en plus tangible grâce aux avancées technologiques. La science moderne permet déjà de « fabriquer » un humain amélioré, voire « bionique », grâce à des prothèses connectées au cerveau. Ce « Golem » contemporain, que l’on nomme parfois « transhumain » ou « posthumain », vise à dépasser les limites naturelles du corps et de l’esprit. Des associations telles que la Société abolitionniste ambitionnent de supprimer la douleur, même la mort, par des moyens techniques, donnant naissance à un bonheur permanent et programmable. Le « paradise engineering » promet, via la génétique, la psychopharmacologie et les nanotechnologies, une transformation radicale de l’homme vers une existence félicitaire et sans faille.
L’expérience de la stimulation électrique cérébrale, appelée wireheading, illustre ce projet : en activant directement les zones du plaisir, on cherche à induire des états de bonheur total. L’objectif est d’éradiquer les souffrances et les maladies mentales, mais aussi toutes les tensions sociales sous-jacentes. Pourtant, ce bonheur « fabriqué » pose un problème fondamental : il repose sur le contrôle absolu, l’effacement des aléas humains et, surtout, l’élimination du lien vivant avec autrui. Ce pouvoir technique, susceptible d’être utilisé à des fins totalitaires, évoque le cauchemar orwellien et le modèle d’Huxley. En effet, tout comme dans le roman, la maîtrise du cerveau pourrait devenir une arme politique, entre les mains de tyrans modernes. Ce rêve technoscientifique soulève donc une question éthique majeure : le bonheur artificiel, en sacrifiant la liberté et le rapport authentique à l’autre, ne risque-t-il pas de transformer l’humanité en simple automate, dépossédé de sa dimension spirituelle et sociale ?
B. Les limites du bonheur isolé dans la société moderne
À l’heure où la technologie promet d’optimiser l’existence, la réalité du bonheur demeure incertaine. L’individualisme technique, favorisé par ces innovations, tend à isoler l’individu. Même si les réseaux sociaux semblent créer du lien, ils véhiculent souvent une illusion, une surface sans profondeur relationnelle. Le « virtuel » remplace parfois la présence réelle, accentuant des phénomènes de solitude et d’isolement. L’homme hyperconnecté vit parfois dans une forme paradoxale d’isolement collectif.
Ce constat invite à interroger la capacité de la société contemporaine à accueillir un bonheur véritable. Le progrès technique, sans une dimension humaine et éthique, ne suffit pas à combler les besoins intrinsèques d’appartenance et de reconnaissance. Le bonheur ne se réduit pas à une somme de plaisirs accessibles par des artefacts technologiques. Il exige des rencontres vivantes, des échanges sincères et une communauté active. La société numérique doit donc repenser le rôle de la technique pour qu’elle soit au service d’un bonheur partagé, plutôt qu’un simple instrument d’illusion et d’isolement.