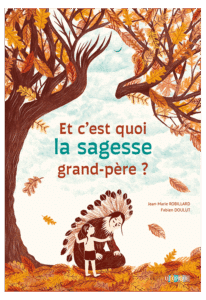La conception augustinienne du libre arbitre s’inscrit dans la continuité et la transformation du platonisme. Augustin s’inspire de Platon pour affirmer la primauté de l’âme rationnelle, siège du discernement moral. Chez Platon, la liberté s’identifie souvent à la connaissance du Bien ; le « choix du meilleur » dépend de la capacité de l’âme à se détourner des apparences sensibles.
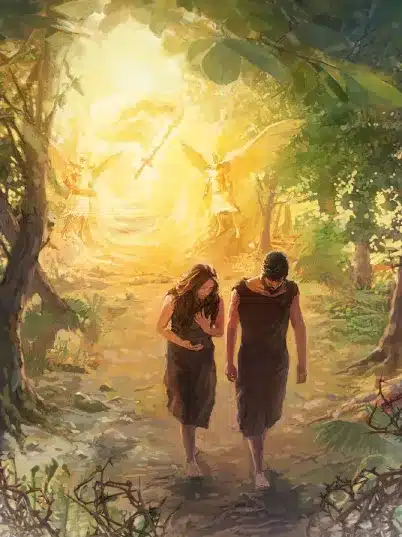
Définition du libre arbitre et d’une volonté bonne
Le terme « libre arbitre » (liberum arbitrium) apparaît dans son dialogue « De libero arbitrio » (entre 388 et 395). Dans ce texte, Saint Augustin s’interroge : « Si Dieu est la cause de tout, il serait aussi la cause du péché ? » La réponse tient dans la reconnaissance de la responsabilité humaine : « Celui qui pèche emploie mal son libre arbitre ; et c’est la volonté qui commet le mal, non la nature ou la création de Dieu » (De libero arbitrio, II, 18). Ici, Augustin distingue avec précision la liberum arbitrium (pouvoir de choisir) et la voluntas (volonté), terme central dans sa pensée. La « volonté » n’est pas pure indétermination ; elle est l’acte même de se tourner soit vers Dieu (conversion), soit vers soi-même ou vers les biens inférieurs (aversio). D’ailleurs, il précise dans « Les Confessions » : « C’est donc ma volonté qui fait que moi-même je veuille ou non ; et quand je veux, c’est librement » (Confessions, VIII, 10).
Le mal existe parce que l’homme est libre
Pour Augustin, la véritable liberté implique l’orientation vers le bien suprême, c’est-à-dire Dieu. La liberté authentique ne consiste pas seulement dans la capacité de choisir entre le bien et le mal, mais dans le fait « d’aimer et de faire le bien ». Il écrit ainsi : « Libertas non est nisi in bono » (« Il n’y a de liberté que dans le bien » ; De libero arbitrio, II, 13). Contrairement au déterminisme stoïcien ou au fatalisme antique, Augustin place la liberté au cœur de la dignité humaine, mais aussi de la responsabilité morale. À cet égard, l’homme chuté conserve le liberum arbitrium, mais sa volonté (voluntas) s’affaiblit, une idée que la doctrine du péché originel viendra expliciter.
L’exemple d’Adam et Eve
L’exemple d’Adam et Ève, dans la Genèse, illustre parfaitement ce drame du libre arbitre : créés libres, ils ont pu choisir d’obéir ou de désobéir à Dieu. Ce choix ne procède pas d’une fatalité extérieure, mais bien d’un consentement intérieur : « Ce n’est pas la chair qui me persuade, mais mon âme qui consent » (Les Confessions, VIII, 5). Historiquement, la chute d’Adam a été interprétée comme l’inauguration d’un usage dévoyé du libre arbitre, ouvrant la porte au mal dans l’histoire humaine.
Le mal : réalité métaphysique ou privation de bien ?
Penser le mauvais
Augustin aborde la question du mal à partir d’une interrogation essentielle : le mal possède-t-il une existence propre ou n’est-il qu’une absence ? Sa réponse se forge au fil de sa vie intellectuelle, notamment dans Les Confessions et La Cité de Dieu. Reprenant la célèbre formule privatio boni, il affirme que le mal n’a pas de réalité substantielle : « Tout être, en tant qu’il est, est bon » (Confessions, VII, 12), et « Le mal n’est pas une substance » (Cité de Dieu, XII, 7). Ainsi, le mal apparaît comme privation du bien, absence ou défaillance par rapport à l’être : ce n’est pas une force ou une matière, mais un manque.
Cette position s’oppose frontalement au manichéisme, courant auquel Augustin adhéra dans sa jeunesse. Les manichéens défendent l’idée d’un univers divisé entre deux principes : le bien et le mal, chacun doué d’une substance propre. Selon Mani, le mal naît d’une matière corrompue qui s’oppose à la lumière du Bien. Augustin, en programmant sa conversion intellectuelle, rejette fermement cette conception dualiste. Il souligne que « le mal n’a ni corps, ni esprit », mais résulte d’un usage défectueux de la liberté créée (Cité de Dieu, XIII, 2).
Néoplationisme de Plotin
Ce renversement s’enracine dans le néoplatonisme de Plotin. Pour Plotin, le mal n’émane pas d’un principe créateur rival du Bien, mais surgit de la distance croissante à l’égard de l’Un, source de tout être. Augustin reprend cette idée : « Ce qui est mauvais n’est pas mauvais parce qu’il existe, mais parce qu’il est corrompu » (Confessions, VII, 16). Ainsi, le mal s’apparente à l’ombre engendrée par l’éloignement du bien, non à une substance opposée ou autonome.
La conversion de Saint Augustin
Ce cheminement philosophique et spirituel culmine lors de la conversion d’Augustin, dont il témoigne dans Les Confessions. Progressivement, il renonce aux explications matérielles et dualistes, pour affirmer que « le bien suprême de l’homme est d’adhérer à Dieu ; s’en détourner, voilà le mal suprême » (De Trinitate, XII, 11). Il n’utilise donc pas seulement une argumentation théorique, mais fonde sa réflexion sur son expérience de conversion et sur une méditation biblique approfondie. Cette approche, radicalement nouvelle, replace le mal au cœur de la liberté humaine : chaque homme, par sa volonté, peut s’éloigner du bien et générer ainsi le mal en lui-même et dans l’histoire.
Le lien entre libre arbitre et responsabilité du mal
Mal moral VS Mal physique
Pour Augustin, le lien entre libre arbitre et responsabilité du mal se clarifie à travers la distinction cruciale entre mal moral et mal physique. Le mal moral relève de l’usage fautif de la volonté : il naît du choix libre de l’homme, qui s’écarte du bien par défection ou par orgueil. « Le mal, c’est de s’éloigner de ce qui est supérieur, et d’adhérer à ce qui est inférieur », écrit Augustin dans Les Confessions (VII, 16). Le mal physique, quant à lui, désigne la souffrance, la maladie ou la mort, réalités qui s’inscrivent dans la condition humaine depuis la Chute, mais qui n’impliquent pas toujours une faute directe.
Exemples bibliques
Le mal moral surgit donc de l’exercice dévoyé du libre arbitre : Adam et Ève, dotés de la capacité de choisir Dieu, désobéissent par orgueil et entraînent toute l’humanité dans la déchéance (Cité de Dieu, XIV, 13). De même, Judas trahit le Christ, non par nécessité, mais par une volonté détournée du bien (voir Évangile selon Jean, 13, 27). Dans ces exemples, le mal n’est jamais imposé de l’extérieur : il devient l’expression d’une liberté corrompue, responsable devant Dieu et devant l’histoire.
Justice et tolérance de Dieu
Augustin éclaire alors l’origine de la culpabilité : la faute procède moins d’un mauvais choix accidentel que d’un attachement volontaire au mal. « Chacun est tenté par sa propre convoitise ; lorsque celle-ci a conçu, elle enfante le péché » (Épître de Jacques, 1, 14-15, souvent commentée par Augustin). La justice divine, dès lors, laisse subsister le mal pour préserver la dignité de la liberté — « car si l’homme ne pouvait faire le mal, il ne serait pas véritablement libre » (De libero arbitrio, III, 8). Cette tolérance divine n’absout pas la responsabilité humaine ; elle rappelle que le monde créé est bon, mais imparfait jusqu’à son achèvement en Dieu.
Mal et histoire : perspectives philosophiques et théologiques
Le rôle du mal dans l’économie augustinienne du Salut
Dans La Cité de Dieu, Saint Augustin offre une vision profondément théologique et philosophique de l’histoire, centrée sur le projet divin du salut. Pour lui, l’histoire humaine n’est pas une simple succession d’événements chaotiques dominés par le mal, mais un cheminement providentiel où le mal joue un rôle paradoxal. En effet, le mal, loin d’être une fin en soi, constitue une étape nécessaire vers la purification et l’élévation de l’âme. Augustin écrit que « le mal ne peut ni anéantir ni dominer le bien, mais sert à manifester la justice de Dieu » (La Cité de Dieu, XXII, 30). Le mal stimule ainsi la conversion, rend possible l’épreuve de la foi et prépare la compréhension du bien souverain.
Comparaison avec Leibniz
Comparativement, d’autres penseurs ont abordé la question du mal en interaction avec l’histoire et la philosophie. Leibniz, dans son « Essai de Théodicée » soutient l’idée optimiste que notre monde est « le meilleur des mondes possibles », où le mal existe mais est subordonné à un bien supérieur (Théodicée, 1710). Sous l’Empire romain, les persécutions des chrétiens, bien que cruelles, participent paradoxalement à l’affermissement de la vérité chrétienne et à la consolidation de l’Église. Cette position, tout en défendant la bonté divine, minimise parfois la réalité tragique du mal historique.
Limites et postérité de la pensée augustinienne
L’héritage d’Augustin chez saint Thomas d’Aquin
La pensée de Saint Augustin sur le libre arbitre et le mal a profondément marqué la philosophie médiévale et moderne, tout en suscitant des critiques et des réinterprétations majeures. Durant le Moyen Âge, Thomas d’Aquin reprend et approfondit la notion augustinienne de « privatio boni » en la conciliant avec l’aristotélisme : il affirme, dans la Somme théologique, que le mal n’a pas d’essence propre et n’existe que comme défaut d’un bien dû. Thomas d’Aquin élargit également la réflexion sur la grâce, soulignant que la liberté humaine doit incontestablement être soutenue par l’aide divine pour s’orienter vers le bien.
Augustin face aux horreurs du XXe siècle
Le XXe siècle met la pensée augustinienne à rude épreuve face aux tragédies historiques. La Shoah, les totalitarismes, les grandes guerres offrent un visage du mal radical, presque impensable dans le seul cadre de la privation. Des philosophes comme Hannah Arendt s’efforcent de penser la « banalité du mal » à partir de phénomènes historiques qui semblent dépasser l’horizon métaphysique et moral d’Augustin. Ces drames questionnent la pertinence du schéma traditionnel : le mal s’inscrit-il encore dans une logique de privation ou manifeste-t-il une force active, sourde et collective ?
FAQ sur la pensée de Saint Augustin
Pourquoi Augustin a-t-il abandonné le manichéisme ?
Parce qu’il considérait que le manichéisme attribuait au mal une consistance indépendante qu’il ne pouvait justifier rationnellement. Sa réflexion philosophique et théologique l’a amené à rejeter l’idée de deux forces égales s’opposant dans l’univers.
Quelle différence Augustin fait-il entre « vouloir » et « choisir » ?
Pour lui, « choisir » désigne un pouvoir abstrait, alors que « vouloir » engage une orientation concrète : soit vers le bien véritable, soit vers des fins inférieures. La volonté traduit donc l’orientation morale de l’homme.
Le mal est-il compatible avec la création divine chez Augustin ?
Oui. Augustin explique que le mal ne provient pas de la création elle-même, qui demeure bonne, mais d’un usage dévoyé de la liberté donnée par Dieu. Cette liberté reste un bien en soi, même si elle peut mener à des abus.
Quel rôle joue la foi dans la liberté selon Augustin ?
La foi n’est pas une contrainte mais un soutien à la volonté. Elle aide l’homme à s’orienter librement vers le bien suprême. Sans elle, la volonté risque de se disperser ou de se fixer sur des biens trompeurs.
En quoi la pensée d’Augustin se distingue-t-elle de celle des stoïciens ?
Les stoïciens acceptent un destin déterminé et définissent la liberté comme l’acceptation du sort. Augustin, au contraire, insiste sur la capacité personnelle à choisir le bien ou à s’en détourner, faisant de la volonté humaine un élément central de la liberté.