Le débat entre Freud et Sartre interroge la nature même de la liberté humaine. Est-elle un idéal inatteignable, prisonnière de l’inconscient, ou bien une condition incontournable de l’existence, même quand elle s’accompagne d’angoisse et de responsabilité ? Cette opposition invite à explorer en profondeur ce que signifie véritablement être libre.
Qu’est-ce que la liberté ? Un enjeu philosophique majeur

La liberté, vaste mot qui fait rêver et parfois soupirer… En termes simples, elle désigne d’abord la capacité d’agir selon sa propre volonté, sans contrainte majeure. Mais attention, la liberté ne se résume pas à faire tout ce qui nous passe par la tête ! On distingue souvent la « liberté de faire » (choisir son parfum de glace, par exemple) et la « liberté par rapport à soi-même » : savoir résister à la tentation du septième carré de chocolat. Hélas, la publicité et nos envies cachées brouillent parfois les cartes : choisir chocolat ou vanille semble anodin, mais qui n’a jamais été victime d’un désir mystérieux pour la saveur « du moment » ? Peut-on alors parler de choix libre ou simplement d’une illusion savamment emballée ?
Dans cette perspective, Sigmund Freud, fondateur de la psychanalyse, avance que l’être humain réduit ses marges de liberté face aux forces inconscientes qui l’habitent. Il voit l’homme comme un être traversé par des pulsions, souvent ignorant de ses véritables motivations. À l’inverse, Jean-Paul Sartre, chef de file de l’existentialisme, affirme que l’homme n’a d’autre choix que d’assumer sa liberté. Pour lui, chaque individu porte la responsabilité de ses actes : il ne saurait se retrancher derrière un déterminisme ou une influence inconsciente sans faire preuve de « mauvaise foi ».
Freud : l’homme, prisonnier de son inconscient
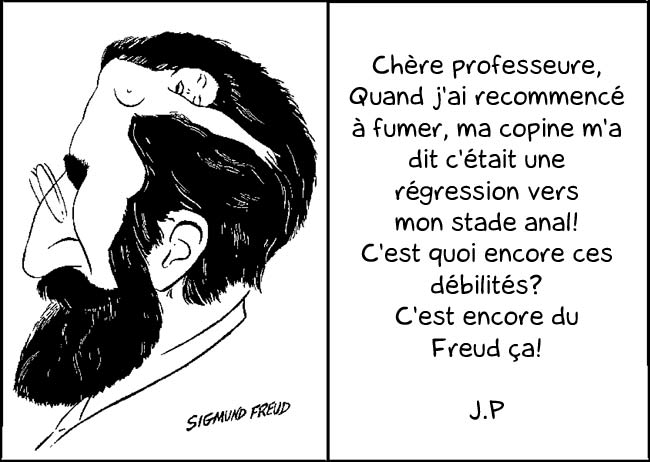
L’inconscient freudien, ce colocataire envahissant
Freud compare l’esprit humain à un iceberg : la partie visible, la conscience, n’est qu’une petite fraction. Sous la surface, l’inconscient occupe un territoire bien plus vaste, rempli de pensées, désirs et souvenirs refoulés qui nous échappent. Selon Freud, la plupart de nos décisions trouvent leur origine dans cette région obscure et inaccessible. Les motifs véritables de nos actions – envies, peurs, traumatismes – se cachent là, opérant sans que nous en soyons conscients.
L’inconscient n’est pas une simple réserve : il joue un rôle actif, façonne nos comportements et colore nos choix. Les désirs refoulés, les pulsions interdites et les souvenirs trop pénibles pour la conscience continuent d’agir, masqués sous d’autres formes. Comme un visiteur bruyant, l’inconscient frappe à la porte sous forme de rêves, de lapsus ou de réactions démesurées. D’un point de vue freudien, imaginer être complètement maître de ses choix relève donc de la douce illusion. L’inconscient agit sur nous plus qu’on ne veut bien l’admettre, et il faut une grande force pour prendre ses distances avec lui.
L’exemple du symptôme : peut-on vraiment choisir ?
Freud ne se contente pas de l’affirmer en théorie. Il en propose des exemples concrets, notamment à travers l’étude des symptômes. Un symptôme psychique ou corporel, selon Freud, n’est pas le fruit du hasard : il révèle un désir ou un conflit inconscient. Prenons le cas classique de la compulsion, comme se laver les mains sans cesse. Le « choix » de ce comportement n’est pourtant pas un choix conscient. C’est l’expression d’un conflit intérieur refoulé, qui trouve là un exutoire acceptable, ou du moins tolérable.
Le symptôme vient trahir ce à quoi on ne veut pas penser consciemment, en prenant la forme d’actions ou de troubles incontrôlables. Ainsi, Freud avance que beaucoup de nos symptômes, choix amoureux, phobies, ou même goûts particuliers, ne relèvent pas vraiment de la liberté, mais de l’inconscient à l’œuvre.
Y a-t-il alors une place pour la liberté ? Pour Freud, elle n’est possible qu’en gagnant en lucidité sur ses propres mécanismes inconscients. Son espoir : qu’une prise de conscience, grâce à l’analyse, permette d’arracher un peu de contrôle à ce colocataire invisible. En attendant, chaque symptôme rappelle que choisir librement reste, trop souvent, un vœu pieux – ou au moins une liberté surveillée.
Sartre : condamné à être libre (et à le supporter !)
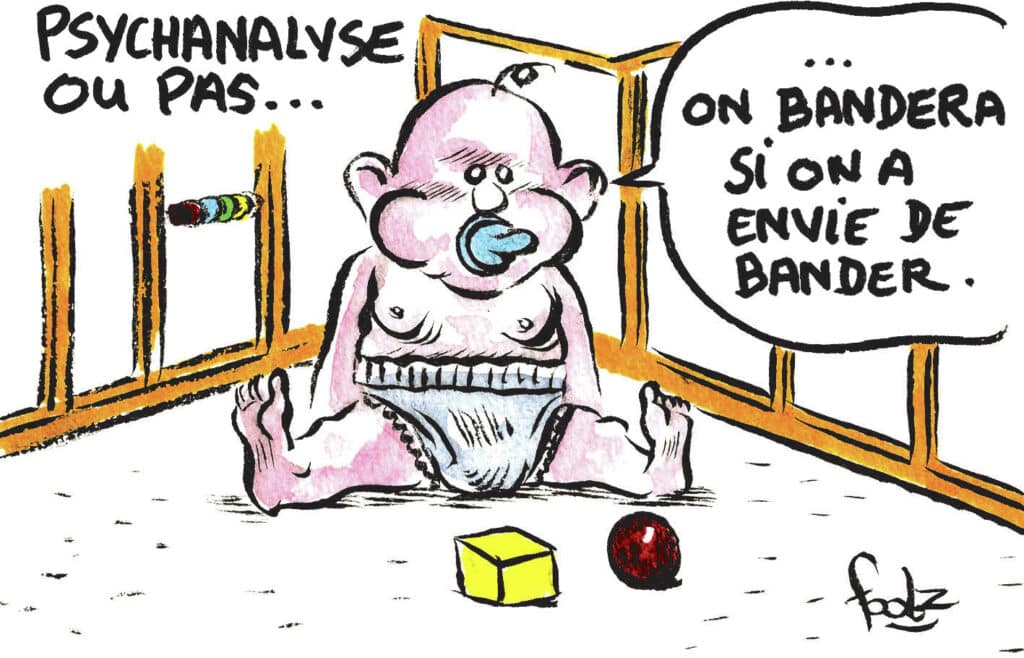
La liberté sartrienne : un cadeau empoisonné ?
Jean-Paul Sartre l’affirme sans détour : l’homme est « condamné à être libre ». Cela ressemble à un privilège, mais ce constat a tout d’un cadeau empoisonné. Selon Sartre, l’individu n’a pas choisi de venir au monde. Pourtant, une fois « jeté » dans l’existence, il doit assumer absolument chaque projet, chaque acte, chaque choix. Aucune échappatoire possible : impossible de blâmer ses parents, la société ou son humeur du matin pour ce qu’il est et ce qu’il fait. Même dans la contrainte, même en temps de guerre, la liberté s’exerce : c’est d’ailleurs là, en affrontant l’adversité, que s’exprime la liberté la plus authentique.
Être libre ne signifie pas faire n’importe quoi. Au contraire, cela veut dire se choisir soi-même à chaque instant, tracer sa propre voie – parfois au prix de l’angoisse ou du doute. C’est pourquoi la liberté, chez Sartre, a un goût amer : elle condamne chacun à inventer sa propre existence, sans excuse ni mode d’emploi.
La responsabilité de la liberté
Pour Sartre, la liberté n’est jamais gratuite. Elle engage immédiatement la responsabilité. L’homme ne peut plus se plaindre ni s’abriter derrière le destin ; il doit répondre de ses actes, devant lui-même et devant autrui. Sartre va même plus loin : nos choix ne façonnent pas seulement notre propre existence, ils engagent aussi l’humanité tout entière. Choisir, c’est proposer un modèle, exprimer des valeurs universelles par des actes particuliers.
La « mauvaise foi » consiste à refuser cette responsabilité, à prétendre que l’on subit ce que l’on fait, ou que l’on n’est pas vraiment auteur de ses propres choix. Jouer un rôle en société, comme le garçon de café qui incarne à la perfection les gestes de son métier, revient à fuir sa liberté – mais cette fuite demeure vaine : quoi qu’on fasse, on reste responsable de la manière dont on joue ce rôle.
Ce poids de la responsabilité rend la liberté inquiétante, voire épuisante. Il n’existe aucun refuge contre la nécessité de choisir, pas de guide suprême ni de garanties extérieures. Pour Sartre, espérer l’inverse, c’est rêver à un monde de poupées, sans grandeur ni tragique, mais aussi sans vie propre.
Liberté ou illusion ? Vers une synthèse nuancée
Sartre et Freud s’opposent souvent dans leur manière de penser la liberté : l’un place l’être humain face à une liberté radicale et écrasante ; l’autre montre un sujet miné par un inconscient qui échappe à toute volonté consciente. Mais la réalité de l’expérience humaine se situe rarement à un seul extrême.
Tout d’abord, il serait illusoire de croire que l’individu crée chaque décision à partir de zéro, vierge de toute influence. L’inconscient freudien nous rappelle que des forces obscures – souvenirs d’enfance, désirs refoulés, conditionnements – façonnent silencieusement nos goûts, nos peurs et parfois nos actes les plus quotidiens. En même temps, l’existence de ces déterminismes n’implique pas une absence totale de liberté. À certains moments, l’individu arrive à prendre du recul, à interroger ses propres motivations, à modifier certains comportements. La lucidité, le travail sur soi, ou tout simplement l’éducation, ouvrent des brèches dans le mur de l’inconscient.
Certains reprochent à Freud de négliger la part d’initiative et d’inventivité que chaque être humain peut déployer, même dans des situations difficiles. À l’inverse, la liberté sartrienne, en ignorant la puissance du passé et des automatismes psychiques, pèche par excès d’optimisme : qui peut se prétendre auteur absolu de son existence ? N’est-il pas parfois plus honnête d’admettre que nos choix se font à travers nous, bien plus que par nous ?
Ce qu’il faut retenir : la liberté comme conquête
Une vision équilibrée consiste alors à considérer la liberté non comme un don, ni comme un mirage, mais comme une conquête progressive. L’individu, certes traversé par d’innombrables influences, reste capable, à certains moments, de prendre la décision de ne pas agir simplement par impulsion ou habitude. Cette capacité à interroger ses choix, à faire retour sur soi, marque l’ouverture d’un espace de liberté – certes étroit, mais réel. Pour finir, la vraie question n’est pas tant « suis-je libre ? », mais « à quels moments le suis-je, et comment puis-je agrandir cet espace ? ». Entre illusions et actions conscientes, la liberté ressemble à une ascension : parfois essoufflée, parfois grisante, mais toujours inachevée.











