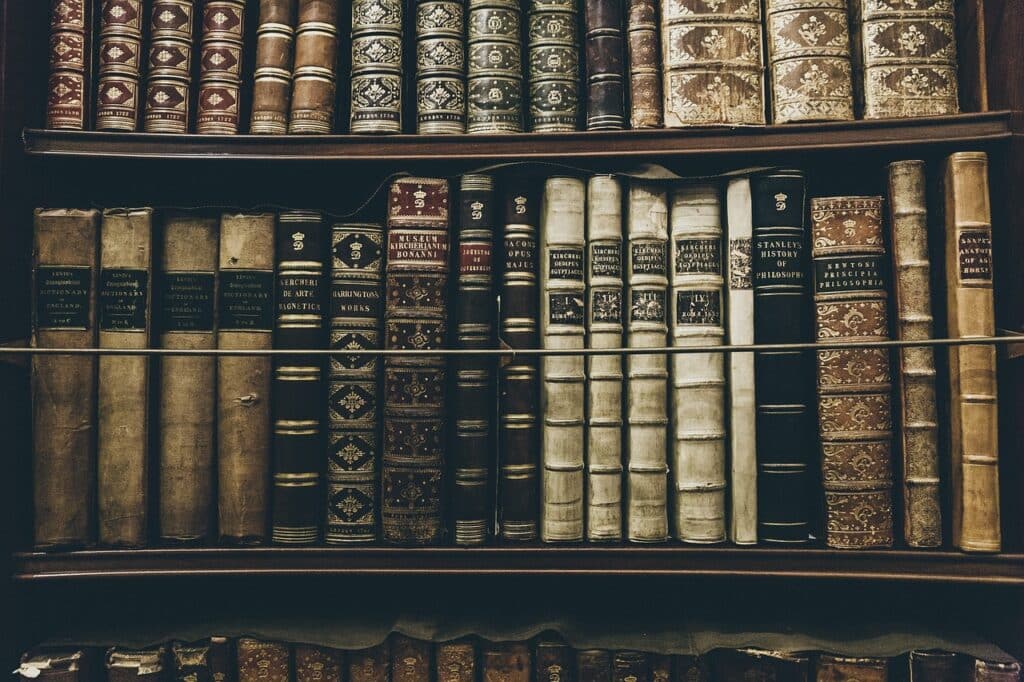« Je pense, donc je suis ». Tu as sûrement déjà entendu cette phrase. Mais que signifie-t-elle vraiment ? Et pourquoi Descartes en fait-il le point de départ de toute connaissance certaine ? Pour le comprendre, il faut revenir à son projet philosophique : fonder un savoir indiscutable, en repartant de zéro. Pour ça, il invente une méthode et pousse le doute jusqu’à l’extrême. Ce doute n’est pas un but, mais un moyen : il mène à une première certitude, le cogito, puis à une conception précise de ce qu’est l’être humain.
Le projet de Descartes : repartir de zéro
René Descartes (1596–1650) est un philosophe, mathématicien et scientifique français. Il vit au XVIIe siècle, à l’époque de la Révolution scientifique. C’est un siècle où les connaissances progressent rapidement (astronomie, physique, mathématiques…), mais où les enseignements de l’Église et des philosophes anciens sont remis en cause.
Il souhaite donc refonder entièrement le savoir, en adoptant une méthode inspirée des mathématiques : une méthode claire, rigoureuse, et à la portée de tous.
Il énonce ainsi quatre règles dans sa méthode :
Évidence : Ne tenir pour vrai que ce qui se présente clairement à l’esprit, sans aucune raison de douter.
Analyse : Décomposer les difficultés en éléments simples.
Synthèse : Reconstruire le raisonnement du plus simple au plus complexe.
Dénombrement : Passer tout en revue pour être sûr de n’avoir rien oublié.
En clair, Descartes ne cherche pas à accumuler les connaissances : il veut construire un savoir certain, solide, méthodique.
La méthode du doute pour atteindre la « vérité » chez Descartes
Pour appliquer cette méthode de réflexion, il faut commencer par faire le tri. Descartes décide donc de rejeter provisoirement tout ce qui peut être mis en doute.
Il identifie trois grandes raisons de douter :
Les sens peuvent nous tromper : il prend l’exemple d’un bâton plongé dans l’eau qui pourrait paraît tordu, alors qu’en réalité, il est droit. C’est une illusion d’optique. Si mes yeux peuvent me tromper dans ce cas, comment être sûr qu’ils ne me trompent pas aussi dans d’autres situations, même quand je suis éveillé ?
L’argument du rêve : il nous arrive souvent, en rêve, de croire que nous sommes en train de vivre quelque chose — assister à un cours, marcher dans la rue, discuter avec quelqu’un — sans nous rendre compte que nous dormons. Or, ces rêves nous paraissent tout à fait réels sur le moment. Rien ne permet donc d’affirmer avec certitude que ce que je vis actuellement n’est pas, lui aussi, un rêve.
L’hypothèse du Dieu trompeur : Descartes pousse le doute encore plus loin. Et si une puissance supérieure – Dieu ou un « génie malin » – me trompait systématiquement, même sur ce qui semble le plus évident, comme les vérités mathématiques ?
Le cogito de Descartes : première vérité certaine
En poussant le doute à son extrême, Descartes finit par trouver un point fixe : même si je doute de tout, je ne peux pas douter que je suis en train de douter. Et si je doute, c’est que je pense. Donc je suis.
« Cogito ergo sum » : « Je pense, donc je suis »
Ce raisonnement repose sur une intuition immédiate : penser prouve que j’existe. Même si tout est faux autour de moi, je ne peux pas me tromper sur le fait que je pense, ici et maintenant.
Ce « je » qui pense n’est pas défini par son corps, mais par son esprit. Il n’a pas besoin de voir, de toucher ou de bouger : il pense, donc il est.
L’homme, une double réalité : corps et esprit
En découvrant que le sujet pensant existe indépendamment du corps, Descartes introduit une distinction fondamentale entre deux réalités :
Le corps, substance matérielle, soumise aux lois de la nature.
L’esprit (ou l’âme), substance immatérielle, capable de penser, de douter, de vouloir.
C’est ce qu’on appelle le dualisme cartésien : l’être humain est composé de deux substances distinctes, unies mais séparables.
Ce dualisme a des conséquences philosophiques fortes :
L’esprit est libre, car il n’est pas déterminé comme le corps.
L’âme pourrait être immortelle, puisqu’elle n’est pas soumise aux lois matérielles.
Le doute chez Descartes n’est pas un scepticisme, mais une méthode pour atteindre une vérité indiscutable.
Cette vérité, c’est le cogito : même si tout est faux, le fait de penser prouve mon existence.
Cela conduit à une distinction entre le corps (matériel) et l’esprit (immatériel) : c’est le dualisme cartésien.
Conclusion
Avec sa méthode du doute, Descartes révolutionne la philosophie : il ne part plus des dogmes ou de l’expérience sensible, mais de la pensée elle-même. Le cogito est un point de départ radicalement nouveau, qui permet de reconstruire tout le savoir sur des bases solides. Ce raisonnement reste essentiel pour comprendre la nature humaine, la conscience, et le lien entre le corps et l’esprit. Il est donc un repère central dans de nombreuses dissertations, de la connaissance de soi à la liberté en passant par la vérité.
Le cogito de Descartes est très utile pour introduire une réflexion sur la conscience, le sujet, la vérité ou encore la liberté. Il peut intervenir à plusieurs niveaux dans une copie :
- Dans une introduction : pour montrer qu’on peut douter de tout, mais pas du fait que l’on pense. Cela permet d’amorcer une problématique sur ce qui est certain en nous.
- Dans un développement : pour défendre l’idée que ce qui définit l’homme, ce n’est pas son corps ou son apparence, mais le fait qu’il est capable de penser. (Par exemple dans une dissertation sur le sujet : « Suis-je ce que je pense ? »).