Peu de sujets concentrent autant de passions, de peurs et d’espérances que le nucléaire civil. Présenté par certains comme une solution indispensable pour affronter le défi climatique, il est dénoncé par d’autres comme une technologie risquée, coûteuse et surtout instrumentalisée à des fins de puissance. Derrière les réacteurs et les barres d’uranium, ce sont en réalité des enjeux géopolitiques majeurs qui se dessinent : maîtrise technologique, indépendance énergétique, rapports de force internationaux et stratégies d’influence. La question est donc brûlante : le nucléaire civil doit-il être vu comme une simple source d’électricité ou comme une arme subtile dans le jeu mondial des puissances ?
L’héritage historique du nucléaire : entre utopie et rivalités
Le nucléaire civil naît dans l’ombre du militaire. En 1953, le président américain Eisenhower lance son programme « Atoms for Peace », qui vise à promouvoir l’usage pacifique de l’atome. L’objectif officiel est noble : mettre une technologie issue de la guerre au service du développement. Mais en filigrane, il s’agit aussi de garder la mainmise sur un secteur hautement stratégique, en limitant l’accès incontrôlé aux techniques sensibles.

La France, par exemple, choisit très tôt l’indépendance énergétique à travers son programme nucléaire, amorcé dès les années 1960 et qui culmine dans les années 1980 avec une cinquantaine de réacteurs. Aujourd’hui encore, elle en tire plus de 70 % de son électricité. À l’inverse, l’Allemagne a acté sa sortie progressive du nucléaire à la suite de la catastrophe de Fukushima en 2011, privilégiant un mix fondé sur les énergies renouvelables et un recours accru au gaz russe. Or, cette stratégie a révélé ses fragilités lorsque la guerre en Ukraine a bouleversé les approvisionnements, exposant la dépendance allemande à Moscou et soulignant les risques d’un tel choix.
Le nucléaire civil est donc bien plus qu’une affaire de kilowattheures : il engage des choix de souveraineté et d’alliances.
Un outil d’indépendance énergétique… mais à double tranchant
L’un des grands arguments en faveur du nucléaire est sa capacité à réduire la dépendance aux hydrocarbures importés. Pour un pays comme la France, sans grandes ressources fossiles, c’est une garantie de sécurité énergétique. L’uranium, nécessaire au fonctionnement des centrales, est certes importé (notamment du Niger, du Kazakhstan ou du Canada), mais les besoins sont moindres et plus facilement stockables que pour le pétrole ou le gaz.
Cependant, cette indépendance est relative. Le Niger fournit près de 15 % de l’uranium utilisé en France, et l’instabilité politique récente dans ce pays a montré à quel point les chaînes d’approvisionnement peuvent être fragiles. Le Kazakhstan, premier producteur mondial de l’uranium, est lui-même dans une zone d’influence partagée entre la Russie et la Chine. Ainsi, posséder des réacteurs ne suffit pas : encore faut-il sécuriser ses approvisionnements en uranium et maîtriser les technologies d’enrichissement, ce qui ramène directement à la géopolitique.
La diplomatie du nucléaire : influence et alliances
Exporter du nucléaire, c’est exporter bien plus qu’une centrale : c’est aussi nouer des relations de dépendance de plusieurs décennies. Construire un réacteur implique formation des ingénieurs, maintenance, approvisionnement en combustible, retraitement des déchets… Autant de services qui lient durablement le pays client à son fournisseur.
La Russie, via Rosatom, est un acteur central de cette diplomatie. Elle finance, construit et exploite des centrales à l’étranger, comme en Turquie (centrale d’Akkuyu) ou en Égypte (El-Dabaa). Ce « paquet global » renforce son influence politique et économique. La Chine, quant à elle, s’impose progressivement en exportant ses propres technologies, notamment au Pakistan.

La France, avec EDF et Framatome, conserve une expertise de pointe, mais peine à rivaliser à l’international face à la stratégie agressive de Moscou ou Pékin. Les États-Unis, longtemps en retrait, tentent désormais de regagner du terrain, notamment avec des projets de SMR (Small Modular Reactors), censés être plus sûrs et plus flexibles.
Le nucléaire civil devient donc un outil de soft power, un moyen d’asseoir sa présence dans des régions stratégiques.
Les critiques du nucléaire : coûts, risques et dépendances cachées
Si le nucléaire fascine, il divise aussi profondément. Les critiques s’articulent autour de trois axes principaux.
Le premier est économique. Le coût du nucléaire ne cesse d’augmenter. Le chantier de l’EPR de Flamanville illustre ces dérives : prévu initialement à 3 milliards d’euros, il approche désormais les 20 milliards, avec plus de dix ans de retard. De tels investissements interrogent la rentabilité dans un contexte où les énergies renouvelables (éolien, solaire) voient leurs coûts baisser.
Le deuxième est sécuritaire. Tchernobyl en 1986 et Fukushima en 2011 ont marqué durablement les esprits. Si les normes de sûreté se sont renforcées, le risque zéro n’existe pas. La guerre en Ukraine, avec les combats autour de la centrale de Zaporijjia, rappelle que le nucléaire civil peut devenir un enjeu militaire, transformant une centrale en arme de dissuasion indirecte.

Enfin, le troisième est lié aux déchets. La question de leur stockage à long terme reste non résolue dans de nombreux pays. La France mise sur le projet CIGÉO à Bure, destiné à enfouir les déchets les plus radioactifs, mais il suscite une vive opposition locale.
Entre outil énergétique et arme géopolitique : une frontière floue
Ce qui rend le nucléaire unique, c’est la proximité entre ses usages civils et militaires. Les technologies d’enrichissement de l’uranium ou de retraitement du plutonium, indispensables pour les centrales, peuvent aussi être détournées pour fabriquer l’arme atomique. L’Iran en est l’exemple le plus emblématique : officiellement, Téhéran développe un programme civil ; en réalité, la communauté internationale soupçonne depuis des années une ambition militaire.
Ainsi, tout développement nucléaire civil est scruté avec suspicion par les grandes puissances. C’est pour cela que l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) joue un rôle crucial de surveillance. Mais ses marges de manœuvre restent limitées face aux volontés souveraines des États.
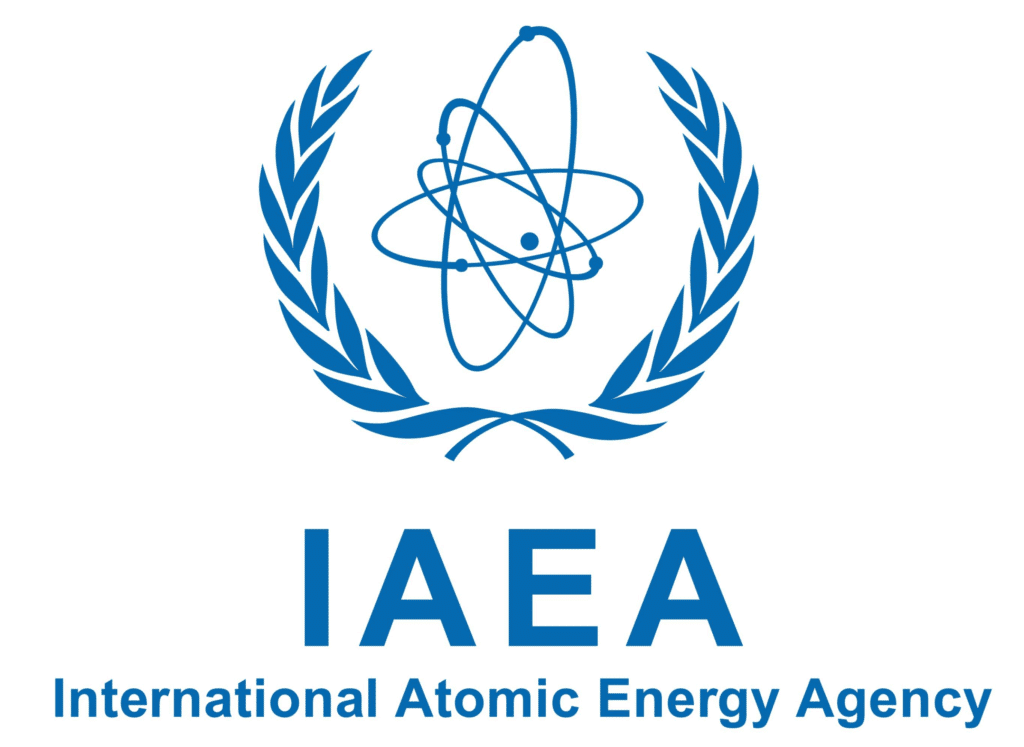
Le nucléaire civil est donc à la fois un outil énergétique essentiel et une arme géopolitique subtile.
Vers une « renaissance » nucléaire ?
La crise climatique redonne un souffle au nucléaire. Pour atteindre la neutralité carbone, certains estiment impossible de se passer de cette source d’énergie, qui n’émet presque pas de CO₂ lors de la production. La France a annoncé la construction de six nouveaux EPR, tandis que d’autres pays (Royaume-Uni, Pologne, Inde) relancent leurs programmes.
Mais cette renaissance se heurte à des réalités contradictoires : montée des renouvelables, contestations locales, coûts colossaux, lenteur des chantiers. L’avenir du nucléaire dépendra donc de la capacité des États à convaincre leurs populations et à sécuriser leurs approvisionnements stratégiques.

Quiz : es-tu incollable sur le nucléaire civil ?
- Quelle part de l’électricité française provient du nucléaire ?
- Quel pays est le premier producteur mondial d’uranium ?
- Quelle organisation internationale surveille l’usage civil du nucléaire ?
- Quel accident nucléaire a eu lieu en 2011 au Japon ?
- Quel est le principal atout du nucléaire face au changement climatique ?
Réponses :
- Environ 70 %.
- Le Kazakhstan.
- L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).
- Fukushima.
- Sa faible émission de CO₂ lors de la production d’électricité.
Le nucléaire : miroir des rapports de force mondiaux
Le nucléaire civil est bien plus qu’une technologie énergétique. Il cristallise les dilemmes de notre époque : répondre aux besoins croissants en électricité, lutter contre le changement climatique, réduire les dépendances aux énergies fossiles, tout en assumant des coûts astronomiques et des risques durables. Mais surtout, il révèle les logiques de puissance. Chaque centrale construite, chaque accord signé est une pièce dans un vaste échiquier mondial où se croisent ambitions énergétiques et stratégies d’influence. Le nucléaire civil n’est pas seulement un outil énergétique, il est aussi une arme géopolitique silencieuse, façonnant les équilibres du XXIe siècle.











