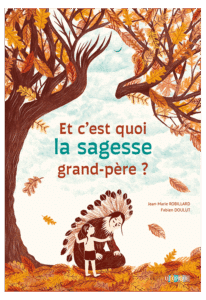En 1963, Martin Luther King écrivait depuis sa cellule de Birmingham : « Une loi injuste n’est pas une loi. » Il dénonçait la ségrégation raciale, alors encore légale dans certains États américains. Cet exemple illustre une question fondamentale : une loi est-elle juste parce qu’elle est votée et appliquée, ou doit-elle répondre à un idéal supérieur?
📍Le mot « justice » évoque à la fois un idéal moral (ce qui est juste) et une institution (celle qui applique les lois). De même, le « droit » désigne à la fois un ensemble de règles (le droit positif) et ce à quoi chacun peut prétendre (avoir des droits). Cela soulève une question importante : une loi est-elle forcément juste, simplement parce qu’elle est légale ? Ou faut-il au contraire distinguer la justice de ce que la loi commande ?
Le droit désigne l’ensemble des règles et des lois qui organisent la vie en société. Il est établi par les institutions légales (État, tribunaux, assemblées) et s’impose à tous par la contrainte. Mais le droit est-il toujours juste ? La justice, en effet, renvoie à un idéal moral d’équité, de respect et de bien commun. Elle dépasse la simple légalité. Ainsi, une loi peut-elle être injuste ? Faut-il toujours obéir à la loi ? Ou peut-on parfois la contester au nom d’une justice supérieure ? C’est toute la complexité du rapport entre droit et justice qui se pose ici.
Lorsque le sujet pose une question normative (qu’est-ce qu’une loi juste ?), il faut interroger les critères qui permettraient de juger une loi. On ne cherche pas à dire ce qu’est « la meilleure loi » mais à comprendre ce qui rend une loi légitime du point de vue de la justice. On pourra opposer droit et justice, puis chercher à les articuler.
Une loi juste est-elle simplement une loi légale ?
À première vue, on pourrait penser qu’une loi juste est simplement une loi conforme au droit, c’est-à-dire adoptée légalement par des représentants légitimes. Dans une démocratie, les lois sont votées, débattues, inscrites dans un cadre constitutionnel : elles sont donc censées garantir la justice.
C’est la vision que propose Platon dans La République. Il imagine une cité idéale où chaque individu occupe la place qui lui convient en fonction de sa nature. Selon lui, la justice consiste à ce que chaque classe de la société (les producteurs, les gardiens et les gouvernants) accomplisse sa fonction sans empiéter sur celle des autres. La loi est donc juste lorsqu’elle maintient cette harmonie, lorsqu’elle permet à chacun de contribuer à l’ordre global. Platon insiste aussi sur le rôle des philosophes-rois, seuls capables de connaître le Bien en soi, et donc d’établir des lois vraiment justes. Il critique les sociétés gouvernées par la passion ou par l’argent, comme la démocratie ou la tyrannie, qui mènent selon lui au désordre.
Dans une perspective plus concrète, Aristote, dans son Éthique à Nicomaque, distingue deux formes de justice. La justice distributive vise à répartir les biens ou les charges en fonction du mérite ou des besoins, tandis que la justice corrective intervient pour rétablir l’équilibre après un tort (par exemple, dans un litige civil ou un procès pénal). La loi est donc l’outil de la justice, à condition qu’elle respecte l’égalité proportionnelle : traiter chacun selon sa situation, et non de façon strictement identique. Une loi juste est ainsi une loi qui vise le bien commun en corrigeant les inégalités et en protégeant l’équilibre social.
Plus tard, Montesquieu, dans L’Esprit des lois, insiste sur l’idée que les lois doivent être adaptées aux particularités des peuples : leur histoire, leur climat, leurs coutumes. Une loi juste n’est pas nécessairement universelle : elle est celle qui correspond à un contexte précis. Montesquieu rappelle aussi que pour qu’une loi soit juste, il faut éviter l’abus de pouvoir. D’où l’importance, selon lui, de la séparation des pouvoirs (législatif, exécutif, judiciaire), afin que la loi ne devienne pas un instrument d’oppression.
Ainsi, plusieurs penseurs affirment que la loi, lorsqu’elle est bien faite, peut incarner la justice. Mais l’histoire nous montre que certaines lois ont été injustes malgré leur légalité. Cela nous oblige à distinguer ce qui est légal de ce qui est moralement juste.
Une loi peut-elle être injuste ?
Obéir à la loi semble être un devoir de tout citoyen. Mais que faire si cette loi est injuste ? Peut-on la contester ? La désobéir ? C’est ici qu’intervient la distinction entre droit positif (le droit en vigueur, posé par les institutions) et droit naturel (des principes de justice valables en tout temps et en tout lieu).
Dès l’Antiquité, Cicéron affirme qu’il existe une loi naturelle, supérieure à toutes les lois humaines, inscrite dans la nature même de l’homme. Cette idée sera reprise au XVIIe siècle par Hugo Grotius, puis au XVIIIe siècle par les penseurs des droits de l’homme. Selon eux, il existe des droits fondamentaux – liberté, égalité, dignité – que toute loi doit respecter. Si une loi viole ces droits, elle est injuste.
Cette opposition apparaît clairement dans la pièce Antigone de Sophocle. L’héroïne, Antigone, refuse d’obéir à l’ordre du roi Créon qui interdit d’enterrer son frère. Elle invoque une loi divine, plus ancienne et plus juste que celle des hommes. Pour elle, la justice ne se réduit pas au respect du pouvoir en place. Cette pièce pose déjà, au Ve siècle av. J.-C., la question fondamentale du conflit entre légalité et justice.
Au XXe siècle, Martin Luther King reprend cette idée dans sa Lettre de la prison de Birmingham (1963). Il y affirme qu’il existe des lois justes, qui élèvent la dignité humaine, et des lois injustes, qui l’avilissent. Il soutient que l’on a parfois le devoir moral de désobéir à la loi, quand celle-ci perpétue l’injustice. Cette désobéissance civile doit être non-violente, publique et motivée par un idéal supérieur. Ainsi, refuser d’obéir à une loi injuste n’est pas un acte d’anarchie, mais une forme de fidélité à la véritable justice.
John Rawls, philosophe contemporain, propose des critères précis pour juger la justice d’une loi dans sa Théorie de la justice. Il imagine une « position originelle » dans laquelle chacun choisirait les principes de justice sans savoir quelle place il occupera dans la société (ce qu’il appelle le « voile d’ignorance »). Une loi est juste si elle peut être acceptée par tous, même les plus défavorisés. Elle doit garantir les libertés fondamentales, assurer l’égalité des chances, et permettre des inégalités seulement si elles profitent aux plus faibles. Pour Rawls, la loi ne tire pas sa légitimité de son adoption formelle, mais de son équité morale.
On comprend alors qu’une loi peut être injuste, même si elle est conforme au droit. Elle doit être jugée à l’aune de principes supérieurs : respect de la dignité humaine, égalité des droits, liberté fondamentale. La légalité ne suffit pas à fonder la justice.
Peut-on concilier droit et justice ?
Faut-il alors se méfier du droit ? Pas nécessairement. Le droit reste un outil indispensable pour organiser la société. Mais il doit sans cesse être interrogé, corrigé, amélioré pour se rapprocher de l’idéal de justice.
Kant, dans La Métaphysique des mœurs, affirme que la justice ne peut être fondée que sur des principes universels. Une loi est juste si elle peut être « universalisée » : c’est-à-dire si chacun peut vouloir qu’elle s’applique à tous, sans exception. Ce principe est connu sous le nom d’impératif catégorique. Kant insiste aussi sur le respect de la personne humaine comme fin en soi : la loi ne doit jamais traiter quelqu’un comme un simple moyen, mais toujours comme un être libre et digne.
Dans cette perspective, une loi est juste si elle est fondée sur la raison, la liberté et l’égalité. Elle doit pouvoir être acceptée par tous, non parce qu’on y est contraint, mais parce qu’elle est moralement légitime.
Paul Ricœur propose une approche plus relationnelle. Il estime que la justice ne consiste pas seulement à appliquer des règles, mais à reconnaître l’autre dans sa singularité. Une loi juste est une loi qui permet à chacun d’être respecté dans ce qu’il est, pas seulement comme un citoyen abstrait, mais comme une personne avec son histoire, sa culture, ses vulnérabilités. Il invite à penser une justice du dialogue, de la reconnaissance, de l’écoute.
Concilier droit et justice, c’est donc faire en sorte que les lois ne soient pas seulement efficaces ou légales, mais aussi équitables, humaines, évolutives. Une démocratie vivante est celle qui accepte de remettre en question ses propres règles, qui écoute les minorités, qui réforme ses lois quand elles deviennent injustes.
Conclusion
Une loi n’est pas nécessairement juste simplement parce qu’elle est légale. La justice ne se réduit pas à l’application du droit : elle en est la finalité profonde, ce à quoi le droit doit tendre. Une loi est juste si elle respecte la dignité humaine, l’égalité, la liberté. Elle est injuste si elle opprime, discrimine ou viole les droits fondamentaux.
Pour les citoyens, pour les juges, pour les législateurs, cette tension entre justice et droit est un défi constant. Mais c’est aussi ce qui rend la démocratie vivante : la capacité à faire du droit un chemin vers la justice, et non un simple outil de pouvoir.
➤ Le droit désigne l’ensemble des lois et des règles juridiques, tandis que la justice renvoie à un idéal moral d’équité.
➤ Une loi juste respecte la dignité humaine, garantit la liberté et protège les plus vulnérables.
➤ Des penseurs comme Platon, Aristote, Kant, Rawls ou Luther King nous invitent à toujours interroger nos lois à l’aune de la justice.
➤ Il ne suffit pas qu’une loi soit votée pour être juste : elle doit pouvoir être acceptée rationnellement et moralement par tous.