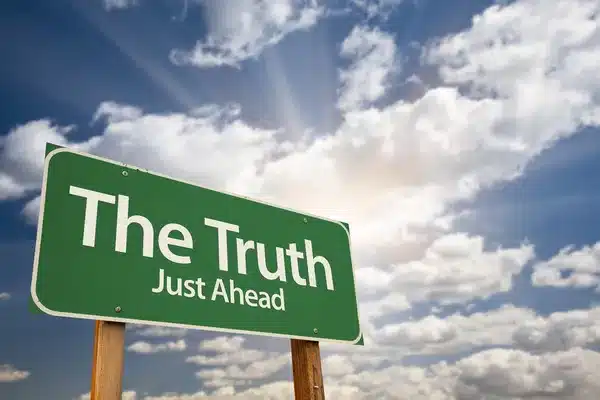La vérité est l’un des grands thèmes du programme de philosophie au bac. Elle traverse aussi bien les sciences que la morale, l’histoire ou la politique. Mais peut-on vraiment parler d’une vérité unique, définitive, universelle ? Ou devons-nous accepter que toute vérité dépend d’un point de vue ou d’un contexte ? Cette question, aussi simple en apparence que redoutable en profondeur, oblige à distinguer entre vérité absolue et vérités relatives, pour mieux comprendre ce qui fonde nos croyances et nos connaissances.
📌 Vérité : une proposition est dite vraie lorsqu’elle correspond à la réalité ou qu’elle est cohérente avec un raisonnement. En philosophie, la vérité peut être envisagée de différentes manières : comme correspondance avec les faits (théorie classique), comme cohérence logique, ou encore comme consensus entre les esprits rationnels.
📌 Absolu / Relatif : bien faire la différence
- Absolu : ce qui ne dépend d’aucune condition, valable toujours et partout.
- Relatif : ce qui dépend du contexte, du point de vue ou de la culture.
- En dissertation, montre bien dans chaque partie à quel type de vérité tu fais référence.
💡Méthode : en dissertation, il est essentiel d’analyser en détail les mots du sujet. Ce travail te permettra presque toujours de construire ton plan. Ici, par exemple, il faudra bien distinguer vérité absolue et vérités relatives.
Il existe des vérités absolues : la vérité comme fondement stable
Certaines vérités semblent valables en tout lieu, en tout temps, pour tout esprit rationnel. Par exemple : « 2 + 2 = 4 » ou « un tout est plus grand qu’une de ses parties ». Ces vérités ne dépendent pas de l’opinion, de la culture ou de l’époque : elles sont issues de la raison. Elles forment ce qu’on appelle des vérités absolues.
Dans la célèbre allégorie de la caverne, Platon montre que la majorité des hommes prennent les apparences pour la réalité. Les prisonniers, enchaînés depuis toujours dans une grotte, voient des ombres sur un mur : pour eux, cela est la vérité. Mais si l’un d’eux se libère et monte vers la lumière du soleil, il découvre un monde supérieur, celui des Idées : les réalités invisibles, parfaites, éternelles (comme la Justice ou la Beauté). Ce monde intelligible représente la vérité absolue, que seul le philosophe peut atteindre par un effort de raisonnement et d’éducation.
De son côté, Descartes, dans le Discours de la méthode, cherche une vérité indubitable. Il doute de tout, mais découvre que le simple fait de douter prouve qu’il pense, et donc qu’il existe : « Je pense, donc je suis ». Cette vérité est absolue, car elle ne dépend d’aucune perception, d’aucun contexte extérieur. Elle repose uniquement sur la pensée elle-même.
Enfin, certains principes moraux sont parfois considérés comme universels. Par exemple, affirmer qu’il est injuste de faire souffrir un innocent semble vrai indépendamment des opinions ou des cultures. C’est ce que défendent les droits de l’homme : une vérité morale commune à toute l’humanité.
Mais la vérité est souvent relative : elle dépend d’un point de vue ou d’un cadre
Face à cette idée d’une vérité universelle, certains philosophes rappellent que la vérité dépend souvent du point de vue de chacun. Ce que l’on considère comme vrai peut varier selon la culture, l’époque, la langue, la situation. On parle alors de vérité relative.
C’est la position des sophistes comme Protagoras, qui écrit : « L’homme est la mesure de toute chose ». Cela signifie qu’il n’existe pas de vérité en soi : chacun juge du vrai selon sa perception, son expérience. Il n’y a donc que des opinions, plus ou moins argumentées ou partagées.
Nietzsche se montre encore plus radical dans sa pensée. Pour lui, la vérité n’est qu’une illusion utile, une convention imposée par une époque ou un pouvoir. Il écrit que « les vérités sont des illusions dont on a oublié qu’elles le sont ». Ce que nous appelons « vérité » est en réalité une interprétation du monde, jamais neutre, toujours marquée par nos valeurs, notre langue, nos intérêts.
Même en science, la vérité évolue. Un exemple frappant est celui des théories raciales, qui ont été présentées comme scientifiques du XVIIIᵉ au XXᵉ siècle. Des penseurs comme Arthur de Gobineau, dans son Essai sur l’inégalité des races humaines (1853), affirmaient que certaines races étaient naturellement supérieures à d’autres. Ces théories s’appuyaient sur des classifications physiques (forme du crâne, couleur de peau, etc.) et prétendaient fonder sur la biologie des hiérarchies sociales et politiques. Ainsi, même la science n’est pas à l’abri de l’influence du contexte culturel ou politique. Ce qu’on tenait pour vrai à un moment donné peut être réfuté plus tard.
La vérité absolue : un idéal régulateur plus qu’une réalité possédée
Faut-il alors renoncer à l’idée de vérité absolue ? Pas forcément. Certains philosophes proposent une position intermédiaire : la vérité n’est peut-être jamais totalement accessible, mais elle peut rester un idéal qui guide notre pensée.
Kant distingue ce que nous percevons (« les phénomènes ») de la réalité en elle-même (« la chose en soi »). Selon lui, nous ne pouvons jamais connaître directement cette réalité. Mais notre raison agit comme si une vérité absolue existait. Cet idéal nous pousse à chercher, à confronter nos idées, à corriger nos erreurs. La vérité absolue devient alors une exigence de rigueur, même si elle reste inatteignable.
C’est aussi ce que pense Karl Popper. En science, dit-il, on ne peut jamais prouver qu’une théorie est vraie une fois pour toutes. On peut seulement dire qu’elle n’a pas encore été réfutée. Autrement dit : la science avance en éliminant les erreurs. La vérité est une limite idéale, non une certitude acquise.
Dans d’autres domaines comme la justice ou l’histoire, la même logique s’applique. On sait que les témoignages peuvent être biaisés, les faits mal transmis, les récits orientés. Et pourtant, on continue à chercher la version la plus cohérente, la plus fidèle, la plus juste possible. La vérité absolue est peut-être une idée asymptotique : on ne l’atteint jamais pleinement, mais elle donne un sens à notre recherche.
Conclusion
Il existe bien des vérités qui semblent absolues : en mathématiques, en logique, ou dans certaines règles morales universelles. Pourtant, de nombreux domaines montrent que la vérité dépend d’un contexte, d’un regard, d’une époque. Plutôt que de trancher définitivement, on peut dire que la vérité absolue est un horizon : elle n’est peut-être jamais atteinte, mais elle reste une exigence intellectuelle et morale. C’est parce qu’on croit qu’une vérité est possible qu’on continue à chercher, à débattre, à questionner. Et cette quête donne tout son sens à l’exercice philosophique.
À retenir
- La vérité absolue est une vérité valable en tout temps, en tout lieu, pour tous. Elle s’oppose à la vérité relative, qui dépend du point de vue, du contexte ou de l’époque.
- Certains domaines comme les mathématiques ou la logique donnent l’impression d’atteindre des vérités absolues.
- Mais dans la morale, la politique, l’histoire ou même les sciences expérimentales, la vérité semble souvent dépendante d’un cadre particulier.
- Plutôt que de trancher, on peut penser la vérité comme un idéal régulateur : elle guide notre quête de savoir, même si elle reste partiellement hors d’atteinte.