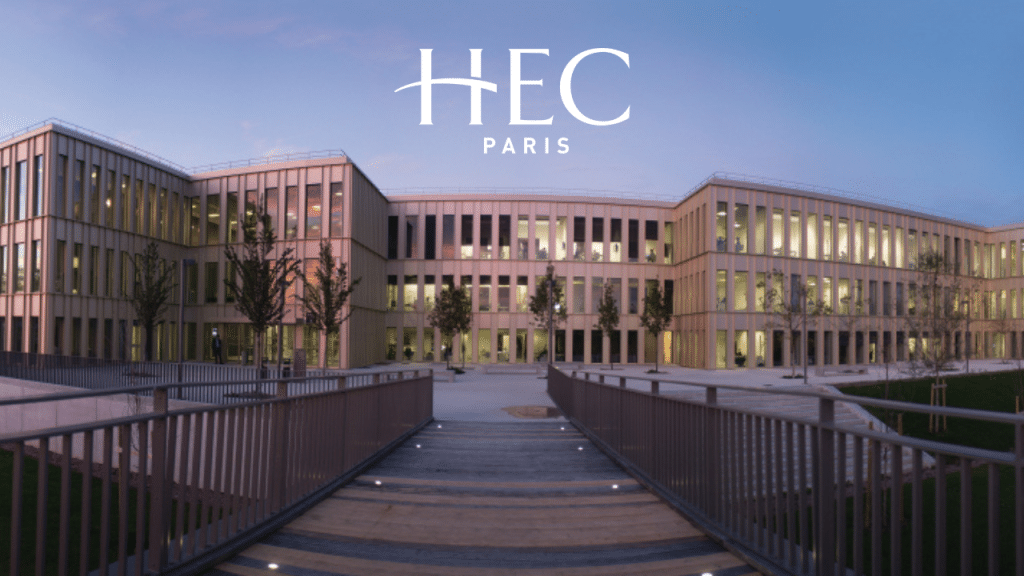Obtenir un diplôme, c’était autrefois la garantie d’un bon emploi et d’un avenir stable. Par exemple, en France, 85 % des diplômés de l’enseignement supérieur trouvaient un emploi un an après leur sortie en 2010. Mais en 2025, ce chiffre a chuté à 70 %, tandis que les recruteurs valorisent de plus en plus l’expérience et les compétences informelles. Alors, le diplôme reste-t-il vraiment la clé de la réussite ou devient-il un simple sésame parmi d’autres ? Cet article décrypte ce rôle complexe, entre promesse sociale et réalités économiques.
Le diplôme : un sésame encore valorisé dans la société

ne preuve de compétences et un signal pour l’employeur
Depuis le tournant du XXe siècle, les diplômes se sont imposés comme des marqueurs centraux des parcours professionnels. Le diplôme est, en apparence, une simple preuve d’acquisition de compétences utiles sur le marché du travail. C’est ce que soutient l’économiste américain Gary Becker, père de la théorie du capital humain : l’éducation augmente la productivité de l’individu et justifie des salaires plus élevés. Le diplôme représente alors un stock de compétences codifiées, théoriques comme pratiques, que l’on peut mobiliser dans l’entreprise.
Mais cette lecture fonctionnaliste est aujourd’hui insuffisante. Dans une célèbre étude de 1973, Michael Spence démontre que le diplôme fonctionne surtout comme un signal sur le marché du travail. En situation d’asymétrie d’information, où l’employeur ne connaît pas les capacités réelles du candidat, le diplôme agit comme un indicateur crédible de qualité : il révèle, indirectement, des traits tels que la discipline, la rigueur ou la capacité à obéir à des normes. Peu importe, dans cette logique, que le contenu des études soit directement utile à l’emploi concerné : le diplôme certifie une disposition à l’effort.
Ce rôle de signal est particulièrement fort en France. La sociologue Marie Duru-Bellat, dans L’École des filles (1990) puis Le mérite contre la justice (2009), montre que les employeurs français ont une forte culture du diplôme comme critère de tri, plus qu’en Allemagne ou dans les pays anglo-saxons. Ainsi, selon l’enquête France Stratégie 2025, 73 % des offres d’emploi en France mentionnent un niveau de diplôme requis, contre seulement 41 % aux États-Unis (Brookings Institution, 2024). Et plus de 50 % des offres précisent un diplôme ou une école précise (master, BTS, HEC…), ce qui souligne l’importance du label scolaire dans le recrutement.
Dans ce cadre, la hiérarchie des diplômes n’est pas neutre : elle reflète une hiérarchie sociale préexistante. Les employeurs ne recrutent pas seulement sur la base d’un niveau d’études, mais aussi du prestige associé à l’établissement. Un master d’une université de province n’a pas la même valeur qu’un diplôme de grande école, même pour des compétences proches. Cette logique, bien étudiée par la sociologue Annabelle Allouch dans La Société du concours (2017), s’explique par le fait que les grandes écoles françaises (HEC, Sciences Po, Polytechnique) produisent des diplômés immédiatement identifiables, supposés opérationnels et socialement proches des recruteurs eux-mêmes, souvent issus du même milieu.
Selon une étude du Cabinet Korn Ferry (2024), 93 % des cadres dirigeants français issus du CAC 40 ont un diplôme de grande école, et près de 70 % des cabinets de conseil en stratégie ne recrutent que dans une dizaine d’écoles identifiées. À compétence égale, le diplôme devient alors un marqueur social codé – un signal non seulement de performance scolaire, mais d’appartenance à un entre-soi.
Cette tendance peut conduire à des biais dans les recrutements : un étudiant de l’université avec de l’expérience professionnelle pourra être écarté au profit d’un diplômé d’école réputée mais sans stage, simplement en raison du signal perçu. Ce phénomène est accentué dans les secteurs élitistes (finance, conseil, institutions publiques). Il explique en partie la défiance de certains jeunes diplômés vis-à-vis du monde du travail, et l’émergence de discours critiques sur la « dictature du diplôme ».
Un outil de hiérarchisation sociale
Le diplôme n’est pas seulement une passerelle vers l’emploi, il constitue également un instrument de hiérarchisation sociale, particulièrement en France. Depuis le XIXe siècle, l’école républicaine s’est voulue méritocratique, promettant à chacun une promotion sociale par l’instruction. Mais dans les faits, elle reproduit largement les inégalités sociales, comme l’ont montré Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron dans Les Héritiers (1964) puis La Reproduction (1970). Ils soulignent que l’école valorise les dispositions culturelles des classes favorisées (le « capital culturel »), et que les diplômes deviennent des titres légitimes qui entérinent une domination sociale déguisée en mérite individuel.
Cette reproduction est particulièrement marquée dans le modèle éducatif français, fondé sur une double hiérarchisation : entre les filières (générale, technologique, professionnelle), mais aussi entre l’université et les Grandes Écoles, accessibles via les classes préparatoires. Ce système sélectif est unique en Europe. Les Grandes Écoles – HEC, Polytechnique, Sciences Po, ENS – concentrent l’élite dirigeante : 70 % des membres du CAC 40, 90 % des hauts fonctionnaires passés par l’ENA (désormais INSP), ou encore une majorité des cadres supérieurs des grandes entreprises françaises. Or, selon le sociologue François Dubet, ce système fonctionne comme une « loterie sociale biaisée », qui consacre ceux qui maîtrisent les codes attendus dès le lycée.
Les chiffres illustrent cette mécanique. En 2025, selon l’Observatoire des inégalités, un enfant de cadre a 15 fois plus de chances d’intégrer une classe préparatoire qu’un enfant d’ouvrier. Cette sélection sociale se retrouve dans les Grandes Écoles : à HEC, moins de 5 % des étudiants ont un parent ouvrier (chiffre confirmé par le dernier rapport du MESR, 2024), tandis que les lycées qui envoient le plus d’élèves en prépa (Louis-le-Grand, Henri IV, Stanislas…) sont concentrés dans les quartiers aisés.
Le diplôme conserve pourtant une valeur économique forte. D’après la DARES (2025) :
- Le taux de chômage est de 13,2 % chez les non-diplômés,
- 7,9 % chez les bacheliers,
- et 4 % pour les diplômés de master ou grandes écoles.
De même, selon l’INSEE, un diplômé de grande école gagne en moyenne 1,9 fois plus qu’un titulaire de bac +2 cinq ans après l’entrée dans la vie active.
Mais cette hiérarchisation produit un effet pervers : elle fétichise certains diplômes et dévalorise d’autres parcours, notamment ceux de l’université, pourtant majoritaires. Cela contribue à une forme de stratification scolaire où le prestige du diplôme prévaut sur les compétences réelles. Louis Chauvel parle de « déclassement relatif » : les jeunes diplômés occupent souvent des emplois moins qualifiés que ceux qu’occupaient leurs parents au même niveau de diplôme, ce qui alimente frustration et doute sur l’efficacité réelle de l’école comme ascenseur social.
À l’international, ce modèle élitiste contraste avec des systèmes plus ouverts comme celui de l’Allemagne (formation duale, pas de séparation nette entre filières) ou de la Suède (intégration entre universités et écoles professionnelles). Des systèmes comme ceux de l’Allemagne ou des pays nordiques valorisent davantage les compétences concrètes, l’apprentissage en entreprise ou l’évaluation directe des savoir-faire. Ainsi, en Allemagne, moins de 30 % des employeurs exigent un diplôme spécifique dans leurs offres d’emploi (Statistisches Bundesamt, 2023), préférant des entretiens approfondis et des épreuves techniques. En France, l’attachement au diplôme comme filtre social reste particulièrement fort.
Les limites du diplôme comme critère unique de réussite

Des inégalités persistantes dans l’accès aux diplômes
En théorie, le diplôme garantit l’égalité des chances. En pratique, l’accès reste profondément inégalitaire en France. Raymond Boudon, dans L’inégalité des chances (1973), a analysé ce paradoxe. Il montre que les décisions scolaires dépendent du milieu social, même à mérite égal. En 2024, les données confirment son analyse. 72 % des enfants de cadres obtiennent un diplôme du supérieur long. Ce taux chute à 32 % chez les enfants d’ouvriers (ministère de l’Éducation nationale, 2024).
Ces inégalités s’expliquent par l’accès différencié au capital culturel, selon Pierre Bourdieu. Dans La Reproduction (1970), il montre que l’école valorise les codes des classes dominantes. Ces codes ne sont pas universels. Les filières sélectives restent très peu accessibles aux élèves modestes. Moins de 10 % des élèves de grandes écoles sont issus de milieux populaires (CEREQ, 2024).
La sociologue Camille Peugny, dans Le Déclassement (2009), parle de reproduction sociale cachée sous l’idéal méritocratique. L’égalité formelle des règles masque des inégalités réelles d’accès. Les politiques publiques n’ont pas totalement corrigé ces écarts. Les Cordées de la Réussite ou les conventions de Sciences Po ont un impact limité à grande échelle.
À l’étranger, certains pays font mieux. En Finlande, les performances scolaires sont deux fois moins liées à l’origine sociale qu’en France (OCDE, PISA 2022). En France, l’orientation scolaire reste très marquée par le milieu. La ségrégation scolaire dans les grandes villes renforce ces écarts. Les lycées d’élite recrutent souvent les mêmes profils sociaux. Enfin, l’autocensure et le manque d’information freinent les choix ambitieux. L’école ne compense pas toujours les inégalités sociales : elle peut aussi les reproduire.
Le diplôme ne garantit plus un emploi adapté
En France, obtenir un diplôme ne suffit plus à accéder à un emploi qualifié, bien rémunéré ou stable. Louis Chauvel, dans Les classes moyennes à la dérive (2006), parle d’un décrochage entre diplôme et statut. L’ascenseur social semble en panne. En 2025, l’Insee note que 40 % des diplômés bac+5 occupent un poste inférieur à leur qualification deux ans après l’obtention du diplôme. Ce phénomène de déclassement touche surtout les titulaires de masters généralistes. Les ingénieurs et diplômés de grandes écoles sont moins concernés.
Même l’entrée sur le marché du travail se fait souvent en CDD, stage ou intérim. Selon l’APEC (baromètre 2024), un jeune cadre sur deux débute en contrat précaire. Le salaire reste également faible pour certains. Un quart des diplômés bac+5 gagnent moins de 1 800 € net par mois, à peine au-dessus du SMIC (APEC, 2024).
À l’étranger, le contraste est net. En Allemagne, les diplômés de la voie professionnelle ou de l’alternance sont très bien insérés. Le taux d’insertion dépasse 90 % à un an (OCDE, 2024). En Espagne et en Italie, le diplôme ne protège pas non plus. Le chômage des jeunes diplômés atteint plus de 20 % en 2025 (Eurostat, juin 2025).
Le phénomène de surqualification gagne du terrain. Certains diplômes ne correspondent plus aux besoins du marché. Cela entraîne une frustration croissante chez les jeunes. Marie Duru-Bellat évoque une « crise de légitimité du diplôme » : il ne garantit plus l’emploi, mais reste indispensable pour ne pas être exclu. L’inflation des diplômes nourrit une spirale : toujours plus d’études pour des postes identiques. Cette pression alimente un sentiment de déclassement générationnel.
Vers une redéfinition de la réussite ?
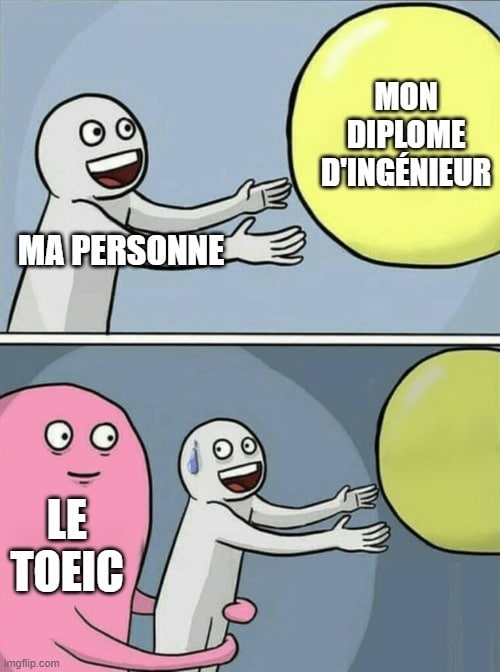
L’émergence d’autres formes de reconnaissance
Face à l’usure du diplôme comme seul critère, d’autres formes de validation émergent dans le monde professionnel. La validation des acquis de l’expérience (VAE) permet à des actifs de valoriser leurs compétences. En France, 70 000 VAE ont été délivrées en 2024 (ministère du Travail). Le développement des badges numériques, MOOC ou certifications privées change la donne. Ces outils valorisent des compétences ciblées, actualisées et souvent autodidactes.
Notre société traverse une crise des repères. La réussite ne se mesure plus uniquement au statut ou au salaire. Les jeunes générations redéfinissent leurs priorités. Selon l’enquête Génération Z & Travail (Ipsos, 2024), plus de 70 % des jeunes placent le sens du travail avant la rémunération. Pour beaucoup, réussir signifie trouver un équilibre : entre vie personnelle, impact social et développement personnel. Amartya Sen, prix Nobel d’économie, propose une autre lecture dans Development as Freedom (1999). Il définit le développement comme capacité à choisir sa vie — pas comme accumulation de ressources ou titres.
En France, le revenu n’augmente plus significativement avec le diplôme à partir d’un certain seuil (INSEE, 2025). Cette stagnation alimente un sentiment de désillusion. De plus, la crise écologique et sociale oblige à repenser nos modèles. Le sociologue Bruno Latour appelle à sortir du modèle méritocratique linéaire, hérité des Trente Glorieuses. À l’international, les pays nordiques valorisent la coopération, la qualité de vie et l’apprentissage continu plus que les titres scolaires. Enfin, les récits de réussite changent : on valorise l’engagement, la résilience, le parcours plutôt que le diplôme final.
Ce qu’il fait retenir
Le diplôme reste un signal important, mais il ne garantit plus la réussite. Les inégalités persistent et l’emploi adapté n’est pas assuré. Aujourd’hui, l’expérience et les compétences prennent de plus en plus de poids. Réussir, c’est désormais emprunter des chemins variés. Le diplôme ouvre des portes, mais ne ferme plus toutes les autres.