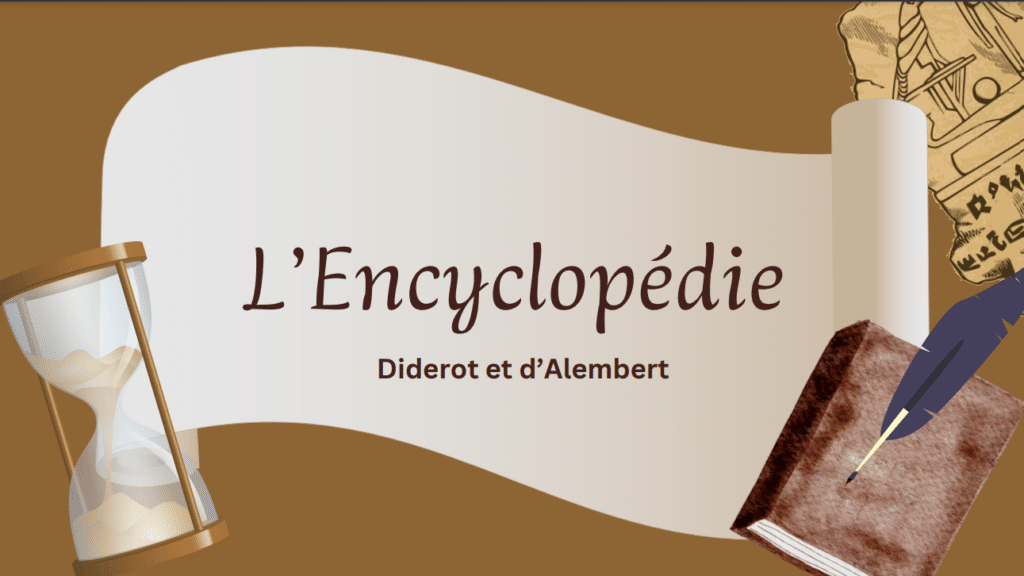S’il est des thèmes incontournables dans le cadre des cours de français et de philosophie au lycée, c’est bien celui des Lumières, qu’il convient absolument de maîtriser. Tu trouveras donc dans cet article l’ensemble des informations relatives à l’un des ouvrages emblématiques de ce courant : l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert.
Introduction
Au cœur du XVIIIᵉ siècle, une œuvre titanesque incarne le souffle nouveau des Lumières : l’Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, dirigée par Denis Diderot et Jean Le Rond d’Alembert. Publiée entre 1751 et 1772, cette somme de savoirs rassemble les connaissances de son temps, avec une volonté claire : rendre le savoir accessible, en finir avec l’obscurantisme, et inviter chaque lecteur à penser par lui-même. Ce projet, aussi ambitieux qu’audacieux, a profondément bouleversé l’ordre établi, défié l’Église et l’autorité monarchique, et jeté les bases de la modernité intellectuelle.
Genèse d’un projet révolutionnaire
L’Encyclopédie s’inscrit dans un contexte intellectuel et politique particulier. Depuis le début du XVIIIᵉ siècle, l’Europe est traversée par un courant de pensée qui place la raison, l’expérience et l’esprit critique au cœur de toute réflexion : les Lumières.
À l’origine, il s’agissait simplement de traduire la Cyclopaedia de l’Anglais Ephraim Chambers, un dictionnaire encyclopédique publié en 1728. Mais rapidement, le projet prend une tout autre tournure sous l’impulsion de Diderot et d’Alembert. Ils décident non seulement d’adapter, mais surtout de transformer l’ouvrage en une entreprise intellectuelle de grande envergure : une œuvre critique, militante, scientifique, technique et philosophique.
L’ambition affichée est claire : réunir l’ensemble des connaissances humaines disponibles, les classer rationnellement, les illustrer, et les rendre accessibles à tous ceux qui veulent comprendre le monde sans passer par les autorités religieuses ou monarchiques. À une époque où l’éducation reste le privilège des élites, c’est une véritable révolution.
Une structure colossale et novatrice
L’Encyclopédie, dans sa version complète, comprend 28 volumes publiés entre 1751 et 1772 : 17 volumes de texte et 11 volumes de planches. Elle contient environ 72 000 articles et environ 2 500 illustrations. Sa diffusion est sans précédent pour un ouvrage de cette ampleur : plus de 4 000 souscripteurs dès les premières années, ce qui constitue un chiffre considérable pour l’époque.
L’un des aspects les plus remarquables de l’Encyclopédie est son organisation des savoirs. Diderot et d’Alembert proposent une classification des connaissances inspirée de Francis Bacon, distinguant la mémoire (histoire), la raison (philosophie), et l’imagination (arts). Cette carte du savoir est publiée au début de l’ouvrage et montre une vision hiérarchisée et rationnelle du monde, où la théologie n’est plus au sommet comme dans les encyclopédies médiévales.
Par ailleurs, la richesse de l’iconographie dans les volumes de planches permet de comprendre visuellement des métiers, des outils, des procédés techniques – du travail du forgeron à la fabrication du papier. Ce souci du savoir pratique, au même niveau que les sciences théoriques, marque une rupture avec les hiérarchies traditionnelles.
Les grandes figures de l’Encyclopédie
Le projet ne repose pas uniquement sur Diderot et d’Alembert. Plus de 150 collaborateurs, appelés encyclopédistes, participent à la rédaction des articles. Certains d’entre eux sont parmi les plus grands penseurs de leur temps :
- Denis Diderot (1713-1784) : Philosophe, écrivain, critique d’art et figure centrale du projet, il supervise l’ensemble de l’entreprise, écrit plusieurs centaines d’articles (notamment sur la littérature, la philosophie, la religion ou les métiers), et assure la cohérence intellectuelle de l’ouvrage. Il défend une pensée matérialiste et anticléricale.
- Jean Le Rond d’Alembert (1717-1783) : Mathématicien et physicien, il rédige le célèbre Discours préliminaire, où il expose les objectifs de l’Encyclopédie et sa classification des savoirs. Il se retire du projet en 1759, épuisé par les critiques et pressions.
- Louis de Jaucourt (1704-1779) : Savant modeste, mais extrêmement productif, il rédige à lui seul près de 18 000 articles (soit environ un quart de l’ensemble) dans des domaines variés : médecine, sciences, économie, etc. Il finance son propre secrétariat pour mener à bien cette tâche titanesque.
- Voltaire : Bien qu’il ne soit pas un contributeur régulier, il rédige plusieurs articles, notamment sur la littérature, la religion et la politique. Sa plume ironique et son esprit critique nourrissent l’élan des Lumières.
- Jean-Jacques Rousseau : Il participe à l’Encyclopédie dans les premières années, en rédigeant des articles sur la musique, l’éducation et la politique (notamment Économie politique), avant de se brouiller avec Diderot.
Cette diversité de profils, allant du savant au philosophe en passant par des artisans et techniciens, confère à l’Encyclopédie une richesse unique et une représentativité large du savoir du XVIIIᵉ siècle.
Un manifeste des Lumières
L’Encyclopédie n’est pas seulement un recueil neutre de connaissances : elle est un véritable manifeste intellectuel et politique.
Elle incarne l’idéal des Lumières : libérer les esprits par le savoir, lutter contre l’ignorance, la superstition et l’arbitraire. Elle conteste l’autorité de l’Église, critique la monarchie absolue et défend la liberté d’expression, la tolérance religieuse, l’éducation pour tous, la justice, et la réforme sociale.
Dans de nombreux articles, les auteurs dénoncent les abus de pouvoir, l’ignorance entretenue par les institutions, et les préjugés sociaux. Diderot écrit : « Le but d’une encyclopédie est de changer la façon dont les hommes pensent ».
L’Encyclopédie est ainsi un outil de transformation sociale : elle cherche à instruire non seulement les savants, mais aussi les artisans, les commerçants, les cultivateurs, afin que chacun puisse exercer sa raison et améliorer sa condition.
Réception, interdictions et controverses
Dès les premières publications, l’Encyclopédie est vivement critiquée par les milieux conservateurs. En 1752, le Conseil du Roi suspend temporairement sa publication. En 1759, elle est condamnée par le Parlement de Paris et mise à l’Index par le Vatican.
Les autorités politiques et religieuses y voient une entreprise subversive, porteuse d’idées dangereuses. Les critiques ciblent notamment les articles remettant en cause la religion, la monarchie de droit divin, ou défendant la liberté de pensée.
Pourtant, malgré ces censures, les éditeurs trouvent des moyens de contourner les interdictions. Les volumes continuent à paraître de façon clandestine ou sous fausse adresse. Ce contournement de la censure témoigne du soutien que l’Encyclopédie reçoit dans certains cercles éclairés, notamment dans la bourgeoisie cultivée.
Portée et postérité
L’Encyclopédie a eu un impact majeur sur la société française et européenne. Dans cette perspective, elle a contribué à diffuser les idées des Lumières dans toute l’Europe et a préparé les esprits aux bouleversements politiques et sociaux à venir, notamment la Révolution française.
Son influence se retrouve dans les déclarations des droits de l’homme, dans la remise en cause de l’Ancien Régime, et dans le développement des systèmes éducatifs modernes. L’idée que le savoir doit être universel, accessible à tous, est aujourd’hui une évidence, mais elle était révolutionnaire à l’époque.
Par ailleurs, l’Encyclopédie a inspiré de nombreux projets postérieurs, comme la Britannica ou le Grand Dictionnaire universel du XIXe siècle de Pierre Larousse.
Aujourd’hui encore, elle fascine historiens, philosophes et chercheurs. Elle est considérée comme un monument de la pensée occidentale, un modèle d’intelligence collective et un symbole de liberté intellectuelle.
L’Encyclopédie à l’ère numérique
Depuis les années 2000, plusieurs initiatives ont vu le jour pour rendre l’Encyclopédie accessible en ligne. Parmi les plus notables, on peut citer le projet ENCCRE (Édition Numérique Collaborative et Critique de l’Encyclopédie), qui propose une version interactive, commentée et libre d’accès de l’édition originale.
Grâce au travail de centaines de chercheurs, cette version numérique permet aujourd’hui d’explorer l’Encyclopédie dans sa richesse, de naviguer par thèmes, auteurs ou illustrations, et de mieux comprendre la portée de chaque article.
Pour finir, cette réédition confirme l’actualité de l’Encyclopédie : à l’heure où les fake news circulent abondamment et où l’éducation reste un enjeu mondial, l’idéal encyclopédique de diffusion du savoir reste plus que jamais pertinent.
Ce que tu dois retenir sur l’Encyclopédie
En définitive, l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert est bien plus qu’un simple dictionnaire : c’est une œuvre militante, une machine de guerre intellectuelle, un manifeste pour la liberté de pensée et l’émancipation par la connaissance. À travers ses milliers d’articles, elle nous rappelle que le savoir est un outil de libération.
Héritière des Lumières, elle continue d’inspirer celles et ceux qui croient en une société fondée sur la raison, l’échange d’idées et l’éducation. Comprendre l’Encyclopédie, c’est comprendre un moment clé de notre histoire culturelle – un moment où l’on a osé croire que l’homme pouvait comprendre le monde par lui-même, sans maître ni dogme.