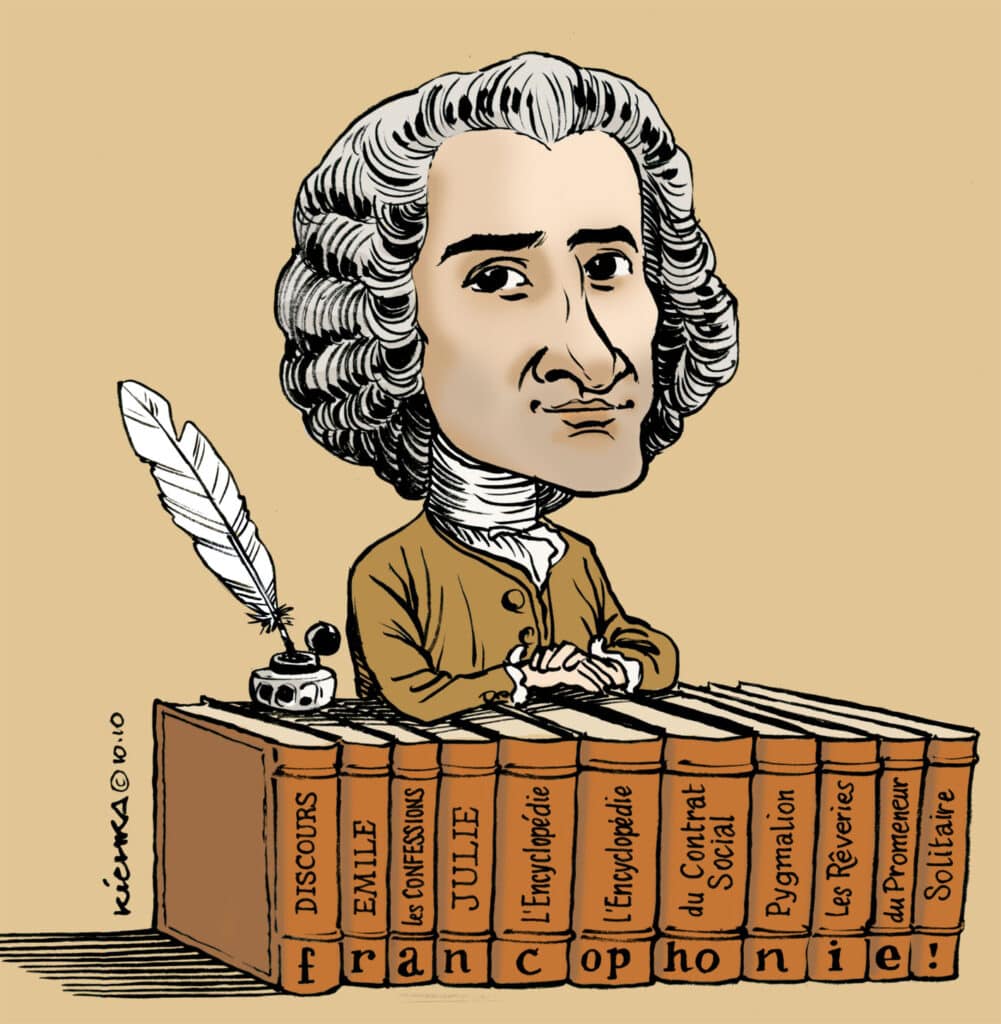Qu’est-ce qui pousse les hommes à vivre ensemble ? Est-ce la peur de l’anarchie ou l’aspiration à la liberté ? Depuis des siècles, la philosophie politique s’interroge sur la nature humaine et l’origine de nos sociétés. Hobbes, marqué par les guerres et la violence, imagine les humains comme des loups prêts à tout pour survivre, nécessitant un pouvoir fort. Face à lui, Rousseau défend l’idée d’un homme naturellement bon, que seule la société détourne de sa nature. Leurs visions opposées du contrat social continuent d’éclairer nos choix collectifs : faut-il sacrifier une part de liberté pour assurer l’ordre ? Ou croire en la capacité de chacun à participer à la vie commune ? Explorer ce duel de géants, c’est plonger au cœur des dilemmes contemporains, de la sécurité à la démocratie, de la surveillance à l’égalité.
Hobbes : une vision pessimiste de la nature humaine
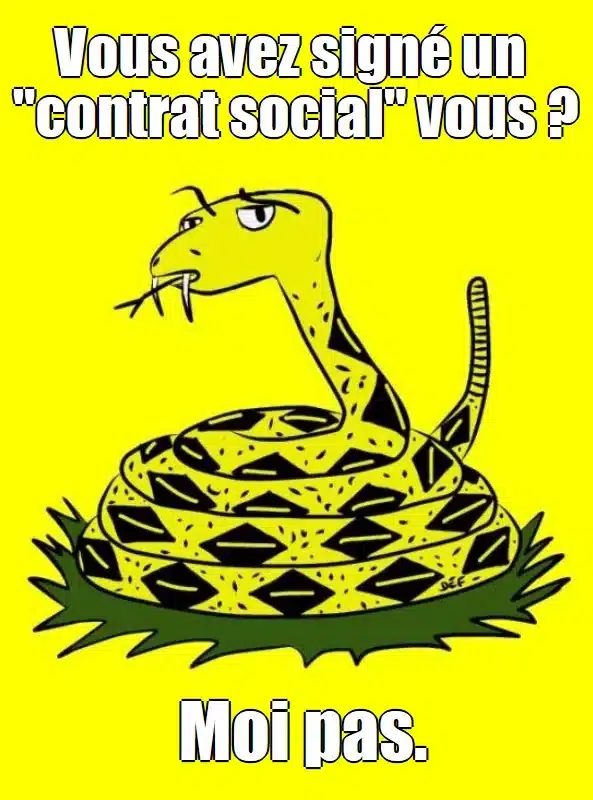
A. L’état de nature selon Hobbes
Dans le Leviathan (1651), Hobbes définit l’état de nature comme la condition originelle de l’humanité, avant toute organisation sociale ou politique. Dans cet état, chaque individu possède un droit illimité sur tout, car aucune autorité n’existe pour restreindre ses actions. L’homme vit alors sans lois ni juges, livré à ses propres passions. Selon Hobbes, « l’homme est un loup pour l’homme » (homo homini lupus), car il cherche avant tout à satisfaire ses désirs fondamentaux : la survie, la sécurité et le pouvoir.
Poussé par la peur de la mort violente et le désir de conserver sa vie, l’homme agit principalement par crainte et méfiance. Hobbes illustre cette dynamique en précisant que dans cet état, « la vie de l’homme [est] solitaire, pauvre, méchante, brutale et courte ». Cet exemple montre pourquoi l’état de nature ne peut procurer ni sécurité ni bien-être durable.
B. Les conséquences : guerre de tous contre tous
L’absence de règles communes dans l’état de nature entraine une atmosphère de méfiance généralisée. Hobbes parle explicitement d’une « guerre de tous contre tous » (bellum omnium contra omnes), où chacun devient potentiellement l’ennemi de l’autre. Cette rivalité permanente conduit à la violence, car chaque individu doit employer la force ou la ruse pour se défendre.
Aucune confiance durable n’est possible, puisque l’incertitude règne quant aux intentions d’autrui. Par conséquent, la sécurité se révèle un rêve inaccessible : tout un chacun vit dans la crainte continuelle d’être attaqué, spolié ou tué par son prochain. L’expression « l’homme est un loup pour l’homme » résume parfaitement cette vision pessimiste, centrée sur la lutte pour la survie au détriment de la coopération.
C. Le contrat social hobbesien
Face à l’insécurité chronique de l’état de nature, Hobbes avance la nécessité d’un contrat social pour restaurer la paix. Les individus acceptent collectivement de renoncer à leur droit naturel sur toutes choses en transférant leur pouvoir à un Souverain, qu’il soit une personne ou une assemblée, détenteur d’une autorité absolue. Dans le Leviathan, ce pacte fonde la légitimité de l’État moderne : le Souverain impose des lois communes, protège contre l’anarchie et garantit la sécurité.
Cependant, ce modèle soulève des critiques. D’une part, l’autorité du Souverain, parce qu’elle est absolue, restreint sévèrement les libertés individuelles. D’autre part, certains philosophes comme Rousseau reprochent à Hobbes de fonder la société sur la peur, plutôt que sur la recherche d’un bien commun ou de l’égalité. Malgré ces limites, la proposition hobbesienne marque une rupture essentielle dans l’histoire de la pensée politique, en plaçant la sécurité et l’ordre au cœur de l’organisation sociale.
Rousseau : une conception optimiste de la nature humaine
A. L’état de nature selon Rousseau
Dans le Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes (1755), Rousseau imagine l’état de nature comme une époque antérieure à toute société organisée. Selon lui, l’homme naturel est fondamentalement bon. Il vit paisiblement, guidé par l’instinct de conservation et un sentiment spontané de pitié envers ses semblables. Cette pitié prévient la cruauté et fait naître la bienveillance, même en l’absence de lois. Rousseau insiste sur la liberté de l’homme à l’état de nature : chacun agit suivant ses besoins, sans dépendre d’autrui.
Contrairement à Hobbes, il ne voit pas cet état comme une guerre perpétuelle ; il souligne l’indépendance et l’innocence de l’homme primitif, affirmant que « l’homme naît bon, c’est la société qui le corrompt » (Émile ou De l’éducation). La différence majeure réside donc dans leur conception de la nature humaine : là où Hobbes voit la peur et la rivalité, Rousseau discerne la bonté et la compassion.
B. L’origine de la société et de l’inégalité
Pour Rousseau, l’évolution vers la société s’explique par le développement progressif de la propriété privée. Dans le Discours sur l’inégalité, il écrit : « Le premier qui, ayant enclos un terrain, s’avisa de dire « Ceci est à moi », et trouva des gens assez simples pour le croire, celui-là fut le vrai fondateur de la société civile. » Cette appropriation marque la naissance de nouveaux besoins, qui conduisent à la rivalité, à l’envie, puis à la corruption morale.
Les passions et la compétition pour la richesse bouleversent l’équilibre originel, engendrant inégalités et conflits. Rousseau explique que cette transition de l’état de nature à l’état social entraîne la perte de la liberté primitive et génère une dépendance croissante entre les individus. Ainsi, la société crée des rapports de force qui dénaturent l’homme naturel et engendrent l’injustice.
C. Le contrat social rousseauiste
Face à cette dérive, Rousseau propose dans Du contrat social (1762) une solution fondée sur la souveraineté du peuple : le contrat social. Il s’agit d’un pacte par lequel chaque citoyen s’unit à tous, sans aliéner sa liberté, pour former un corps politique guidé par la « volonté générale ». Cette volonté n’est pas la somme des intérêts particuliers, mais l’expression du bien commun.
Pour Rousseau, un contrat social authentique repose sur la liberté et l’égalité de tous devant la loi. Il accorde à chacun le statut de citoyen, participant activement à la vie politique. Les conditions de la véritable légitimité politique résident donc dans la capacité collective à instaurer et à respecter la volonté générale, garantissant la liberté et l’égalité structurelles entre les membres de la société. Par cette conception, Rousseau révolutionne l’idée même de la citoyenneté et du vivre-ensemble, invitant à repenser la démocratie et la justice sociale.
Héritage de Hobbes et Rousseau : éclairages pour notre temps
A. L’empreinte durable de Hobbes
Au XXIe siècle, la pensée de Hobbes ressurgit clairement à travers la gestion des crises majeures, comme la pandémie de Covid-19 ou la montée des menaces terroristes. On observe, dans de nombreux pays, l’acceptation croissante de l’extension des pouvoirs étatiques et des mesures exceptionnelles qui restreignent temporairement les libertés pour garantir l’ordre public. Ce réflexe rappelle l’idée hobbesienne du Léviathan : face au chaos, la société accepte la centralisation du pouvoir pour éviter le retour à l’anarchie.
La surveillance numérique généralisée, la multiplication des lois sécuritaires, ou même la tentation autoritaire dans certaines démocraties traduisent l’impact concret de l’héritage hobbesien. Plus encore, face aux défis inédits posés par l’intelligence artificielle ou le big data, la réflexion sur la centralisation et le contrôle du pouvoir prend une actualité brûlante : qui doit fixer les cadres ? Qui protège la collectivité contre les excès de la technologie et du désordre social ?
B. L’influence persistante de Rousseau
Rousseau demeure un phare pour celles et ceux qui contestent les injustices et aspirent à plus de démocratie directe. Les mouvements citoyens récents, qu’ils réclament le référendum, l’inclusion, ou l’égalité réelle (comme les Gilets jaunes ou les revendications de justice fiscale), s’inscrivent dans la tradition de la volonté générale et de l’engagement populaire.
L’idéal de Rousseau, selon lequel chaque citoyen doit participer à la définition de la loi commune, irrigue les débats sur la transparence des institutions et la valorisation des consultations citoyennes. En outre, ses analyses sur la dérive de la propriété privée continuent d’alimenter la critique sociale à l’heure du néolibéralisme et de la concentration des richesses. Enfin, la réflexion rousseauiste sur l’éducation et la préservation de la liberté individuelle face à la pression sociale inspire toujours les pédagogies alternatives et les réflexions sur l’émancipation.
C. Réflexion pour notre époque
La confrontation des idées de Hobbes et Rousseau se révèle particulièrement féconde devant les défis contemporains : montée des populismes, crise de la représentation démocratique, ou développement des technologies de contrôle. D’un côté, la tentation d’un pouvoir fort et centralisé accompagne chaque phase d’instabilité ou de peur dans les sociétés occidentales. De l’autre, la revendication d’une justice sociale authentique pousse à défendre plus d’égalité, de participation et de vigilance face à la toute-puissance de l’État ou du marché.
Les débats sur la gouvernance de l’intelligence artificielle, le transhumanisme, la protection de la vie privée ou la lutte contre les inégalités témoignent de la vitalité de ces deux héritages. S’inspirer à la fois de la lucidité de Hobbes et de l’idéalisme de Rousseau permet alors de chercher un équilibre renouvelé entre sécurité et liberté, stabilité et justice, autorité et engagement citoyen.