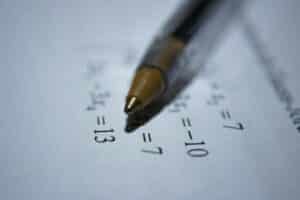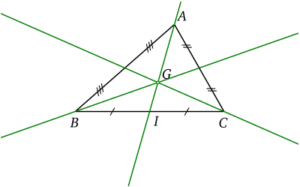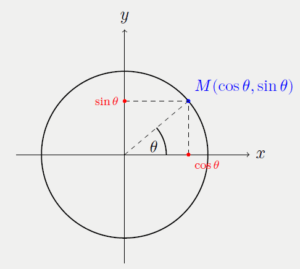S’il fallait choisir une famille de nombres aussi fascinante que fondamentale, celle des nombres premiers arriverait en tête. Présents dès les premiers chapitres des manuels de collège, ils deviennent des objets d’étude plus poussés au lycée et même bien au-delà. Qu’est-ce qu’un nombre premier ? Pourquoi passionnent-ils autant les mathématiciens depuis l’Antiquité ? Et surtout, à quoi peuvent-ils bien servir aujourd’hui, à l’ère des ordinateurs et des réseaux ? Je te propose ici de découvrir (ou redécouvrir !) les nombres premiers, leur définition, leurs propriétés et leurs nombreuses applications.
Qu’est-ce qu’un nombre premier en mathématiques ?
Un nombre premier est un entier naturel supérieur ou égal à 2 qui n’admet que deux diviseurs positifs distincts : 1 et lui-même.
Ainsi, 2, 3, 5, 7, 11 ou encore 13 sont premiers, mais 4, 6, 8 ou 9 ne le sont pas, car ils possèdent d’autres diviseurs que 1 et eux-mêmes.
On peut formaliser cela en disant :
\( p \text{ est premier} \Longleftrightarrow \forall, d \in \mathbb{N},\ d \mid p \Rightarrow (d = 1 \text{ ou } d = p) \)
Le premier nombre premier est 2. C’est le seul nombre premier pair, car tout nombre pair supérieur est divisible par 2, donc possède au moins trois diviseurs. Tous les autres nombres premiers sont donc impairs.
Un peu d’histoire : des Grecs aux ordinateurs
Les nombres premiers ne datent pas d’hier. Dès l’Antiquité, Euclide (vers 300 av. J.-C.) prouve que leur quantité est infinie, une démonstration encore enseignée aujourd’hui tant elle est élégante :
Supposons qu’il existe un nombre fini de nombres premiers, notés \( p_1, p_2, \dots, p_n \).
Construisons le nombre suivant :
\( N = p_1 \times p_2 \times \dots \times p_n + 1 \)
Ce nombre \( N \) n’est divisible par aucun des \( p_i \), car il laisse un reste de 1 dans chaque division. Soit \( N \) est premier, soit il possède un diviseur premier différent de tous les \( p_i \). Dans tous les cas, cela contredit notre hypothèse initiale. Il y a donc une infinité de nombres premiers.
Propriétés fondamentales des nombres premiers
Les nombres premiers sont les briques élémentaires de tous les entiers naturels. Cette idée est formalisée par le théorème fondamental de l’arithmétique :
Tout entier naturel supérieur ou égal à 2 peut s’écrire de manière unique (à l’ordre près) comme un produit de nombres premiers.
Par exemple :
\( 180 = 2^2 \times 3^2 \times 5 \)
Cette décomposition est unique et essentielle en mathématiques. On l’utilise notamment pour :
- Calculer des PGCD ou PPCM,
- Factoriser des entiers,
- Résoudre des équations diophantiennes (équations polynomiales à coefficients entiers dans laquelle on cherche des solutions entières).
Il n’existe aucune formule simple permettant de générer tous les nombres premiers ! C’est ce qui rend leur recherche et leur étude aussi délicates qu’intéressantes.
Comment trouver des nombres premiers ?
On pourrait imaginer qu’il est facile de vérifier si un nombre est premier. Pourtant, cela devient vite complexe pour les très grands nombres.
L’une des premières méthodes connues pour repérer les nombres premiers est le crible d’Ératosthène, du nom du mathématicien grec du IIIe siècle av. J.-C.
L’idée est simple :
1. Écrire tous les entiers de 2 à un certain nombre \( N \),
2. Barrer tous les multiples de 2 (sauf 2),
3. Passer au plus petit nombre non barré (3), et barrer tous ses multiples,
4. Répéter l’opération avec les suivants.
Des conjectures encore ouvertes
Malgré leur ancienneté, les nombres premiers n’ont pas révélé tous leurs secrets. Plusieurs conjectures célèbres restent encore non résolues :
- La conjecture de Goldbach : tout nombre pair strictement supérieur à 2 peut-il s’écrire comme la somme de deux nombres premiers ?
- La conjecture des nombres premiers jumeaux : existe-t-il une infinité de paires de nombres premiers distants de 2, comme (11, 13), (17, 19), (29, 31) ?
Les nombres premiers à l’ère numérique
Si les nombres premiers passionnent autant, c’est aussi parce qu’ils sont devenus incontournables en informatique et en cybersécurité.
De nombreux systèmes de cryptographie (comme le RSA) reposent sur le fait qu’il est facile de multiplier deux grands nombres premiers, mais très difficile de retrouver ces deux facteurs à partir de leur produit.
Par exemple, on peut construire une clé publique à partir d’un produit \( n = p \times q \), avec \( p \) et \( q \) deux grands nombres premiers. Décomposer \( n \) en ses facteurs premiers est quasiment impossible sans ordinateurs très puissants, assurant la confidentialité des échanges.