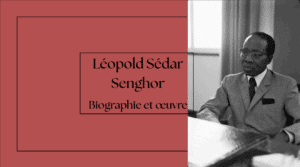Face aux inégalités sociales, l’école se trouve dans une position ambiguë. D’un côté, cette institution nationale aspire à réduire les disparités sociales : l’une des fonctions principales de l’école dite « républicaine » consiste à instruire tous les citoyens sans aucune distinction. D’un autre côté, l’école semble jouer un rôle dans la production et reproduction des inégalités sociales. Le sujet alimente les débats politiques et les travaux de recherche depuis de nombreuses années. Pour bien comprendre l’enjeu des inégalités sociales et scolaires, voici dans cet article un ensemble d’expressions et de concepts sociologiques incontournables pour mieux appréhender le sujet et ses enjeux.
Auto-censure ou autosélection
Phénomène par lequel un ou une jeune réalise des vœux d’orientation moins ambitieux que ce à quoi son niveau scolaire lui permet, en théorie, d’accéder. Ainsi, l’élève obtiendrait in fine un diplôme « moins rentable » compte tenu des capacités qu’il détient. Il faut bien avoir en tête que le système scolaire encourage généralement les élèves à viser le plus haut possible et à raisonner en termes de choix relativement ambitieux.
Les travaux de recherche soulignent que ce phénomène touche davantage les jeunes issus de milieux modestes et/ou les filles, à niveau scolaire égal. Autrement dit, même s’ils ont les mêmes notes, les jeunes issus d’un milieu populaire ont des aspirations scolaires plus modestes que ceux issus d’un milieu favorisé. Cela s’explique par un accès plus limité aux informations (en particulier pour certaines filières ou parcours d’études supérieures très peu connus dans certains milieux) et une moindre estime de soi scolaire (croyance en ses capacités).
Cette autocensure peut toutefois être limitée par l’action d’enseignants ou de parents qui cherchent à tirer l’enfant vers le haut.
Capital culturel
On doit cette notion au sociologue Pierre Bourdieu (1930-2002). Il s’agit de l’ensemble des ressources culturelles (connaissances, compétences, maîtrise de la langue, etc.) qu’un individu détient et qui sont mobilisables dans différents contextes. On distingue le capital culturel :
- « incorporé » (le fruit du processus de socialisation),
- « objectivé » (possession ou accès à des biens culturels comme les livres, les films, etc.)
- et « institutionnalisé » (compétences attestées par des études et des diplômes).
Les individus possèdent un capital culturel différent (en quantité et en qualité) selon leur milieu social, ce qui va avoir une incidence sur leur parcours scolaire. Il existe en effet un lien clair entre capital culturel et réussite scolaire. Les enfants issus des groupes sociaux les plus favorisés sont avantagés à l’école dans le sens où leur socialisation familiale leur permet davantage de maîtriser les codes et les comportements en vigueur à l’école. À l’inverse, les enfants issus des milieux plus modestes sont mis en difficulté, car l’écart culturel est important entre ce qu’ils vivent à la maison et dans l’institution scolaire.
Carrière scolaire
Cette expression désigne l’ensemble des étapes du parcours scolaire d’un individu, au cours duquel l’élève et sa famille sont amenés à faire des choix, à se positionner, à bifurquer. On peut citer, par exemple le choix d’options, le choix d’orientation, le choix d’un établissement, etc. Au fur et à mesure de la carrière, l’élève passe d’une position à une autre (écolier, collégien, lycéen).
La notion de carrière fait référence à un processus long, qui démarre au début de la scolarité et s’achève à l’entrée dans la vie professionnelle. On peut aussi y ajouter une dimension socio-psychologique : la carrière scolaire désigne également la construction d’un rapport à l’école et la volonté de s’y investir ou pas.
La carrière scolaire est ainsi propre à chacun : il y a autant de carrières scolaires qu’il y a d’individus ! Toutefois, l’origine sociale, le genre ou encore les origines géographiques semblent être des données essentielles pour comprendre la manière dont la carrière scolaire peut être menée et vécue.
Lire aussi : Un bilan de la réforme du lycée en 10 points clés
Carte scolaire
Cette expression apparaît pour la première fois en 1963, quand l’État français met en place une politique de « sectorisation ». L’idée est la suivante : les élèves des collèges et des lycées publics sont dès lors affectés à des établissements scolaires d’une zone géographique donnée. Ils sont rattachés à cette dernière du fait de leur lieu d’habitation. Cette mesure est généralisée en 1987.
À l’origine, l’idée n’était pas de favoriser la mixité sociale, mais de gérer au mieux la répartition des élèves français en fonction des établissements et des moyens d’enseignements. Dans certains cas (obligation professionnelle des parents, santé, déménagement) il est possible de contourner la carte scolaire en faisant une demande à l’académie concernée. Notons que cette démarche administrative reste fastidieuse.
Cet outil d’affectation ne fait pas consensus et de nombreux chercheurs pointent du doigt le risque de « ghettoïsation » (« bons » établissements VS établissements « difficiles »). En effet, les territoires sont marqués par des inégalités sociales que la carte scolaire ne ferait que reproduire, voire augmenter. L’idéal de mixité sociale, du fait des inégalités sociales déjà présentes sur le territoire, semble difficile à atteindre avec ce système d’affectation.
Chaîne des inégalités
Par « chaîne des inégalités » on désigne la manière dont les inégalités scolaires et sociales sont cumulatives, s’alimentent les unes les autres. Pour le dire autrement, les inégalités forment un système, un ensemble complexe qui démarre très tôt et se poursuit longtemps tout le long de la vie scolaire, universitaire et professionnelle.
Au début de la chaîne des inégalités, on trouve les inégalités sociales. L’école rassemble des individus issus de milieux sociaux différents et inégalement dotés en ressources économiques, culturelles et sociales. L’école du quartier A de la ville X n’a pas forcément les mêmes ressources et pratiques que l’école du quartier B de la ville Z : il y a donc des inégalités de traitement. Ces dernières produisent des inégalités de résultats. Ainsi, les écarts se creusent entre les élèves les plus favorisés et ceux qui le sont moins. Ces inégalités de résultats donnent lieu à des inégalités d’orientation, qui débouchent sur des inégalités de diplomation. Qui dit diplôme, dit emploi : les inégalités de diplomation se traduisent par des inégalités d’insertion sur le marché du travail.
Déclassement social
Le déclassement social désigne un processus qui amène une personne à un statut social inférieur. Il peut s’agir d’un déclassement :
- Intergénérationnel (un enfant occupe une position sociale inférieure à celle de ses parents, souvent le père, au même âge ; c’est donc une mobilité sociale descendante)
- Intragénérationnel (une personne occupe une position sociale inférieure à la fin de sa vie active, comparativement à sa situation initiale)
La notion du déclassement social est indissociable de celle de mobilité sociale, que l’école est normalement censée favoriser (le fameux « ascenseur social »). En effet, l’un des objectifs de l’école est de développer des compétences, des savoirs et savoir-faire qui peuvent fournir in fine un accès à l’emploi. Depuis les années 1980, les études convergent et soulignent que les générations sont de plus en plus déclassées (par rapport à leurs parents, mais aussi dans leur carrière individuelle). Ce constat pose la question de l’efficacité du rôle de l’école dans la mobilité sociale.
Déclassement scolaire
Cette forme de déclassement fait référence aux jeunes diplômés contraints d’occuper des emplois inférieurs à ceux auxquels ils auraient pu avoir accès avec leurs diplômes et titres scolaires. Cette jeunesse « déclassée » doit alors orienter ses recherches en revoyant ses exigences professionnelles à la baisse.
Cette situation peut s’expliquer par un double phénomène. D’un côté, la durée de la scolarité s’est fortement allongée depuis les années 1980 : les jeunes générations sont de plus en plus diplômées. Mais d’un autre côté, le nombre d’emplois qualifiés (notamment les postes de cadres) n’a pas augmenté aussi vite : l’offre de travailleurs diplômés est inférieure à la demande des entreprises.
Cette situation peut s’illustrer avec des taux de chômage de plus en plus élevés pour les jeunes actifs (20% pour l’ensemble des jeunes depuis les années 1980, plus de 50% pour les jeunes non diplômés en 2016 contre 30% en 1990). Ceux qui sont les plus diplômés (bac + 5) sont aussi les plus protégés du chômage, mais certains doivent occuper des postes demandant moins de qualification (bac +3). Une sorte de « file d’attente » se créé, au bout de laquelle se trouve les moins diplômés.
Démocratisation scolaire
La démocratisation scolaire désigne la volonté de rendre accessibles les différents parcours scolaires à n’importe quel individu, peu importe son milieu social. La démocratisation scolaire fait l’objet de différentes politiques éducatives, menées en France depuis les années 1960.
On distingue la démocratisation :
- « quantitative » : élargissement de l’accès aux différents parcours d’études pour un nombre de plus en plus important de jeunes.
- « qualitative » : affaiblissement du lien entre parcours scolaire et origines sociales d’un étudiant. La démocratisation qualitative vise à amoindrir le poids du déterminisme social sur les trajectoires scolaires.
Si la démocratisation quantitative fait plutôt consensus (près de 90 % d’une génération a atteint le niveau du bac en 2020, contre un jeune sur dix dans les années 1960), les résultats de la démocratisation qualitative sont encore fragiles. Les parcours restent encore très marqués par l’origine sociale (par exemple, les SEGPA sont composées à 70% d’enfants d’ouvriers, employés et chômeurs, contre 1.6% d’enfants de cadres ; 50% des élèves de CPGE sont des enfants de cadres, etc.). Le sociologue Pierre Merle parle ainsi de « démocratisation ségrégative » pour mettre en lumière l’illusion d’une réelle démocratisation scolaire.
Lire aussi : L’école accroît-elle les inégalités ?
Éducation prioritaire
Cette expression désigne un ensemble de politiques éducatives menées en France depuis le début des années 1980. La mise en place de ces mesures vise à compenser les inégalités sociales et scolaires croissantes et lutter contre le phénomène de ségrégation sociale.
Les fils conducteurs de ces politiques sont le principe d’égalité des chances et l’aide « par compensation ». On cherche à aider les publics les moins favorisés en leur donnant plus de moyens : davantage de ressources financières, plus de ressources humaines et d’enseignants, davantage de partenaires et des classes moins nombreuses. C’est une application concrète de ce qu’on appelle la « discrimination positive ».
Les ZEP (zones d’éducation prioritaire) sont devenues les REP (réseaux d’éducation prioritaire). Il existe aussi les REP+ (collèges et lycées qui rencontrent des difficultés sociales particulièrement fortes, comparativement aux autres établissements).
On peut observer à long terme un effet pervers au fait de « labeliser » un territoire « REP ». Les recherches soulignent plusieurs conséquences : une fuite des élèves les plus favorisés vers d’autres établissements, un manque d’attractivité pour les enseignants. L’idéal initial d’égalité de traitement n’est ainsi plus possible.
Effet classe
La théorie de l’effet classe cherche à expliquer les inégalités de performance scolaire par la composition sociale et les comportements propres à une classe. À l’origine, on doit ces réflexions à l’économiste américain Hanushek, qui cherchait à comprendre les différences de performances entre les classes d’une même école.
On parle d’un « effet classe » puisque chaque groupe constitue une composition unique d’individus. Ainsi le niveau des élèves et leur origine sociale, le caractère homogène ou hétérogène de ces derniers, le fait de regrouper des élèves qui suivent des options (latin, grec, LV3…) sont autant d’éléments propres à chaque classe et qui ne sont pas sans conséquence sur les apprentissages. Ceux-ci entretiennent une dynamique et des interactions singulières entre eux et avec les enseignants.
On risque alors de se retrouver avec une polarisation entre les « bonnes » classes (public socialement plus favorisé, homogénéité des élèves, niveau élevé, bonne dynamique de travail) et les classes plus « difficiles » (classes moins homogènes, niveau moins élevé, dynamique de travail moins évidente).
Effet enseignant/maître
Ce qu’on appelle « effet maître » ou « effet enseignant » fait référence à l’importance de la personne enseignante dans la réussite (ou l’échec) scolaire. Ainsi, l’expérience professionnelle, la personnalité, le charisme, la maîtrise des contenus, les choix pédagogiques, la relation avec les élèves sont autant d’éléments à prendre en considération lorsque l’on veut mesurer l’effet maître.
Plusieurs travaux de recherche ont souligné que les enseignants « moins efficaces » dans la réussite des élèves ont des attentes pédagogiques relativement faibles, favorisent peu l’interaction en classe et exposent leurs élèves à moins de contenus. Au contraire, les professeurs « plus efficaces » dans la réussite des élèves sont plus exigeants, proposent du contenu plus poussé et encouragent davantage les élèves. Notons aussi qu’il existe globalement un traitement différencié en fonction du genre des élèves. De nombreuses enquêtes montrent que les enseignants ont tendance à entretenir les stéréotypes de genre, notamment en sollicitant davantage les garçons en mathématiques. Sur le long terme, ces pratiques professorales, souvent inconscientes, peuvent en partie expliquer la moindre orientation des filles dans les secteurs scientifiques.
Effet établissement
On parle de « l’effet établissement » pour souligner le fait que l’établissement scolaire fréquenté joue sur la performance scolaire et l’orientation des élèves concernés. Autrement dit, tous les établissements scolaires ne se valent pas ! Les conditions d’apprentissage, la localisation de l’école, son environnement ne sont pas neutres sur la réussite des élèves. Les effets d’établissement peuvent se comprendre comme ce que « gagnent » ou « perdent » des élèves initialement identiques lorsqu’ils sont scolarisés dans tel ou tel contexte.
Les recherches en sciences sociales mettent en lumière différents éléments qui caractérisent un établissement « efficace ». Notons par exemple que les enseignants mettent l’accent sur les savoirs fondamentaux, ils donnent aux élèves des objectifs clairs et atteignables, les évaluations sont régulières, les cours sont bien structurés et les évaluations fréquentes, les familles sont impliquées et souvent consultées.
En France, « l’effet établissement » peut se mesurer par la différence entre les résultats obtenus aux examens (brevet ou baccalauréat) et les résultats attendus en fonction des caractéristiques sociales des élèves scolarisés (âge, retard scolaire, profession des parents).
Effet de préscolarisation
La préscolarisation renvoie à la période qui se situe avant la scolarisation obligatoire. En France, chaque enfant doit être scolarisé dès 3 ans (en 2019, l’âge de scolarisation obligatoire passe de 6 à 3 ans), mais il peut être accueilli dès 2 ans dans la limite des places disponibles. Là encore, l’offre scolaire n’est pas égale, certains établissements proposent un accueil précoce des enfants à la maternelle, mais ce n’est pas le cas de tous. Cette politique d’accueil des enfants de moins de 3 ans en école maternelle fait partie de la palette d’outils dont dispose l’État pour prévenir les difficultés scolaires et les inégalités de réussite liées aux origines sociales.
On parle d’effet de préscolarisation » puisque la scolarisation dès l’âge de 2 ans présente un réel effet sur la trajectoire scolaire des individus. Plusieurs travaux de recherche ont notamment souligné la manière dont les rythmes de progression ultérieures s’accélèrent pour les enfants préscolarisés.
Égalité des chances
L’égalité des chances est un principe politique visant à donner aux individus les mêmes chances et mêmes opportunités (scolaires, sociales, professionnelles) indépendamment de leur sexe, de leur origine sociale ou ethnique, des ressources de leurs parents, de leur lieu de naissance, de leur religion, d’un éventuel handicap, etc. À l’inverse, l’inégalité des chances suppose alors que l’origine sociale des individus détermine leur future “place” au sein de la société.
La notion d’égalité des chances est intimement liée à celle de mérite : si tous les individus sont partis d’une situation égalitaire, alors les positions sociales les plus prestigieuses devraient être atteintes par les individus les plus performants, méritants.
Au-delà de la transmission du savoir, de la création d’une culture commune et de la formation des citoyens, l’école a aussi pour mission de favoriser l’égalité des chances. Pour la majorité des spécialistes, cette maxime relève de l’hypocrisie puisque l’école peine largement à réduire les inégalités entre élèves socialement favorisés et peu favorisés ou entre filles et garçons. Autrement dit, l’école française a plutôt tendance à favoriser la reproduction des inégalités.
Élitisme scolaire
Cette conception de l’école française conçoit l’institution scolaire comme « machine » à former et sélectionner une élite. En effet, au fur et à mesure des décisions d’orientation (options, voie pro ou générale, filière, sections, matières, etc.), les inégalités de parcours se multiplient et les écarts se creusent entre les meilleurs élèves (souvent issus des milieux les plus aisés) et les autres.
Le terme « élite » rassemble une minorité d’individus destinés à occuper les postes de pouvoir et les positions stratégiques, dans les secteurs publics et privés. De ce point de vue, l’école ne remplit pas sa mission d’égalité des chances, mais reproduit massivement les inégalités sociales et tend à disqualifier et évincer du jeu scolaire et universitaire les moins performants.
Le système des Grandes Écoles françaises (commerce, ingénieurs, sciences politiques) illustre le mécanisme de reproduction des inégalités et de production d’une élite. Dès l’entrée en classe préparatoire, 7% des élèves ont des parents ouvriers. Après le concours, ils sont 5% dans les écoles d’ingénieurs, 4% à l’ENA et quasiment absents à Polytechnique. 65% des élèves de Grandes Écoles (tous secteurs confondus) sont d’origine très favorisée, contre seulement 8% d’origine défavorisée.
Lire aussi : Les maths : une matière propice aux inégalités
Emprise du diplôme
Selon les sociologues François Dubet et Marie Duru-Bellat, les diplômes constituent un vecteur très puissant de reproduction des positions sociales dans les pays développés. Toutefois, « l’emprise du diplôme » (à savoir le niveau d’importance accordé au diplôme et le rôle qu’il joue sur l’insertion professionnelle et le niveau de salaire) varie d’un pays à l’autre. Cette théorie prend place dans un contexte « d’inflation scolaire » (plus de diplômes et de diplômés).
Selon les chercheurs, plus les inégalités scolaires sont fortes, plus la reproduction sociale est marquée et plus l’emprise du diplôme est importante.
Les auteurs comparent plusieurs systèmes scolaires et forment des groupes de pays. En France, « l’emprise du diplôme » est très forte. Dans notre système scolaire, la sélection intervient très tôt et les inégalités se cumulent tout au long de la scolarité. Ce modèle de forte reproduction sociale via l’école concerne aussi les États-Unis et le Royaume-Uni. En Scandinavie et au Canada, le système est plus fluide, caractérisé par des inégalités plus faibles. Enfin en Italie ou en Espagne, la reproduction sociale est forte, mais elle ne s’explique pas par l’école.
Hiérarchie des filières
Dans le système éducatif français, il existe une hiérarchie historique et prégnante concernant les matières, les séries, les voies (professionnelle, générales, ou technologique). Dit autrement, tous les parcours ont une valeur différente, en fonction de leur position dans la hiérarchie scolaire.
Ce classement est une construction sociale autour de certaines normes (par exemple celle de la valorisation de la théorie et donc de la voie générale au détriment des connaissances pratiques et concrètes développées dans la voie professionnelle). Cette construction peut bouger et la « voie royale » peut évoluer avec le temps et les réformes. Toutefois, plusieurs rapports s’accordent pour dire que les représentations restent figées depuis une trentaine d’années.
Récemment, selon plusieurs chercheurs, la mise en place de la plateforme Parcoursup tend à renforcer la hiérarchie entre les filières du secondaire. En effet, l’accès à la fac est rendu plus difficile pour les bacheliers professionnels et technologiques. Par ailleurs, la suppression des séries au lycée dans le cadre de la réforme de Jean-Michel Blanquer n’a pas enterré la hiérarchie des matières. Ainsi, en 2021, 28% des lycéens de première générale ont choisi la triplette « mathématiques, physique-chimie, SVT » qui est une redite de la série S.
Inégalités de genre
Les inégalités de genre désignent les disparités qui existent entre les filles et les garçons. À l’école, elles se manifestent par des différences de traitements, de comportements, de résultats, d’orientation que l’on peut observer entre les filles et les garçons.
Ces situations inégales peuvent s’expliquer par une socialisation différenciée selon le genre. De nombreux travaux de recherche soulignent que, dès l’école maternelle les garçons sont davantage incités à la compétition, ce qui favorise l’ambition (pour la réussite et l’orientation). Par ailleurs, au niveau de l’enseignement secondaire, on souligne plus fréquemment les performances des garçons alors que chez les filles, on accentue davantage leur sérieux ou leur assiduité.
Concrètement, alors qu’elles ont des résultats scolaires globalement supérieurs à ceux de leurs camarades garçons, les filles s’orientent moins vers les filières scientifiques au lycée (et leur part est encore plus faible pour les études supérieures). Elles ont aussi, en majorité, des aspirations professionnelles moins ambitieuses que les garçons. Même si les choses sont amenées à changer (du fait de mesures pour informer, accompagner, orienter les élèves) les stéréotypes de genre sont encore largement intériorisés par les élèves.
Inégalités d’orientation
Il s’agit des différences dans les choix d’orientation scolaires et universitaires (options ; choix de la langue vivante ; filière générale, technologique ou professionnelle ; enseignement de spécialités ; formation post bac) qui existent entre différents individus.
Les différences de parcours s’expliquent d’abord par les résultats scolaires (certains choix d’orientation sont accessibles à condition d’avoir atteint certains résultats). En revanche, à niveau scolaire égal, il faut aussi prendre en compte le genre et le milieu social. Ces deux éléments sont déterminants dans les choix d’orientation puisqu’ils proposent des univers des possibles bien spécifiques. Par exemple, la probabilité d’accéder à une seconde générale ou technologique est deux fois moins importante pour un élève issu de milieu défavorisé que pour un élève issu de milieu favorisé.
Il faut aussi prendre en compte le poids de l’institution scolaire dans les inégalités d’orientation. L’école, à travers le personnel enseignant, mais aussi via les critères académiques de sélection, joue également un rôle de « placeur » et contribue souvent à la reproduction des inégalités.
Inégalités de résultats scolaires
Ces inégalités font référence aux différentes situations (réussite ou échec) que peuvent connaître les élèves dans leur parcours scolaire. On mesure ces inégalités à l’aide d’indicateurs objectifs (notes, obtention d’un diplôme comme le brevet ou le baccalauréat, étude des mentions lors de la validation d’un diplôme, etc.). Par exemple : 90% des enfants de cadres et enseignants obtiennent leur bac sans redoublement ni réorientation 7 ans après l’entrée en sixième. C’est le cas seulement pour 40% des fils et filles d’ouvriers. Les travaux de recherche aboutissent à la même conclusion : les enfants d’origine sociale favorisée ont des résultats scolaires plus élevés que leurs camarades moins aisés.
Lorsque l’on évoque les inégalités de résultats, on distingue en général deux types d’inégalités de résultats. D’une part, on trouve les inégalités « justifiables », celles associées au mérite (effort, talent). D’autre part, il existe des inégalités « injustifiables » provenant du système social inégal (milieu social et niveau d’étude des parents, genre, origine ethnique, lieu d’habitation, etc.). Peut-on pour autant isoler les inégalités de résultats provenant du mérite et celles issues de la société ?
Inégalités de traitement
Sous cette appellation, on retrouve l’ensemble des composantes du temps en classe et hors classe, et des ressources auxquelles a accès un élève, un groupe d’élèves ou un établissement.
Méthodes pédagogiques et attendus des professeurs ; temps d’enseignement réel ; nature, durée et fréquence des évaluations ; travail à la maison…voilà autant d’éléments pour lesquels l’école française se révèle inégale. Selon plusieurs rapports d’évaluation, globalement, les élèves des milieux les moins favorisés sont traités de telle sorte que les tâches demandées sont moins ambitieuses, les attendus sont fixés plus bas, l’environnement scolaire et pédagogique semble moins favorable à la réussite.
Ainsi, en zone d’éducation prioritaire, les élèves voient leur temps des apprentissages scolaire notablement revu à la baisse (problèmes de discipline, exclusions et absences des élèves, absentéisme des enseignants). Ils assistent, bien plus que les autres élèves, à des cours dispensés par des enseignants contractuels et/ou débutants.
Inégalités de diplomation
Ce terme renvoie aux situations inégales qui résultent de l’obtention d’un diplôme. En France, on s’intéresse aux taux d’obtention des diplômes (brevet des collèges, bac, BTS, licence, master, doctorat).
Si l’on prend l’exemple du baccalauréat, et pour l’exprimer de manière plus triviale : « tous les bacs ne se valent pas ». En 1985, Jean-Pierre Chevènement, alors ministre de l’Éducation Nationale, lance l’objectif de mener 80% d’une classe d’âge au baccalauréat. La proportion de bacheliers a effectivement bien augmenté depuis plusieurs décennies ; ce qui pourrait laisser penser que les inégalités se réduisent entre ceux qui ont le bac et ceux qui ne l’ont pas. Toutefois, il ne faut pas oublier que toutes les filières ou spécialisation de bac ne même pas aux mêmes études et aux mêmes parcours professionnels. Il existe un inégal accès au bac selon l’origine sociale ainsi qu’un inégal accès aux voies d’enseignement et aux filières. La dichotomie voies générale et technologique / voie professionnelle reste très forte.
Inégalités d’insertion
L’insertion professionnelle désigne l’entrée d’un individu sur le marché du travail, à l’issue de ses études. Les inégalités d’insertion font référence à la facilité plus ou moins grande de trouver un emploi après l’obtention d’un diplôme.
Les inégalités d’insertion s’expliquent en partie par le contexte économique puisque certaines professions bénéficient d’un « rendement » supérieur, surtout en contexte de crise. Dit autrement, ce sont des professions pour lesquelles on recherche de la main d’œuvre. L’insertion sur le marché du travail dépend aussi fortement du milieu social. Plusieurs travaux de recherchent soulignent qu’à diplôme égal, le taux de chômage est plus élevé pour les enfants d’ouvriers que pour les enfants de cadres. Cela est d’autant plus marqué pour les diplômes de voie professionnelle. Les diplômés issus de milieux favorisés bénéficient en général d’un capital social et de ressources symboliques (des informations, un réseau) qui leur permet de trouver du travail plus rapidement.
Il existe aussi des inégalités genrées en termes d’insertion professionnelle. Par exemple, pour les titulaires d’un master, on observe un taux d’insertion égal entre femmes et hommes. En revanche, les conditions d’emploi sont bien plus précaires pour les femmes (statut moins élevé, temps partiel, contrat à durée limitée).
Lire aussi : Les élèves français ont-ils toujours été mauvais en maths ?
Investissements familiaux
Il s’agit de l’ensemble des ressources mobilisées par les familles pour soutenir et favoriser la réussite scolaire de leurs enfants.
On peut d’abord distinguer les dépenses financières, en particulier quand il s’agit de se procurer du matériel scolaire ou des livres. On peut aussi y inclure le financement d’activités extra-scolaires (théâtre, sport, activités culturelles) qui peuvent directement ou indirectement jouer sur les résultats scolaires. Il ne faut pas oublier les cours de soutien, solution coûteuse et donc inégalement répartie en fonction des milieux sociaux. On inclut par ailleurs les dépenses temporelles (requises pour le suivi des résultats et des activités, mais aussi pour l’aide au devoir). Les conditions matérielles (le fait d’avoir une chambre ou un espace de travail) entrent aussi en jeu.
Ces pratiques viennent renforcer les inégalités déjà existantes. En effet, dans les milieux les plus aisés, les parents ont les revenus pour accompagner leurs enfants dans leur scolarité et leur créer les conditions de la réussite. Dans les milieux populaires, les parents disposent de moins de ressources à mobiliser.
Massification de l’enseignement
Cette expression renvoie au processus d’ouverture de l’institution scolaire depuis les années 1960, enclenchée par les pouvoirs publics et favorisé par la croissance économique et démographique. Cela se traduit dans les faits par une hausse du nombre d’élèves ayant accès à l’école et aux études supérieures ainsi qu’un allongement de la durée de scolarisation. Entre 1950 et 2020, le nombre d’élèves dans le secondaire a été multiplié par quatre ! De même, jusqu’au début des années 1950, moins de 5 % des élèves d’une classe d’âge accédait au baccalauréat, aujourd’hui cette proportion est de 79%.
La massification a ainsi permis à une très large majorité de jeunes d’être scolarisés et d’obtenir des diplômes alors que cela était auparavant réservée à une minorité d’élèves, issus des fractions les plus aisées. On parle alors de démocratisation, seulement elle est de nature « quantitative ». La massification de l’enseignement n’induit pas nécessairement une démocratisation « qualitative ». Les inégalités sociales et scolaires n’ont pas disparu, elles se sont déplacées et concernent désormais le type et la durée d’études.
Méritocratie
Ce terme renvoie au principe selon lequel une position sociale s’obtient grâce aux efforts fournis et au mérite individuel. Dans les sociétés modernes, cette idée suggère que tout individu, peu importe son sexe, son milieu social ou encore son origine ethnique, peut atteindre une position sociale prestigieuse grâce à ses talents et à son travail. La méritocratie favorise alors la mobilité sociale ascendante.
Appliquée au domaine scolaire, la méritocratie est fondamentalement liée au principe d’égalité des chances. En théorie, si chacun part sur un pied d’égalité, c’est bien le travail, le talent et l’effort qui permettent à un individu de réussir scolairement, d’obtenir un diplôme ou de passer un concours. Dans les faits, la recherche en sociologie souligne de manière claire et unanime « l’illusion » méritocratique. Malgré les dispositifs et les politiques éducatives, l’école française est très loin de compenser les inégalités d’origine sociale et de genre entre élèves. Le poids de l’origine sociale reste prégnant dans la réussite scolaire. Les quelques exemples de parcours de réussite sont encore des exceptions.
Paliers d’orientation
Il s’agit des différents embranchements propres à un cursus scolaire, à l’issue desquels l’élève choisit une voie, une section, une filière, etc.
Ces choix s’opèrent à tous les niveaux du parcours scolaire. Au collège, le système éducatif se divise en deux branches : la voie professionnelle d’une part, la voie générale et technologique d’autre part. Pendant l’année de seconde, les élèves s’orientent vers la voie générale ou technologique et définissent leurs enseignements de spécialité. En terminale, il s’agit de choisir une voie pour les études supérieures.
Le fait de prendre telle alternative plutôt qu’une autre est en général le fruit d’une réflexion complexe. Le choix s’opère en fonction d’un ensemble d’influences (milieu social, contraintes géographiques et/ou financières, conseils donnés par des professionnels ou par l’école, etc.).
PISA
PISA est l’acronyme de Programm for international student assessment ; ce qui signifie en français programme international pour le suivi des acquis des élèves. Il s’agit d’une étude menée tous les trois ans par l’OCDE depuis le début des années 2000. Son objectif est d’évaluer le niveau des élèves de 15 ans et donc mesurer les performances des systèmes éducatifs des pays membres et non membres de l’OCDE.
Les résultats PISA sont pris au sérieux en France et examinés avec intérêt. Ils attirent l’attention des pouvoirs politiques et de l’opinion publique sur la nécessité de réformer notre système éducatif. Depuis plusieurs éditions déjà, la France se situe dans la seconde moitié des pays de l’OCDE, parmi les moins performants. Surtout, au fur et à mesure des éditions, notre système d’éducation apparaît toujours plus inégalitaire, malgré les mesures mises en œuvre. La France est en effet l’un des pays de l’OCDE qui a le plus de mal à atténuer l’impact du milieu socio-économique sur les résultats scolaires.
Ségrégation scolaire
On peut définir la ségrégation scolaire comme la séparation des élèves dans des établissements différents, en fonction de leur milieu social et/ou de leur niveau scolaire. La ségrégation scolaire correspond alors à une situation d’entre-soi et de non-mixité sociale. Ce qui est tout l’inverse de l’idéal de notre école républicaine.
Pour comprendre la ségrégation scolaire, il faut avoir en tête le rôle joué par le facteur géographique. L’absence de mixité sociale dans les établissements ne reflète que l’absence de brassage social du quartier. Dans cette logique, on se retrouve face à des établissements accueillants un public favorisé, et à l’inverse d’autres écoles concentrent des élèves issus de milieux défavorisés. À cette ségrégation entre établissements s’ajoute une ségrégation entre classes au sein même des établissements : c’est la ségrégation intra-établissement. Cela s’explique en général par le regroupement des élèves en fonction de leurs options et matières.
En France, la ségrégation est très marquée pour les lycées (les collèges restent plus mixtes socialement). Ce constat est d’autant plus fort que l’on se trouve dans les milieux urbains où il existe une réelle polarisation.
Rendement du diplôme
Le diplôme peut être défini comme une forme d’investissement venant alimenter un stock de connaissances, appelé le capital humain. De ce point de vue, on peut se demander quelle rentabilité attendre de cet investissement en temps (des années d’études pendant lesquelles on a peu, ou pas travaillé) et en argent (coût de la formation et de la vie étudiante).
Le rendement d’un diplôme peut se mesurer par l’accès qu’un titre offre à un emploi stable (par convention, la stabilité de l’emploi se traduit par un contrat à durée indéterminée et à temps plein), à une position sociale et à une rémunération suffisante. Plus le rendement est élevé, plus les variables précédentes sont fortes et durables. Un diplôme présente aussi un bon rendement lorsque les compétences mises en œuvre correspondent au niveau du diplôme (pas de déclassement professionnel) et que l’individu détient des responsabilités.
En France, plus on est diplômés, plus on a de chances d’avoir un travail à temps complet, d’occuper une position sociale prestigieuse et de bénéficier d’une rémunération plus avantageuse.
Sous/surreprésentation
Cela désigne le fait qu’une catégorie de personnes soit (respectivement) moins /plus nombreuse en proportion dans un ensemble donné que dans la population de référence.
Le système scolaire français, porteur d’inégalités sociales, donne lieu à de nombreuses situations de sous et surreprésentation : élèves de milieux favorisés vs. défavorisés, filles vs. garçons, etc.
Par exemple, les filles sont sous-représentées dans les filières et les métiers scientifiques et techniques, notamment ceux liés aux mathématiques, à la physique ou à l’informatique (les garçons y sont donc surreprésentés). À l’inverse, elles sont surreprésentées dans les domaines des sciences humaines et sociales (SHS), dans l’éducation et la santé.
Idem, les milieux populaires sont largement sous-représentés dans l’enseignement supérieur et les milieux favorisés sont surreprésentés (en 2020, les enfants d’ouvriers représentent 12 % de l’ensemble des étudiants, alors que les ouvriers représentent 21 % de la population active. À l’opposé, les enfants de cadres supérieurs représentent 34 % des étudiants, alors que leurs parents forment seulement 18 % des actifs). Les écarts sont encore plus grands dans certaines filières). Les écarts sont encore plus frappants dans certaines filières (CPGE, écoles de commerce et écoles d’ingénieurs).
Stratégies familiales
En matière d’éducation, il s’agit de l’ensemble des attitudes ou actions d’une famille concernant le parcours scolaire de leurs enfants. L’objectif des familles étant la réussite de leurs enfants dans la voie sélectionnée ; les décisions ont un réel impact sur la trajectoire des élèves.
Les stratégies familiales sont visibles à travers les différents choix opérés tout au long de la scolarité. Ces derniers sont avant tout des choix de formation et d’orientation (découvrir ou approfondir une discipline, accéder à une filière, une section, une option, sélectionner un parcours d’études court ou long).
On distingue également des choix purement stratégiques. Concernant le choix de l’établissement, certaines familles n’hésitent pas à contourner la carte scolaire (en s’inscrivant dans un établissement privé, en choisissant des options rares, ou encore en logeant dans le périmètre de l’établissement visé). Certaines familles ciblent des options (allemand, latin, grec) pour que leur enfant puisse intégrer une « bonne classe » (les classes sont souvent organisées en fonction des options, ce qui concentre les élèves dans un même groupe).
Sortants sans diplôme
Ce qualificatif renvoie aux jeunes qui sont sans diplôme ou diplômés uniquement du brevet des collèges. Certains d’entre eux suivent une scolarité au lycée, mais n’obtiennent pas le bac. Quand ils ne suivent pas de formation, on parle des « sortants précoces ». Ces jeunes ont donc un niveau d’étude relativement faible au moment où ils entrent sur le marché du travail.
Les sorties sans diplôme concernent en grande majorité les jeunes issus de milieux défavorisés (au moins un parent chômeur ou inactif ou appartenant aux classes populaires). Ces individus cumulent échec scolaire et faiblesse du capital social, culturel et/ou économique des familles. Les sortants sans diplôme sont aussi majoritairement masculins. Des chercheurs ont aussi mis en lumière une corrélation positive entre redoublement et sortie sans diplôme.
Chaque année, ils sont environ 100 000 à quitter le système scolaire sans diplôme, soit 10% des 18-24 ans. Cette proportion a largement chuté depuis les années 1980 (divisée par quatre). Toutefois, un autre phénomène semble se dessiner : le décrochage massif des étudiants dans le premier cycle universitaire. Assisterait-on à un phénomène de sortants sans diplôme (sans licence) du supérieur ?
Théorie de l’acteur rationnel
La théorie de l’acteur rationnel est développée en 1973. La pensée de Raymond Boudon (1934-2013) s’inscrit dans une logique d’individualisme méthodologique. Pour lui, les comportements ne s’expliquent pas tellement par une structure sociale, mais par l’ensemble des actions des individus qui raisonnent à partir de calculs coûts/avantages.
Contrairement à Pierre Bourdieu, il estime que les inégalités ne sont pas imputables à l’institution scolaire, mais elles sont plutôt le résultat de choix individuels à chaque point d’orientation (langue, option, filière, , etc.).
Selon Boudon, si les enfants des classes populaires s’orientent le plus souvent vers les filières technologiques et professionnelles, c’est parce qu’il est rationnel et censé pour eux de le faire. De leur point de vue, les études courtes permettent une insertion professionnelle relativement rapide et efficace. Les études courtes sont par ailleurs moins coûteuses et permettent souvent une mobilité sociale intergénérationnelle. A l’inverse, les jeunes de milieux plus favorisés ont un autre rapport aux études. Les coûts d’études sont inférieurs aux bénéfices attendus : un diplôme, un salaire intéressant et un statut social au moins égal à celui des parents.
Théorie de la reproduction sociale
On doit la théorie de la reproduction sociale à Pierre Bourdieu (1930-2002). Cette thèse se forge dans les années 1960 et prend de l’ampleur les décennies suivantes. L’approche de Bourdieu peut être caractérisée d’holiste : les comportements individuels s’expliquent par le fonctionnement des structures sociales et du milieu social dans lequel évoluent les individus.
Selon cette approche, l’école est l’instrument de reproduction sociale par excellence. Loin d’être neutre, elle privilégie les élèves issus des catégories les plus favorisées, au détriment des autres et reproduit alors les inégalités sociales en vigueur. Les élèves issus des milieux dominants « héritent » d’un capital culturel et développent un « habitus » largement valorisés par l’école (par exemple : goût et maîtrise de la lecture, activités extra-scolaires, connaissances, diplômes des parents). Dit autrement, ils disposent d’une « culture légitime ». Au-delà du capital culturel, le capital social (relations sociales) et le capital économique des parents peuvent être un tremplin de réussite (choix d’une formation couteuse, aide pour trouver un emploi, etc.). À l’inverse, les élèves issus de milieux populaires sont beaucoup plus éloignés de cette culture scolaire et subissent alors ce que Bourdieu appelle « la violence symbolique ».