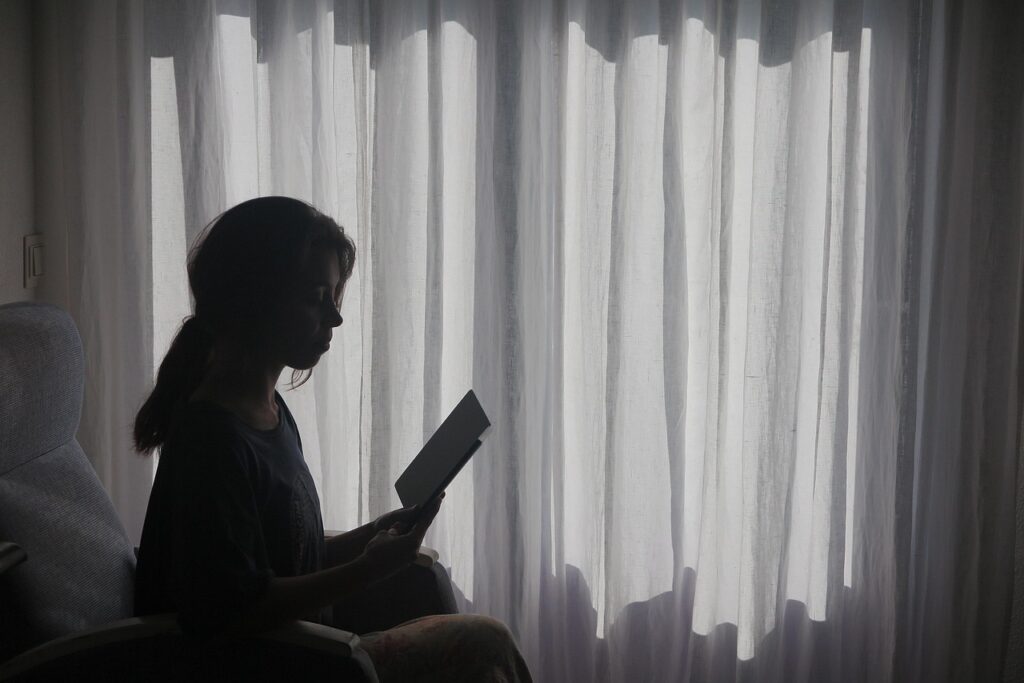Pendant des siècles, les femmes ont été silencieuses, non pas par manque d’esprit, mais par exclusion systématique. Privées d’éducation, confinées à la sphère domestique, elles étaient exclues de la littérature et du débat public. Pourtant, à travers les siècles, certaines femmes pionnières ont brisé ce silence : de l’Antiquité aux autrices modernes, la parole féminine s’est imposée. Cet article retrace ce parcours, du silence imposé aux voix affirmées, montrant comment l’écriture féminine devient un acte de résistance et d’émancipation.
Le silence imposé : l’exclusion de la parole féminine
Une tradition patriarcale de silence
Dans l’Antiquité et jusqu’à l’époque moderne, les femmes étaient très souvent exclues de la vie publique et intellectuelle. La célèbre scène de L’Odyssée, dans laquelle Télemachus exhorte Pénélope au silence, illustre comment la parole féminine était socialement reléguée à la sphère domestique. Ce silence n’était pas seulement une absence de voix, mais un principe structurant : l’un des plus anciens tropes dans la tradition littéraire occidentale est celui des femmes réduites au mutisme public par un ordre masculin.
Obstacle à l’écriture : accès limité à l’éducation, censure, invisibilisation
Pendant le Moyen Âge, l’accès à l’éducation restait très limité pour les femmes, sauf quelques exceptions religieuses. Certaines mystiques, comme Hildegarde de Bingen ou Marguerite Porete, ont proclamé leurs visions spirituelles à travers des écrits, mais souvent via un discours transcrit et parfois modifié par des hommes.
L’éducation, la propriété littéraire et la reconnaissance intellectuelle leur étaient refusées. Ce silence n’était pas passif : c’était une construction sociale volontaire destinée à maintenir la domination masculine.
Rompre le silence : les autrices qui ont osé écrire
L’écrivaine précoce : Jane Anger et l’audace féministe du XVIᵉ siècle
Jane Anger (1589) publie Her Protection for Women, un pamphlet militant dans l’Angleterre élisabéthaine, en réponse à l’argument masculiniste selon lequel « un esprit féminin n’est pas fait pour écrire ». En affirmant publiquement la valeur intellectuelle des femmes, elle dépasse le silence imposé à son sexe.
XIXᵉ siècle et début XXᵉ : voix enfin visibles
La période victorienne voit l’émergence d’autrices comme Jane Austen, les sœurs Brontë, Mary Shelley ou George Eliot. Selon Gilbert et Gubar, elles incarnent le dilemme du « monstre ou de l’ange » soit une injonction sociale à conformer leur écriture à des archétypes féminins, ou à l’inverse, à être reléguées comme subversives. Malgré cela, leurs récits ont tracé un chemin vers une autorité narrative féminine.
En détail : Dans The Madwoman in the Attic (1979), Sandra Gilbert et Susan Gubar théorisent le dilemme du « monstre ou de l’ange » auquel étaient confrontées les femmes écrivaines du XIXᵉ siècle. Selon elles, la société patriarcale imposait deux figures opposées : celle de l’ange, femme douce, soumise, vertueuse, idéale mais silencieuse ; et celle du monstre, femme rebelle, passionnée, jugée folle ou dangereuse car elle transgressait les normes. Ce dualisme enfermait les autrices dans une tension constante entre conformité et liberté. Beaucoup ont tenté de détourner ces figures en inventant des personnages ambigus ou en adoptant des stratégies d’écriture subversives. Ce concept éclaire encore aujourd’hui la manière dont la littérature façonne (ou libère) les représentations du féminin.
Dans son essai emblématique A Room of One’s Own (Une chambre à soi, 1929), Woolf affirme que pour qu’une femme puisse écrire librement, il lui faut de l’indépendance financière et un espace personnel. Elle y critique l’exclusion des femmes de l’histoire littéraire et invente le personnage fictif de Judith Shakespeare, sœur talentueuse mais invisible de William, pour symboliser les génies féminins étouffés par la société patriarcale.
Silence comme stratégie, parole comme force
La stratégie du silence
Dans plusieurs contextes, le silence féminin n’est pas toujours soumission : il peut être tactique, refuge, ou forme de résistance. Le silence fonctionne aussi comme arme discrète. Certaines femmes choisissent de ne pas parler plutôt que d’exprimer conformité ou soumission. Ce silence devient parfois un acte d’autonomie et de refus collectif – visible uniquement pour les lectrices initiées au demeurant.
La parole comme renaissance
Hélène Cixous, dans son essai manifeste Le Rire de la Méduse (1975), appelle les femmes à écrire avec leur corps, en donnant naissance à ce qu’elle nomme l’écriture féminine. Cette écriture, libérée des cadres rationnels, rigides et hiérarchiques imposés par le langage patriarcal, vise à exprimer une parole fluide, incarnée, intime. Cixous y renverse la figure de la Méduse, traditionnellement perçue comme monstrueuse, pour en faire un symbole de puissance féminine refoulée : « La Méduse est belle. Et elle rit. » Loin d’être une menace, cette voix oubliée devient une source de création, de liberté et de subversion. Le Rire de la Méduse est ainsi un appel à rompre le silence et à faire de l’écriture un acte d’émancipation.
Autrices modernes et contemporaines : les voix qui s’imposent
Simone de Beauvoir : philosopher pour libérer la parole
Dans Le Deuxième Sexe (1949), Simone de Beauvoir montre que la condition féminine est socialement construite :
« On ne naît pas femme, on le devient »
Elle analyse comment le patriarcat façonne la femme comme « l’Autre » et défend la liberté, l’indépendance et le droit à l’écriture. Son engagement, à la fois philosophique et militant, fait de l’écriture un acte politique.
Marguerite Duras : écrire dans l’intimité du désir et du silence
Marguerite Duras, sans se réclamer féministe, incarne une écriture minimale, intense, transgressive. Dans L’Amant ou Le Ravissement de Lol V.Stein, elle brosse des femmes en marge, désireuses, fortes, souvent incomprises. Elle lie écriture, désir et transgression sociale : écrire devient passage de la fille au sujet, et coupure avec l’ordre familial et colonial.
Duras signe le Manifeste des 343 en faveur de l’IVG, marquant son engagement réel au-delà du silence littéraire.
Annie Ernaux : l’intime comme vérité sociale
Annie Ernaux propose une écriture dépouillée, qui rend visible l’intime pour en faire un discours politique. Dans La Femme gelée (1981), elle analyse la condition féminine des années 60, entre corps, mariage, emprise sociale et aspirations d’émancipation. Dans L’Événement (2000), elle relate son avortement clandestin, affrontant tabou familial et médical, transformant l’expérience intime en récit social puissant. Enfin, L’Autre Fille (2023) revient sur le secret familial d’une sœur décédée, explorant mémoire, silence et identité à travers l’écriture.
Françoise Vergès : écrire pour la justice intersectionnelle
Historienne et essayiste engagée, Françoise Vergès articule genre, race, colonialité pour redonner la parole aux femmes opprimées. Elle interroge les silences structurels qui pèsent sur les femmes noires, colonisées, immigrées. Son écriture est militante, plurielle, et vise l’émancipation collective plutôt que l’intime isolé.
Conclusion
L’histoire de l’écriture féminine est celle d’un combat contre le silence imposé, apprivoisé ou retourné. De Simone de Beauvoir à Duras, Ernaux ou Vergès, les autrices ont fait de l’écriture un espace politique, intime, créatif. Elles ont affranchi le féminin du mutisme, refait du silence une matière littéraire, et rendu visible ce qui était tu. Écrire aujourd’hui en tant que femme, c’est poursuivre cet héritage : inventer une parole qui résiste à l’effacement, qui questionne, qui transforme.