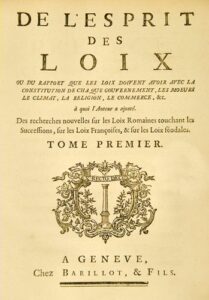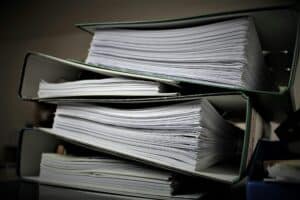Longtemps associé à des images de films noirs, de parrains siciliens et de règlements de comptes entre clans rivaux, le crime organisé dépasse aujourd’hui largement les clichés. Il ne s’agit plus de quelques familles secrètes opérant dans l’ombre, mais de réseaux puissants, transnationaux et structurés, qui infiltrent les économies, corrompent les États, exploitent les failles de la mondialisation et prospèrent dans les zones grises du droit. De la mafia italienne aux cartels mexicains, des triades chinoises aux groupes cybercriminels, le crime organisé est un acteur discret mais central de l’ordre mondial. Quelles formes prend-il aujourd’hui ? Quels territoires contrôle-t-il ? Et comment y répondre ?
Ce qu’il faut retenir sur le crime organisé
Définition du crime organisé : forme de criminalité durable et structurée, souvent hiérarchisée, impliquée dans des activités économiques illicites, avec recours à la violence et à la corruption.
Origines historiques : Sicile (mafia), États-Unis (Cosa Nostra), Japon (Yakuza), Chine (triades), Russie (Bratva).
Formes contemporaines : narcotrafic, traite humaine, cybercriminalité, extorsion, blanchiment, trafic d’armes.
Stratégie : fonctionnement en réseau, alliances souples, infiltration de l’économie légale, usage stratégique de la terreur.
Le crime organisé n’est plus marginal : il influence des pans entiers de la vie politique, économique et sociale à l’échelle mondiale.
Le crime organisé : des racines anciennes et un code récurrent
Le crime organisé trouve souvent son origine dans des contextes de pauvreté, d’absence d’État ou de tensions identitaires. En Sicile au XIXᵉ siècle, la mafia se présente comme protectrice de la population face à l’injustice, avant de devenir une force de prédation. Aux États-Unis, au lendemain de la prohibition, Cosa Nostra se développe grâce au trafic d’alcool, puis de drogues, et infiltre les syndicats, la politique locale et la finance. En Russie post-soviétique, l’effondrement de l’État crée un vide comblé par les mafias.
Ces groupes partagent plusieurs caractéristiques : un code d’honneur, une hiérarchie floue mais réelle, une capacité de violence ciblée, et surtout, une logique d’enracinement territorial couplée à une ambition transfrontalière. Mais avec la mondialisation, ces structures deviennent plus fluides. Les grandes familles disparaissent parfois, remplacées par des réseaux plus discrets, numériques, interconnectés.

Des économies parallèles
Le crime organisé ne se contente pas de vendre de la drogue ou des armes : il construit de véritables économies souterraines, souvent intégrées à l’économie légale. Le blanchiment d’argent est au cœur du système : casinos, immobilier, sociétés-écrans, cryptoactifs, œuvres d’art — tout devient outil pour réintroduire des capitaux illicites dans le circuit légal.
Les mafias et cartels se diversifient : trafics de migrants, cyberattaques, contrefaçon, pillage de ressources naturelles, pillage archéologique. En Afrique ou en Asie, certains groupes armés deviennent à la fois milices et entreprises criminelles. Le crime organisé exploite la faiblesse des États, le désespoir des populations, mais aussi les défaillances de la finance mondiale.
Selon l’ONU, le crime organisé génère chaque année plus de 2 000 milliards de dollars, soit plus que le PIB de la France. Il est le quatrième acteur économique mondial… sans siège social.

Cartels, triades, mafias : géographie du crime organisé
L’Italie reste emblématique, avec ses trois grandes organisations : Cosa Nostra (Sicile), la ‘Ndrangheta (Calabre) et la Camorra (Naples). Cette dernière est particulièrement impliquée dans les trafics de déchets toxiques, en lien avec certaines entreprises industrielles. La ‘Ndrangheta, elle, contrôle une part significative du trafic de cocaïne en Europe.
En Amérique latine, les cartels mexicains comme le Cartel de Sinaloa ou le Cartel Jalisco Nouvelle Génération sont devenus de véritables puissances militaires, capables de défier l’État. Ils disposent de drones, d’armées privées, de services de renseignement, et recrutent à l’échelle nationale.
En Asie, les triades chinoises mêlent criminalité, diaspora, politique locale et investissements à l’étranger. En Afrique, des réseaux nigérians ou maghrébins contrôlent des pans entiers du trafic d’humains ou de drogue vers l’Europe. Et partout dans le monde, les groupes russes (Bratva) opèrent dans la cybercriminalité, les métaux rares, ou les casinos.
Le crime organisé est une carte invisible, mais puissante, du monde contemporain.

Le crime organisé : une criminalité polymorphe
Les groupes criminels ont parfaitement su s’adapter à l’ère numérique. Le cybercrime est aujourd’hui une branche majeure du crime organisé : vols de données bancaires, ransomware (logiciels de rançon), piratage de comptes publics, chantage numérique. Les cryptomonnaies offrent une discrétion nouvelle aux transactions.
Le dark web devient un marché parallèle, où s’échangent armes, drogues, documents d’identité, et services illicites. Ces nouvelles pratiques permettent de sous-traiter le crime, de déterritorialiser l’activité, et de compliquer l’enquête judiciaire. Il est désormais possible de commander une cyberattaque à distance, contre paiement en bitcoin, sans jamais croiser un complice. Le crime organisé a muté, mais sa logique reste la même : gagner de l’argent en exploitant les failles du système.
Crime organisé et pouvoir politique
Dans certaines régions du monde, la frontière entre crime organisé et pouvoir politique est floue. Des élus locaux, des policiers, voire des ministres collaborent avec des organisations criminelles, en échange d’argent, de votes ou de silence. Le phénomène du narco-État, comme au Honduras ou au Venezuela, en est un exemple extrême.
Même dans les démocraties, les mafias cherchent à influencer la politique locale : campagnes électorales financées, intimidations, votes achetés. Leur objectif n’est pas de prendre le pouvoir, mais de le contrôler à distance, pour garantir l’impunité et l’accès aux marchés publics.
La ville de Naples, longtemps gangrenée par la Camorra, en est un cas emblématique. Ce réseau criminel, tentaculaire, a su tisser des liens profonds avec le tissu économique et politique local, jusqu’à orienter certains appels d’offres publics ou influencer des nominations administratives. Dans certains quartiers, les chefs mafieux remplacent l’État en distribuant de l’aide sociale ou en « assurant » la sécurité.
Ce lien entre criminalité et politique explique en partie la difficulté à démanteler certains réseaux : ils ne vivent pas en marge de la société, ils en occupent les interstices.

Conclusion
Le crime organisé est aujourd’hui un acteur global de la mondialisation, capable de s’adapter à toutes les mutations : numériques, économiques, géopolitiques. Il ne se contente plus d’exister dans l’ombre — il infiltre, il façonne, il influence.
Le défi n’est pas seulement policier : il est politique, social et moral. Car la vraie force du crime organisé, ce n’est pas sa violence spectaculaire, mais sa capacité à s’insérer dans nos faiblesses collectives : pauvreté, corruption, dépendance à certaines consommations, absence de règles claires à l’échelle mondiale.
Lutter contre ces réseaux ne suffit pas à les faire disparaître. Il faut aussi réduire leur attractivité, en renforçant les institutions, en promouvant l’éducation, en traçant l’argent illicite, en coopérant à l’échelle internationale. Cela exige du temps, de la volonté et de la cohérence.