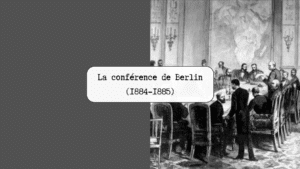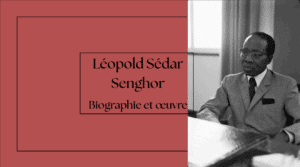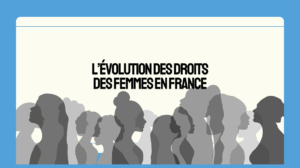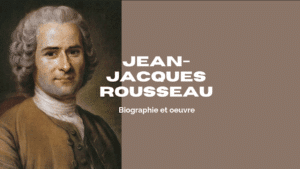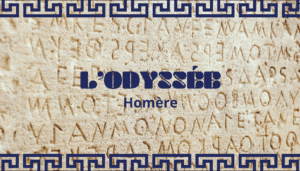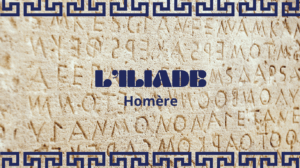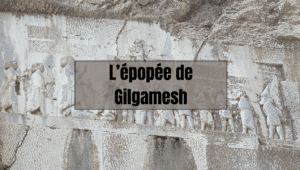Le procès de Nuremberg, qui s’est tenu du 20 novembre 1945 au 1er octobre 1946, est un événement fondateur du droit pénal international. Organisé par les Alliés (États-Unis, URSS, Royaume-Uni, France), ce tribunal militaire international a jugé les principaux dignitaires nazis pour crimes contre la paix, crimes de guerre et crimes contre l’humanité. Il marque une rupture fondamentale en instaurant le principe de responsabilité individuelle, en définissant juridiquement les crimes contre l’humanité et en affirmant leur imprescriptibilité.
Le choix de Nuremberg, haut lieu du nazisme, n’est pas anodin : en condamnant les acteurs du régime hitlérien dans cette ville symbolique, les Alliés ont voulu affirmer une nouvelle ère de justice internationale. Ce procès historique a posé les fondations des futures juridictions pénales, menant notamment à la création de la Cour pénale internationale (CPI).
Comment s’est déroulé ce premier tribunal international ? Quels furent ses verdicts et son impact sur la justice mondiale ? Décryptage d’une étape clé de l’histoire du XXe siècle.
Qu’est-ce que le procès de Nuremberg ?
Le procès de Nuremberg s’est déroulé du 20 novembre 1945 au 1er octobre 1946 dans la ville de Nuremberg, en Bavière, située dans la zone d’occupation américaine, à l’ouest de l’Allemagne. Le choix de cette ville n’est pas anodin : haut lieu des congrès du parti nazi, elle avait accueilli les grandes manifestations du régime hitlérien et vu la promulgation des lois raciales antisémites de 1935. En jugeant les responsables nazis dans cette ville symbolique, les Alliés ont voulu marquer une rupture avec l’idéologie totalitaire et affirmer les principes d’une nouvelle justice internationale.
Contexte historique et genèse du procès de Nuremberg
Pourquoi juger les responsables nazis après 1945 ?
L’idée d’un jugement des dirigeants nazis prend forme dès janvier 1942, avec la Déclaration de Saint-James, où plusieurs gouvernements en exil à Londres affirment leur volonté de poursuivre les responsables des crimes nazis. Cette décision est renforcée en 1943 par la Déclaration de Moscou, signée par Roosevelt, Staline et Churchill, qui annonce que les criminels nazis seront poursuivis et jugés. Ces engagements aboutissent à l’Accord de Londres du 8 août 1945, créant le Tribunal militaire international (TMI), un tribunal ad hoc, c’est-à-dire un tribunal créé uniquement temporairement et uniquement pour juger des cas spécifiques, mis en place par les Alliés.
Après la capitulation du Troisième Reich en mai 1945, les Alliés veulent juger 24 hauts dignitaires nazis, à la différence de 1918 où les responsables allemands avaient échappé à toute sanction individuelle. L’objectif est de mettre en lumière l’ampleur des crimes commis par le régime hitlérien et de poser les bases d’une nouvelle justice pénale internationale.
Organisation et déroulement du procès de Nuremberg
Le tribunal est composé de juges et procureurs des quatre puissances alliées. Chaque pays est représenté par deux magistrats : un procureur général et un procureur adjoint. La France est représentée par François de Menthon (procureur général) et Edgar Faure (procureur adjoint), ce dernier devenant par la suite une figure politique majeure de la IVe et de la Ve République.
Qui sont les accusés jugés à Nuremberg ?
Tous les accusés du procès de Nuremberg bénéficient d’un avocat pour assurer leur défense. Parmi eux figurent :
- Hermann Göring, ancien numéro 2 du Reich,
- Rudolf Hess, ancien adjoint d’Hitler,
- Albert Speer, ministre de l’Armement,
- Joachim von Ribbentrop, ministre des Affaires étrangères.
Les principaux responsables nazis, à savoir Adolf Hitler, Heinrich Himmler et Joseph Goebbels, ne sont pas présents, s’étant suicidés avant la fin de la guerre.

Les accusés sont jugés selon quatre chefs d’accusation :
- Crimes contre la paix : préparation et conduite d’une guerre d’agression,
- Crimes de guerre : violations des lois et coutumes de la guerre (assassinats de prisonniers, traitements inhumains, destructions illégales),
- Crimes contre l’humanité : persécutions, génocides, extermination de civils,
- Conspiration : participation à un complot visant à commettre ces crimes.
Le crime contre l’humanité : une notion juridique révolutionnaire
Le concept de crime contre l’humanité, défini pour la première fois par le tribunal, se distingue du crime de guerre. Alors que ce dernier concerne des exactions commises dans le cadre d’un conflit armé, le crime contre l’humanité vise des actes systématiques et planifiés contre des populations civiles, indépendamment de la guerre. Il inclut le génocide, la déportation, la réduction en esclavage, la torture, et l’extermination de groupes ethniques ou politiques. Selon la formule d’André Frossard, c’est « tuer quelqu’un parce qu’il est né ». Les crimes contre l’humanité ont une valeur imprescriptible, c’est-à-dire qu’ils n’ont pas de délais de presciption et qu’il est ainsi possible d’engager des poursuites judiciaires contre les auteurs, sans limite de temps.
Le procès de Nuremberg met ainsi en lumière l’ampleur des crimes nazis, notamment :
- Le génocide des Juifs d’Europe : 1,1 million de Juifs assassinés à Auschwitz entre 1942 et 1944,
- Les persécutions contre les Roms, les handicapés et les opposants politiques,
- Les centres de mise à mort comme Chelmno (152 000 victimes), Maïdanek (80 000), et Sobibor (250 000), où des millions de personnes ont été exterminées.
Quels acquittements ont été prononcés ?
Sur les 24 accusés du procès de Nuremberg :
- 12 sont condamnés à mort (dont Göring, Ribbentrop et Kaltenbrunner),
- 3 à la prison à perpétuité,
- 4 à des peines de prison,
- 3 sont acquittés,
- 2 ne sont pas jugés, l’un étant jugé inapte et l’autre s’étant suicidé.
Un héritage durable : le procès de Nuremberg et la justice internationale
Le procès de Nuremberg pose les bases du droit pénal international en affirmant que les responsables de crimes de masse doivent être jugés individuellement et que le crime contre l’humanité est imprescriptible.
Il ouvre la voie à la création de la Cour pénale internationale (CPI) en 1998, entrée en vigueur en 2002, chargée de poursuivre les crimes les plus graves, notamment les génocides, crimes de guerre et crimes contre l’humanité.
Par ailleurs, plusieurs procès se déroulent en parallèle pour juger d’autres dirigeants nazis, avec notamment le procès des médecins nazis, qui aboutit à l’adoption du Code de Nuremberg (1947), un texte fondateur de la bioéthique moderne, imposant notamment le consentement éclairé dans les expérimentations médicales.
Comment Nuremberg a inspiré la Cour pénale internationale ?
Le procès de Nuremberg constitue une révolution juridique en instaurant le principe de responsabilité individuelle pour les crimes de masse. Il marque l’émergence du crime contre l’humanité, dont l’imprescriptibilité garantit que les coupables ne peuvent échapper à la justice, quelles que soient les circonstances.
En inspirant la Cour pénale internationale, il jette les bases d’un ordre juridique mondial, rappelant la nécessité de défendre la dignité humaine face aux atrocités de masse. Pourtant, le chemin reste encore long, et la mise en œuvre de la justice internationale reste un défi majeur du XXIe siècle.