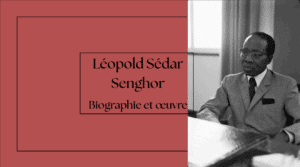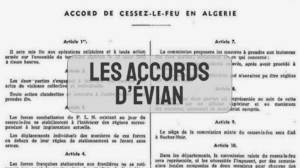Depuis 1945 avec la mise en place des institutions multilatérales toujours en vigueur aujourd’hui (Organisation des Nations unies, Fond Monétaire International, Banque Mondiale, GATT puis Organisation mondiale du Commerce, construction européenne à partir de 1950, etc.), la plupart des pays du monde ont pris part à la mondialisation, ce processus historique, pluriséculaire, de mise en relation des sociétés du monde entier, devenu un lieu commun à toute l’humanité. À partir des années 1990, on distingue une nouvelle phase de la mondialisation, accélérée par l’essor du secteur financier et des nouvelles technologies de l’information et de la communication, qui permettent aux capitaux et aux informations de parcourir le monde. Mais cette intégration à la mondialisation bouleverse l’organisation des pays, avec des acteurs et des territoires vus comme « gagnants » et d’autres « perdants » de la mondialisation, accentuant les inégalités. Ainsi, en parallèle de son développement, des contestations de la mondialisation émergent. Celle-ci peut prendre la forme d’un rejet pur et simple de la mondialisation, c’est l’antimondialisation. Une autre forme de contestation possible intègre certaines dynamiques de la mondialisation (diffusion des idées, des cultures), en en rejetant d’autres, notamment financières (financiarisation, accroissement des inégalités). On parle alors d’altermondialisation, qui promeut une « autre mondialisation », moins violente. Dès lors, comment a évolué la contestation de la mondialisation depuis les années 1990 ?
Les adaptations
Développement durable et économie verte
En 1987, le rapport Brundtland fait émerger la notion de développement durable. Parfois accusé de greenwashing (ou faux verdissement), le développement durable ne serait alors qu’un perfectionnement du capitalisme libéral, sans remettre en cause le rôle de ce dernier dans les déséquilibres du monde. L’émergence de la notion de développement durable a tout de même permis le renforcement de la conscience climatique des dirigeants et des opinions publiques et de la nécessité pour les populations des pays développés de changer leur mode de vie, qui repose encore massivement sur l’utilisation de sources d’énergie carbonées, très polluantes par leurs rejets massifs de CO2. Mais il est vrai que le développement durable a comme concept central un « rendement soutenu maximal » qui promeut une vision réversible de la nature, erronée (on ne peut pas revenir en arrière sur les émissions de gaz à effet de serre émises hier, qui entraînent le réchauffement d’aujourd’hui et en partie de demain).
Face à ces limites, l’ONU a tenté d’aller plus loin que le concept de développement durable, en promouvant une « économie verte » au sommet Rio + 20 en 2012 (20 ans après le Sommet de la Terre de Rio, moment important à l’échelle mondiale). L’économie verte correspond à une alternative à l’économie actuelle, brune, dépendante des ressources fossiles en voie d’épuisement.
L’Union européenne entend affirmer un leadership mondial sur la transition écologique. Elle met en avant une « économie verte et inclusive », qui reconnaît que les modes de croissance actuels ne sont pas viables et se traduit concrètement depuis 2020 avec le Pacte Vert européen, ou European Green Deal.
Le commerce équitable
L’idée du commerce équitable est antérieure à la phase actuelle de la mondialisation, qui émerge dès les années 1940, dans les années 1950 avec l’organisation non gouvernementale Oxfam, puis surtout dans les années 1960 avec le label Max Havelaar sur la production de café. L’idée est de payer plus cher les produits pour mieux rémunérer les producteurs, le label étant censé garantir un mode de production durable et une distribution respectueuse des écosystèmes et à faibles émissions de carbone, ainsi qu’une traçabilité des produits. Mais ces labels de commerce équitable courent le risque d’une récupération. Dans tous les cas, le chiffre d’affaires du commerce équitable a été multiplié par six entre 2003 et 2012, atteignant alors 6 milliards de dollars, ce qui reste très peu. 60 millions de personnes et 1500 groupements de producteurs y participent alors.
L’économie de partage constitue un autre modèle « disruptif » (c’est-à-dire bousculant les marchés établis). Ce dernier s’appuie sur la désintermédiation (suppression des intermédiaires, que sont les grandes surfaces comme Carrefour, Auchan, entre autres) permise par internet et les applications sur smartphone comme AirB&B, Blablacar, etc. Cela abaisse le coût pour le consommateur (qui a moins d’intermédiaires à rémunérer), mais ne génère pas beaucoup d’emplois. Et si l’économie de partage correspond à des revendications libertaires (se libérer des intermédiaires à fort pouvoir de contrainte), elle est également un optimum de la dérégulation libérale (s’affranchissant de nombreuses règles de sécurité). L’extension se fait au détriment du droit du travail, ce qui entraîne une précarisation des travailleurs, devant cumuler les mini-jobs. Les débats actuels sur le salariat des chauffeurs Uber ou des livreurs Deliveroo illustrent ces tensions. En Allemagne, la pauvreté a augmenté du fait de l’émergence de ces travailleurs pauvres. En France, le débat porte notamment sur l’absence de protection sociale pour ces travailleurs (n’étant pas salariés, ils ne sont pas rémunérés s’ils sont immobilisés après un accident du travail, et ne cotisent pas pour leur retraite future).
Lire aussi : HGGSP : l’alimentation, un marché intégré dans la mondialisation
Les ruptures
La décroissance
La thèse de la décroissance est née dans les années 1970 avec la contestation écologique et est repartie avec l’urgence climatique actuelle. L’idée est que la poursuite de la croissance est intrinsèquement incompatible avec une gestion durable des ressources de la planète et des activités neutres en carbone, pourtant nécessaires face au réchauffement climatique. Elle n’implique pas une baisse du niveau de vie cependant, mais un investissement tourné vers des secteurs non polluants comme l’éducation notamment. Cependant, le terme de « décroissance » fait peur, alors qu’il s’agit en réalité d’une autre croissance (on peut aussi voir une décroissance de fait dans les pays développés, non construite ni souhaitée, par la désindustrialisation). En France, la thèse de la décroissance a notamment été portée par Pierre Rabhi, Jacques Ellul et Serge Latouche, pour abandonner le productivisme et « penser globalement, agir localement » face au constat de l’épuisement inévitable des ressources.
L’idée de décroissance va plus loin que le rapport Meadows de 1972 « Halte à la croissance », d’une croissance zéro. La décroissance suppose un changement de civilisation avec une sobriété volontaire et la suspicion de la technique. Une décroissance soutenable suppose une action à l’échelle locale, ce qui pose une question politique, les échelons politiques étant plus globaux.
Une nouvelle révolution industrielle ?
La récurrence des crises depuis le début du processus de mondialisation semble remettre en cause le modèle d’accumulation qu’elle porte (en tant que néolibérale), avec des crises majeures en 1973, 1979, 1997, 2001 et surtout 2008 et 2020.
Certains auteurs voient alors l’entrée dans une stagnation séculaire. Pour Paul Gordon, la révolution Internet induirait de moindres effets sur l’activité que la révolution électrique ou mécanique des siècles précédents. Le rendement de l’innovation dans les nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) est médiocre : le coût de développement de nouveaux composants électroniques ou médicaments est très élevé pour une rentabilité aléatoire, d’où une moindre productivité.
Pour Jeremy Rifkin (La nouvelle société du coût marginal zéro), une troisième Révolution industrielle doit résulter de la mondialisation. Il constate qu’aujourd’hui, les gains des entreprises ne s’investissent plus dans la recherche d’innovation, contrairement aux deux premières Révolutions industrielles, les innovations d’aujourd’hui servent juste à réduire les coûts (d’où un chômage élevé). Les grandes entreprises n’ont jamais possédé autant de liquidités (en 2015 40% de plus qu’en 2007), signe qu’elles n’investissent pas assez. Or pour lui, les emplois de demain seront créés par le big data. Il propose un capitalisme distribué où chacun serait à la fois entrepreneur, consommateur, producteurs (avec par exemple des panneaux solaires sur le toit de sa maison). Les petites et moyennes entreprises seraient le moteur de l’activité économique, les firmes transnationales les arbitres. La logique d’économie d’échelles (qui a beaucoup favorisé les FTN jusqu’ici) ne serait alors plus pertinente à l’heure du fonctionnement en réseau. L’économie de demain reposerait alors sur l’entrepreneuriat social et la maximisation environnementale.
Ainsi, la contestation de la mondialisation a constamment accompagné cette dernière. Elle a connu différentes formes, notamment l’antimondialisation, l’altermondialisation. Aujourd’hui la contestation de la mondialisation prend principalement deux formes très différentes : la mise au premier plan de l’urgence écologique, avec laquelle la mondialisation actuelle reposant sur une croissance de la production et des échanges polluants est incompatible, et le nationalisme, face à la précarisation accrue de populations touchées par les délocalisations à l’échelle mondiale. Mais si la mondialisation ralentit, elle continue de progresser, ce qui est notamment visible par la croissance des échanges mondiaux de biens, hors période de crise comme le Covid.
Lire aussi : HGGSP : les systèmes agraires