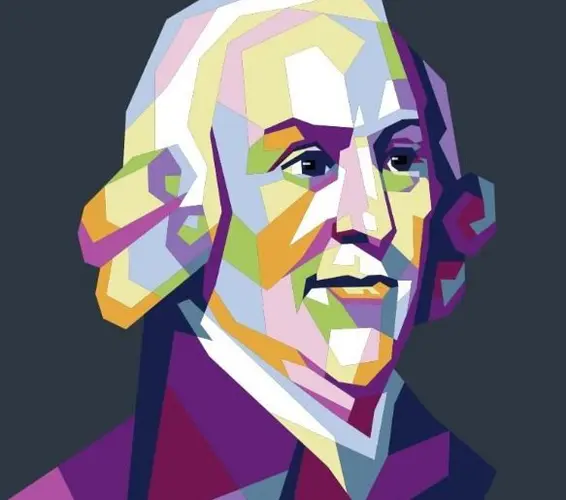En conciliant l’héritage des moralistes et la rationalité économique, Adam Smith ouvre la voie à une anthropologie complexe : l’homme est un être de besoins, mais aussi de justice et de compassion, un « animal social » au sens d’Aristote (« zoon politikon »).
Biographie d’Adam Smith
Adam Smith occupe une place singulière à la croisée de la philosophie morale et de l’économie. Né en 1723 à Kirkcaldy, Smith s’inscrit dans le contexte effervescent des Lumières écossaises, marqué par des figures telles que David Hume, dont l’influence se ressent tant dans sa méthode empirique que dans son scepticisme modéré. Hume soutenait que « la raison est, et ne doit qu’être, l’esclave des passions » (« Treatise of Human Nature »), préparant ainsi le terrain à Smith pour placer la sensibilité au cœur de la vie morale. Chez lui, l’étymologie du mot « sympathie » (du grec συμπάθεια, sympathéia, « ressentir avec ») indique bien ce mouvement intérieur par lequel chacun s’ouvre à autrui ; Smith élabore ce thème central dans sa première œuvre majeure, la « Théorie des sentiments moraux » (1759), où il écrit : « Nous ne sommes jamais autant choqués par le malheur d’autrui que lorsqu’il nous touche de quelque manière ».
Adam Smith : une définition du cadre moral de l’acteur économique moderne
Avec « La Richesse des nations » (1776), Smith introduit les bases de l’économie politique moderne, plaçant l’intérêt individuel et la division du travail au centre du développement sociétal. Pour lui, « ce n’est pas de la bienveillance du boucher, du brasseur ou du boulanger que nous attendons notre dîner, mais de leur propre intérêt » (Livre I, chap. II). Pourtant, cette affirmation ne réduit pas l’acteur économique à l’égoïsme pur : Smith nuance, dans la « Théorie des sentiments moraux », la recherche de l’intérêt personnel par l’existence d’un « spectateur impartial », instance intérieure qui évalue secrètement nos actions.
Distinction entre moraliste et économiste chez Smith
La distinction entre moraliste et économiste ne signifie pas rupture mais transition dynamique. L’homme smithien demeure traversé par la tension entre le sens moral — synonyme ici de capacité à reconnaître autrui comme un prochain, à la manière de la charité chrétienne selon Thomas d’Aquin (« Caritas est amicitia hominis ad Deum super omnia ») — et la poursuite de son propre intérêt. Historiquement, ce questionnement fait écho aux débats médiévaux sur l’usus et la proprietas (l’usage et la propriété, chez Aristote puis Aquin), montrant que l’économie prend naissance dans le sillage des réflexions morales sur la justice.
La sympathie comme fondement de l’éthique chez Adam Smith
La sympathie s’incarne dans des exemples concrets et universels : la relation parent/enfant, la solidarité face à autrui en souffrance – lors d’une catastrophe ou d’une grande épreuve collective – révèle l’enracinement de la sympathie dans la nature humaine.

La sympathie chez Adam Smith
Pour Smith, la sympathie désigne un mécanisme complexe, à la fois émotionnel et cognitif : il s’agit de la capacité de ressentir une émotion analogue à celle vécue par autrui, en se figurant sa situation. Il affirme ainsi : « Quelle que soit la passion qui naît d’un objet chez la personne principalement concernée, une émotion analogue surgit, à la pensée de sa situation, dans le sein de chaque spectateur attentif » (TSM, I, i, p.15). Smith étend la sympathie au-delà de la simple compassion, la rapprochant du concept de « fellow-feeling » – un « sentiment de communauté avec autrui ». Cette capacité ne se limite pas à une réaction impulsive ; elle inaugure un véritable jugement moral, puisque l’évaluation d’une action naît précisément de la correspondance ou non entre nos sentiments et ceux d’autrui.
Empathie moderne et sympathie chez Smith
À la différence de l’empathie moderne, qui suppose une immersion profonde dans les émotions d’autrui, la sympathie smithienne garde une certaine distance et s’organise autour d’une projection imaginative, d’un effort pour « entrer dans la situation de l’autre » sans toutefois perdre conscience de soi. L’empathie, dans sa compréhension actuelle, implique souvent une participation plus intime au ressenti d’autrui, alors que la sympathie se contente de reconnaître la peine ou la joie de l’autre, tout en restant spectateur. Cette distinction s’avère décisive dans la construction du regard moral : la sympathie permet le jugement, l’évaluation et la régulation des affections, là où l’empathie est expérience.
Pitié chez Roussseau et charité chrétienne
La sympathie smithienne rejoint la notion rousseauiste de pitié : pour Rousseau, « la pitié est une répugnance instinctive à voir souffrir son semblable » (« Discours sur l’origine de l’inégalité »). Rousseau y voit la racine première d’une morale spontanée, qui s’oppose à la dureté d’une raison calculatrice ; la pitié incite à porter secours sans réflexion, par un mouvement naturel. À l’horizon théologique, la sympathie trouve un écho dans la charité chrétienne. Saint Augustin formule l’exigence du « dilectio proximi », l’amour du prochain, comme reflet de l’amour divin. La charité est le sommet des vertus : elle mène à la béatitude, au bonheur suprême, et harmonise la dimension affective, rationnelle et sociale de l’être humain.
L’économie politique : autonomie ou continuité de l’éthique smithienne ?
Principe et explication de la « Main invisible »
La réflexion d’Adam Smith sur l’économie politique marque une interrogation centrale pour la pensée moderne : l’autonomie du marché constitue-t-elle une rupture d’avec l’éthique ou sa continuité ? Smith forge le célèbre principe de la « main invisible » dans La Richesse des nations (1776). Cette métaphore désigne le mécanisme par lequel la poursuite de l’intérêt personnel, loin de nuire à la société, contribue paradoxalement au bien commun. Smith écrit : « En cherchant son propre intérêt, [l’individu] travaille souvent d’une manière bien plus efficace pour l’intérêt de la société que s’il avait réellement pour but d’y travailler ». Ainsi, la coordination spontanée des échanges sur le marché assure la prospérité commune sans planification centrale, principe qui fonde le libéralisme économique.
La Fable des abeilles de Mandeville
Cependant, Smith n’oppose pas la morale à l’intérêt individuel : il refuse de confondre égoïsme et rationalité du marché. L’opposition la plus féconde à Smith provient de Bernard Mandeville, auteur de La Fable des abeilles (1714). Mandeville défend l’idée provocatrice selon laquelle « les vices privés font les vertus publiques ». Dans sa célèbre satire, il décrit une ruche corrompue mais prospère ; l’élimination du vice entraîne le déclin économique : « La simple vertu ne peut faire vivre les nations dans la splendeur ; […] la prospérité implique le développement de propensions vicieuses ». Smith critique Mandeville pour avoir confondu intérêt personnel et cupidité, jugeant que ce dernier naturalise le vice et oublie que le marché exige une discipline morale : « l’intérêt personnel guidé par la sympathie ne devient pas avidité destructrice ». Ainsi, Smith nuance la lecture purement self-interested du marché en rappelant le besoin de modération et d’institutions.
L’éthique smithienne face aux défis contemporains
Dans une économie mondialisée, la « sympathie » apparaît comme un antidote à la déshumanisation croissante des échanges : Smith insistait déjà sur la nécessité de considérer la condition des plus modestes, soulignant que « aucune société ne peut être florissante et heureuse si la plus grande partie de ses membres est pauvre et misérable » (« La Richesse des nations »). Ainsi, la sympathie n’est pas simplement une posture morale, elle appartient à l’ordre de la justice sociale.
Limites de la « main invisible »
Pourtant, les crises contemporaines, en particulier celle de 2008, ont mis en évidence les limites du principe de la main invisible et du mythe de l’autorégulation des marchés. L’effondrement des marchés financiers et l’enchaînement de comportements spéculatifs ont exigé une intervention massive des États, révélant que la poursuite de l’intérêt individuel pouvait fragiliser l’intérêt général lorsque la régulation morale et institutionnelle faisait défaut. Des économistes tels que Thomas Piketty ont montré que les déséquilibres du marché, loin de se résorber seuls, pouvaient durer et aggraver la pauvreté, soulignant la nécessité d’actions correctrices. Le soupçon à l’égard d’une main invisible toute-puissante exige de redonner une place centrale aux régulations publiques et à la responsabilité collective.
Un homo oeconomicus pas toujours si rationnel
En outre, les récents travaux d’Antonio Damasio ont révélé que les émotions jouent un rôle crucial sur les marchés : loin d’être purement rationnels, les choix économiques sont guidés par des signaux affectifs appelés « marqueurs somatiques », lesquels orientent les décisions. L’instabilité financière trouve ainsi son origine autant dans les paniques collectives ou l’euphorie spéculative que dans d’objectifs calculs, remettant en cause la vision d’un homo œconomicus détaché de toute passion. La prise en compte de ces dimensions émotionnelles invite à repenser la rationalité, la prévoyance et la solidarité dans la gouvernance économique.
La question de la RSE au XXIe siècle
Face à ces constats, la question de la responsabilité sociale des entreprises (RSE) devient décisive. Smith n’aurait sans doute pas approuvé un capitalisme tourné uniquement vers le court terme et la maximisation du profit, au détriment du bien-être collectif. Aujourd’hui, l’entreprise, loin d’être réduite à une somme de contrats, devient un acteur social incontournable, détenteur d’une mission éthique envers l’ensemble des parties prenantes. L’enjeu est alors d’opérer un dépassement de l’individualisme étroit pour promouvoir une gouvernance plus inclusive : partage des fruits de la croissance, réduction des inégalités, attention à l’environnement et respect de la dignité des salariés.
FAQ sur la sympathie chez Adam Smith
FAQ sur la pensée morale et économique d’Adam Smith
Quelle place Adam Smith accorde-t-il aux émotions dans l’évaluation morale ?
Smith considère que les émotions ne sont pas des obstacles à la morale, mais en sont les fondements. La capacité à se représenter ce que ressent autrui permet de juger du bien-fondé de nos actes, indépendamment d’un raisonnement abstrait.
Pourquoi parle-t-on d’un « animal social » à propos de l’homme chez Smith ?
Parce que, selon Smith, les relations humaines reposent sur un besoin de reconnaissance et d’interaction morale. L’individu ne vit pas en vase clos : il cherche naturellement à être compris et approuvé par les autres.
La « main invisible » justifie-t-elle tous les comportements économiques ?
Non. Smith pense que le marché peut produire du bien commun si les individus sont modérés par des règles morales. La recherche d’intérêt personnel doit être encadrée pour éviter les excès et préserver la cohésion sociale.
Quelles critiques Adam Smith adresse-t-il à Mandeville ?
Il rejette l’idée que les vices privés suffisent à créer des vertus publiques. Pour Smith, un comportement moralement répréhensible ne peut pas être légitimé simplement par ses effets économiques bénéfiques.
Pourquoi la notion de « spectateur impartial » est-elle essentielle ?
Elle représente une forme de conscience morale intérieure. Grâce à elle, chacun peut évaluer ses actes comme s’il les observait de l’extérieur, avec un regard neutre, ce qui permet d’adopter une conduite plus juste.
En quoi la pensée d’Adam Smith est-elle encore actuelle ?
Elle permet de penser un équilibre entre initiative individuelle et exigence morale. À l’heure des crises économiques, Smith offre des clés pour articuler liberté de marché et responsabilité collective.