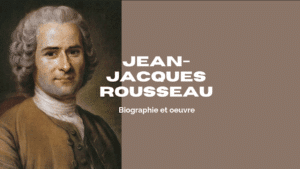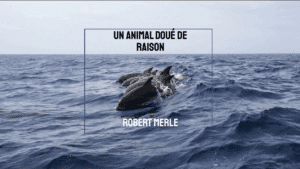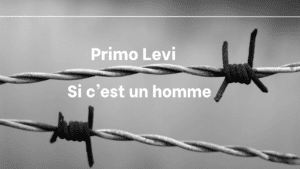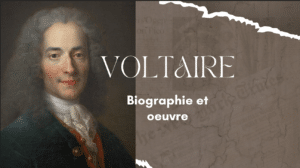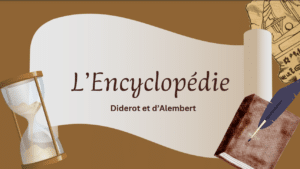La question n’est pas de savoir si Dieu existe, car on ne peut percevoir ou connaître Dieu, au sens ordinaire. Dieu, dans sa définition, n’est pas un objet de perception ou de connaissance, mais un objet d’amour et rien ne peut prétendre être Dieu s’il n’est réellement objet d’amour. Comment alors concevoir cet amour ? Autrement dit, que faut-il aimer, si Dieu n’est pas présent pour attester son existence ?
Pour la philosophe Simone Weil, cette question est primordiale, car tout homme ne peut s’empêcher de désirer, au fond de lui, le bien et la justice. Cependant, ceux-ci sont absents du monde : tout, dans le monde, est souillé par la force et par l’injustice. Le bien, qui est un des noms de Dieu, est inconnaissable, car absent du monde. En revanche, parce que tout homme désire le bien, Dieu est objet d’amour. Toutefois, cet amour a pour objet quelque chose d’inconnaissable, et d’absent du monde. Dès lors, il faut aimer Dieu implicitement, c’est-à-dire en aimant des objets du monde dans lequel Dieu est présent de manière cachée ou secrète. C’est ce que Weil montre dans l’article “Les formes de l’amour implicite de Dieu”.
Weil, qui a connu des expériences mystiques de communion avec Dieu, considère qu’aimer implicitement est un préalable à l’amour explicite de Dieu, l’amour dans lequel Dieu est l’objet même de l’amour.
Les formes implicites de l’amour de Dieu sont au nombre de quatre :
- L’amour du prochain ;
- L’amour de l’ordre du monde ;
- L’amour des cérémonies religieuses ;
- L’amitié.
L’amour du prochain
Weil part du texte de l’Évangile selon Matthieu pour définir l’amour du prochain, dans lequel Jésus dit : “Car j’ai eu faim et vous m’avez donné à manger” (25:35). Cela signifie que, lorsque l’on nourrit et sert le prochain, c’est en réalité Dieu lui-même que l’on sert. Il faut cependant préciser ce que l’on entend par un tel amour du prochain. Weil clarifie ainsi :
Les bienfaiteurs du Christ ne sont pas nommés par lui aimants ni charitables. Ils sont nommés les justes.
Il n’y a pas de différence entre la justice et la charité : être juste envers quelqu’un, c’est l’aimer, et l’aimer, c’est faire preuve de justice à son égard. Cette identification est primordiale : si on les dissocie, alors la charité risque d’ignorer la dignité du malheureux que l’on aide, et la justice de se faire sans compassion. Or, ces deux conditions sont nécessaires à l’amour du prochain : il faut à la fois compatir avec le prochain, et respecter sa dignité, sans quoi l’amour dégénère en condescendance ou en indifférence.
Cette conception de la justice s’oppose à celle de la justice naturelle, exposée par Thucydide dans l’Histoire de la guerre du Péloponnèse. Les Méliens, alliés à Sparte, reçurent un ultimatum des Athéniens : ou bien ils rejoignaient Athènes dans la guerre, ou bien leur antique cité était rasée – ce qui advint. Dans le dialogue avec les Méliens, les Athéniens tiennent ce propos sur la justice :
Tel qu’est constitué l’esprit humain, ce qui est juste est examiné seulement s’il y a nécessité égale de part et d’autre. Mais s’il y a un fort et un faible, ce qui est possible est imposé par le premier et accepté par le second.
Et :
Nous avons à l’égard des dieux la croyance, à l’égard des hommes la certitude, que toujours, par une nécessité de nature, chacun commande partout où il en a le pouvoir. Nous n’avons pas établi cette loi, nous ne sommes pas les premiers à l’appliquer ; nous l’avons trouvée établie, nous la conservons comme devant durer toujours ; et c’est pourquoi nous l’appliquons. Nous savons bien que vous aussi, comme tous les autres, une fois parvenus au même degré de puissance, vous agiriez de même.
Ces lignes sont d’une grande lucidité. Dans le monde, la justice n’existe pas : il n’y a que des rapports de force impitoyables. Cela signifie en fait que la justice, celle qui fait que le plus fort sert et aime le plus faible, est surnaturelle :
La vertu surnaturelle de justice consiste, si on est le supérieur dans le rapport inégal des forces, à se conduire exactement comme s’il y avait égalité. Exactement à tous égards, y compris les moindres détails d’accent et d’attitude, car un détail peut suffire à rejeter l’inférieur à l’état de matière qui dans cette occasion est naturellement le sien, comme le moindre choc congèle de l’eau restée liquide au-dessous de zéro degré.
Ainsi, il faut bien distinguer l’amour du prochain, qui respecte la dignité de celui qui, pauvre et malheureux, est ignoré de tous, de ce que l’on appelle habituellement “charité” :
Dieu n’est pas présent, même s’il est invoqué, là où les malheureux sont simplement une occasion de faire le bien, même s’ils sont aimés à ce titre. Car alors ils sont dans leur rôle naturel, dans leur rôle de matière, de choses.
Dans ce cas-là, il n’y a aucun amour personnel du prochain, car un tel amour implique la compassion à l’égard du prochain, c’est-à-dire de devenir soi-même malheureux, de devenir soi-même comme une chose.
Lire aussi : La morale sociale chez Bergson
L’amour de la beauté du monde
Chaque homme est au centre de l’espace et du temps, ce qu’il appelle le “présent”. Chaque homme est aussi au centre de son univers de valeurs : ce qui est bon, c’est ce qui fait du bien à nous ou à ce que nous mettons à proximité de nous : famille, amis, patrie, etc. Mais, de même que nous apprenons tôt à considérer que notre position spatio-temporelle ne reflète en rien l’espace-temps réel, nous devons aussi décentrer notre univers de valeurs. Cela implique de considérer tous les points du monde comme autant de centres. L’apprendre, à l’égard des autres hommes, c’est apprendre l’amour du prochain. L’apprendre, à l’égard de la matière, c’est apprendre l’amour de l’ordre du monde. Cela passe par un consentement à la nécessité mécanique de tous les phénomènes de la matière : nous ne sommes pas au centre de l’univers, et tout dans la nature arrive sans égard à notre intérêt. Aimer cette nécessité mécanique, c’est immédiatement ressentir la beauté du monde, qui est obéissance parfaite, via cette nécessité, aux lois de la physique.
Le monde est ainsi beau dans son intégralité. Mais aussi, chaque point de l’univers est beau pour celui qui s’est décentré. C’est la beauté qui nous charme, nous happe et nous retient :
Une chose belle ne contient aucun bien, sinon elle-même, dans sa totalité, telle qu’elle nous apparaît. Nous allons vers elle sans savoir quoi lui demander. Elle nous offre sa propre existence. Nous ne désirons pas autre chose, nous possédons cela, et pourtant nous désirons encore. Nous ignorons tout à fait quoi. Nous voudrions aller derrière la beauté, mais elle n’est que surface. Elle est comme un miroir qui nous renvoie notre propre désir du bien. Elle est un sphinx , une énigme, un mystère douloureusement irritant. Nous voudrions nous en nourrir, mais elle n’est qu’objet de regard, elle n’apparaît qu’à une certaine distance.
Lorsque l’homme est mis face à la beauté, il s’arrête, cesse de vouloir conquérir et s’agrandir. En cela, la beauté est bien une propédeutique au bien, car le bien consiste à s’abaisser, à se faire petit pour autrui. La beauté nous interpelle tandis que nous courons à travers des chimères, et nous tourne vers la seule fin valable :
C’est parce que la beauté ne contient aucune fin qu’elle constitue ici-bas l’unique finalité. Car ici-bas il n’y a pas du tout de fins. Toutes ces choses que nous prenons pour des fins sont des moyens. C’est là une vérité évidente. L’argent est un moyen d’acheter, le pouvoir est un moyen de commander. Il en est ainsi, plus ou moins visiblement, de tout ce que nous nommons des biens.
Comprenant qu’il n’y a aucune fin digne de ce nom dans le monde, nous nous tournons vers la beauté, et la beauté nous indique que la seule fin ne peut être qu’hors du monde, en Dieu, c’est-à-dire en la justice.
Tous les hommes désirent la justice, au fond d’eux, et, en cela ils recherchent la beauté, et toute beauté est analogue à la beauté du monde. En même temps, ils sont des parties d’un monde de forces et d’injustice. C’est pourquoi :
L’âme ne cherche que le contact avec la beauté du monde, ou, à un niveau plus élevé encore, avec Dieu ; mais en même temps elle le fuit. Quand l’âme fuit quelque chose, elle fuit toujours, soit l’horreur de la laideur, soit le contact avec ce qui est vraiment pur. Car tout ce qui est médiocre fuit la lumière ; et dans toutes les âmes, excepté celles qui sont proches de la perfection, il y a une grande partie médiocre.
Dans ce cas, l’âme fuit la beauté du monde tout en la recherchant des substituts, par exemple les “stupéfiants au sens littéral ou métaphorique du mot”. En dernière instance, elle ne peut être apaisée que dans la contemplation de la beauté universelle du monde.
Lire aussi : Le soulagement de l’art chez Schopenhauer
L’amour des pratiques religieuses
Cet amour est implicite, bien que le nom de Dieu y soit explicitement présent, car les pratiques religieuses ne nous mettent pas directement face à Dieu. Elles consistent en une récitation du nom de Dieu, quelle que soit leur forme : une messe, un rituel, un office, c’est toujours une récitation du nom de Dieu. Dans ce cas, leur fonction est la suivante :
La vertu des pratiques religieuses consiste dans l’efficacité du contact avec ce qui est parfaitement pur pour la destruction du mal.
En effet, le monde et nous-mêmes sommes souillés par le mal et par la force, et notre désir le plus profond est celui du bien et de la justice. Dès lors, il nous faut brûler le mal qui est en nous : c’est à cela que servent les pratiques religieuses au sens large. Mais en quoi ces pratiques sont-elles pures ?
Les choses religieuses sont pures en droit, théoriquement, par hypothèse, par définition, par convention. Ainsi leur pureté est inconditionnée.
Elles sont pures de la même manière que le cercle tracé dans le sable par un géomètre est circulaire en droit, même s’il ne l’est pas en fait : il l’est parce que le cercle tracé est l’image conventionnelle du cercle réel, et en est le substitut. De même, “l’église peut être laide, les chants faux, le prêtre corrompu et les fidèles distraits” : cela ne change rien, car les pratiques sont pures en droit, par convention. Cette convention est le fait de Dieu lui-même : on en a la preuve expérimentale lorsque l’on s’aperçoit que du mal a effectivement été brûlé. En effet, il est impossible qu’un homme brûle le mal qui est en lui par lui-même, sans le projeter sur quelque chose d’autre : il agirait comme le baron de Münchhausen, qui s’extrait de sables mouvants en se tirant lui-même par les cheveux. Autrement dit, tout effort volontaire pour brûler le mal en nous reste au même niveau de mal que nous-mêmes : il ne peut donc rien produire, si ce n’est une forme de suggestion illusoire. Le mal ne peut être brûlé que par quelque chose de pur et d’extérieur à nous :
Seule la pureté parfaite ne peut pas être souillée. Si au moment où l’âme est envahie par le mal l’attention se porte sur une chose parfaitement pure en y transférant une partie du mal, cette chose n’en est pas altérée. Elle ne renvoie pas le mal. Ainsi chaque minute d’une pareille attention détruit réellement un peu de mal.
C’est donc seulement en portant son regard, son attention sur quelque chose de pur, que ce soit le nom de Bouddha dans le bouddhisme ou l’Eucharistie dans le catholicisme, que l’homme peut brûler réellement un peu de mal qui est en lui. Toute autre tentative est illusoire, ou souille ce sur quoi on projette le mal en nous. En cela, l’amour des pratiques religieuses est un amour implicite, car son objet est quelque chose qui, selon une convention divine, est Dieu lui-même ici-bas.
C’est pourquoi le rôle de la religion doit être tout à fait restreint à cela :
Mais aussi il devrait être reconnu publiquement, officiellement, que la religion ne consiste pas en autre chose qu’en un regard.
Si la religion n’est pas centrée autour de cette fonction, elle peut devenir un objet d’idolâtrie, où l’on vénère davantage l’appartenance à un grand corps puissant et exalté que la convention qui nous permet de brûler le mal en nous.
L’amitié
L’amitié est la dernière forme de l’amour implicite de Dieu. Contrairement à la charité, elle n’est pas impersonnelle, mais élective. La première composante de l’amitié est double :
Ou l’on cherche en l’autre un certain bien, ou on a besoin de lui. D’une manière générale, tous les attachements possibles se répartissent entre ces deux espèces.
Si j’ai besoin d’autrui, alors il m’est nécessaire. Mais alors, je ne peux pas vouloir son bien à lui, car alors je renonce à mon propre bien, puisqu’autrui m’est nécessaire, et que, si je veux son bien, je veux qu’il soit libre de refuser d’assouvir mon besoin :
Là où il y a nécessité, il y a contrainte et domination. On est à la discrétion de ce dont on a besoin, à moins d’en être propriétaire. Le bien central pour tout homme est la libre disposition de soi. Ou l’on y renonce, ce qui est un crime d’idolâtrie, car on n’a le droit d’y renoncer qu’en faveur de Dieu ; ou on désire que l’être dont on a besoin en soit privé.
L’amitié est l’union surnaturelle, divine, de ces termes contraires. Dans l’amitié, à la fois j’ai besoin d’autrui et je cherche en l’autre un bien, et à la fois je désire sa liberté, c’est-à-dire son propre bien :
“L’amitié est une égalité faite d’harmonie”, disaient les pythagoriciens. Il y a harmonie parce qu’il y a unité surnaturelle entre deux contraires qui sont la nécessité et la liberté, ces deux contraires que Dieu a combinés en créant le monde et les hommes. Il y a égalité parce qu’on désire la conservation de la faculté de libre consentement en soi-même et chez l’autre.
Si la nécessité prend le pas sur la liberté, alors l’amitié disparaît. Pour cette raison, l’amitié doit toujours être réciproque. Elle ne doit pas conduire à un désir d’union, mais doit au contraire toujours ménager un espace pour l’ami. L’amitié exclut donc le désir de plaire ou de conformer ses opinions à celles d’autrui. L’amitié est ainsi un amour implicite de Dieu, car, en aimant l’ami sans pour autant le rapporter à soi-même, l’on se décentre de la même manière que dans l’amour du prochain.
Lire aussi : Le plaisir chez Épicure
Amour implicite et amour explicite
Les amours implicites sont des amours intermédiaires, indirects. Elles constituent un effort pour regarder vers le haut, sans pour autant quitter le monde et les objets d’ici-bas. Cependant, en les aimant, l’âme aime Dieu ; or, comme on l’a dit, rien n’indique que Dieu existe. Aussi :
Dans la période préparatoire l’âme aime à vide. Elle ne sait pas si quelque chose de réel répond à son amour […] L’âme sait seulement d’une manière certaine qu’elle a faim. L’important est qu’elle crie sa faim. Un enfant ne cesse pas de crier si on lui suggère que peut-être il n’y a pas de pain. Il crie quand même.
Cette période d’amour à vide est nécessaire, et correspond à la “nuit de l’âme” décrite par les mystiques. Elle s’achève avec l’expérience mystique de Dieu : l’âme reçoit le pain et le mange, et elle sait qu’il est réel. Et Weil de conclure :
Le prochain, les amis, les cérémonies religieuses, la beauté du monde ne tombent pas au rang des choses irréelles après le contact direct entre l’âme et Dieu. Au contraire, c’est alors seulement que ces choses deviennent réelles. Auparavant c’étaient des demi-rêves. Auparavant, il n’y avait aucune réalité.