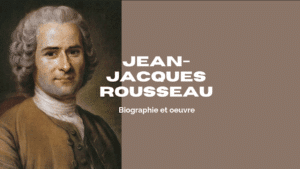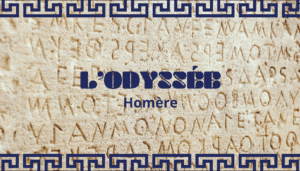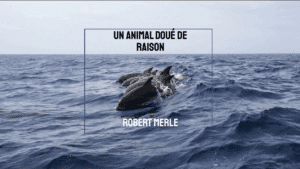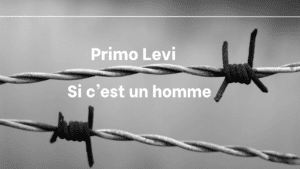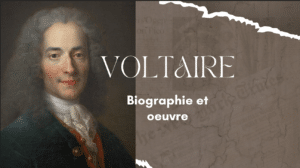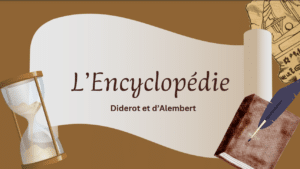Dans cet article, nous revenons avec toi sur la philosophie d’Épictète, point essentiel de ton programme de philosophie de terminale.
Plongés dans le tumulte du monde, nous n’avons pas de pouvoir sur tout ce qui nous échoit : nous sommes soumis aux aléas de la fortune, aux décisions d’autrui, aux lois de la nature. Face à une telle impuissance, nous pourrions désespérer, prendre la liberté pour une illusion, et renoncer à jamais au bonheur. Ce serait une erreur, car certaines choses restent bien dans l’orbite de notre puissance : il s’agit, pour Épictète, de tout ce qui relève de nos facultés mentales.
Cette thèse est présentée par Arrien dans les premières lignes du Manuel d’Épictète (car Épictète lui-même n’a jamais écrit). Épictète y fait la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. C’est cette thèse qui constitue le fondement de toute sa philosophie éthique, et permet à l’homme d’atteindre le bonheur.
Qui est Épictète ?
Épictète était un philosophe stoïcien d’origine grecque qui a vécu au 1er et 2e siècle après J.-C. Il est considéré comme l’un des représentants les plus influents du stoïcisme.
Né en Phrygie, une région de l’Empire romain, Épictète a été esclave pendant une partie de sa vie avant d’être affranchi. Il a ensuite étudié la philosophie stoïcienne à Rome avec le philosophe Musonius Rufus.
Épictète a développé une philosophie pratique axée sur la manière dont les individus peuvent trouver le bonheur et la sagesse dans leur vie quotidienne. Il a souligné l’importance de contrôler nos émotions, de cultiver la vertu et d’accepter ce qui est hors de notre contrôle. Selon lui, la clé du bonheur réside dans notre capacité à maîtriser nos pensées et nos réactions face aux événements extérieurs.
Épictète n’a pas écrit lui-même d’œuvres, mais ses enseignements ont été recueillis et transmis par son disciple Arrien dans un ouvrage intitulé “Entretiens” (ou “Entretiens d’Épictète”). Ce livre est une compilation des dialogues et des leçons donnés par Épictète, qui mettent en avant les principes du stoïcisme et offrent des conseils pratiques pour atteindre la sagesse et la tranquillité d’esprit.
Dans les “Entretiens”, Épictète aborde des sujets tels que la maîtrise de soi, le contrôle des émotions, la vertu, l’acceptation du destin et l’importance de vivre en accord avec la nature. Il utilise des exemples concrets et des anecdotes pour illustrer ses enseignements et encourager ses étudiants à cultiver une attitude stoïque face aux défis de la vie.
Les “Entretiens d’Épictète” sont considérés comme une source importante pour comprendre la philosophie stoïcienne et sont largement étudiés et lus aujourd’hui par les philosophes, les chercheurs et les personnes intéressées par le stoïcisme.
Ce qui dépend de nous, ce qui n’en dépend pas
La philosophie éthique d’Épictète trouve ainsi sa base dans la distinction entre ce qui dépend de nous, et ce qui ne dépend pas de nous. Cette distinction n’est pas seulement pratique (elle n’a pas seulement trait à notre action), mais elle traite de la nature même des choses :
Parmi les choses qui existent, certaines dépendent de nous, d’autres non. De nous, dépendent la pensée, l’impulsion, le désir, l’aversion, bref, tout ce en quoi c’est nous qui agissons ; ne dépendent pas de nous le corps, l’argent, la réputation, les charges publiques, tout ce en quoi ce n’est pas nous qui agissons.
La réalité est ainsi divisée en deux régions bien délimitées : d’un côté, tout ce qui relève de nos facultés mentales, de notre intériorité, est en notre libre pouvoir. De l’autre, tout ce qui n’en relève pas est absolument hors de notre pouvoir, et nous n’avons aucune certitude sur la manière dont ces choses tourneront. La pensée dépend de nous, car c’est nous qui décidons de ce que nous pensons : rien au monde ne peut me forcer à penser autre chose que ce que je pense, j’ai un contrôle absolu sur ma pensée. Il en va de même pour mon désir et mon aversion : certes, des choses dans le monde peuvent l’influencer (publicité, propagande…), mais, en dernière instance, c’est toujours moi qui décide de ce que je désire ou non. Il n’en va pas de même pour ce qui ne dépend pas de nous : je ne décide pas de la forme de mon corps, de mon âge, de ma beauté physique ; je ne décide pas de la manière dont les autres me perçoivent ou ce qu’ils pensent de moi (même si je les menace ou les achète, ils peuvent très bien continuer à me haïr en secret) ; je ne décide pas de ma place dans la société (je peux m’efforcer d’en changer, mais rien ne m’assure que j’y parviendrai : ce n’est pas moi qui décide, en dernier recours). Épictète résume cela selon le critère de l’action : dans ce qui dépend de moi, j’agis ; dans ce qui n’en dépend pas, je n’agis pas. Autrement dit, même dans les actions de mon corps, je dois admettre une certaine passivité : ce n’est pas moi qui décide en dernière instance des actions de mon corps, même si je peux tâcher de le dresser et de l’assouplir. Les actions du corps restent des obstacles pour la pensée : en cela, elles ne dépendent pas de nous, alors que la pensée, elle, est sans obstacle.
Lire aussi : Philosophie : La morale sociale chez Bergson
Liberté et bonheur
Sur cette distinction repose notre liberté : puisque ma pensée et mon désir dépendent de moi, je suis entièrement libre dans ce domaine, dans le sens où je ne suis contrarié par aucun obstacle. Le bonheur se trouve dans l’usage de cette distinction :
Donc, rappelle-toi que si tu tiens pour libre ce qui est naturellement esclave et pour un bien propre ce qui t’est étranger, tu vivras contrarié, chagriné, tourmenté […] mais si tu ne juges tien que ce qui l’est vraiment – et tout le reste étranger -, jamais personne ne saura te contraindre ni te barrer la route […]
Si je suis tourmenté par mon apparence, ma réputation, ma richesse, ou autres, il n’y a aucune chance pour que je trouve le bonheur en les recherchant malgré tout ; au contraire, il me faut les abandonner complètement, ou plutôt y être parfaitement indifférent, car ces choses ne dépendent pas de moi : si elles tournent bien, tant mieux, et si elles tournent mal, tant pis – mais rien de plus.
Lire aussi : Philosophie : Responsabilité et liberté chez Nietzsche
L’usage des représentations
Le contrôle des représentations
Le contact avec les choses qui ne dépendent pas de nous se fait par des représentations : c’est ainsi qu’elles apparaissent à l’esprit. C’est donc au niveau des représentations que s’exerce notre liberté, car la représentation est une pensée. Cependant, les représentations représentent des choses qui ne dépendent pas de nous : par exemple, la perte d’un ami. Je ne peux rien à cela. En revanche, j’ai toute liberté sur la représentation que j’en ai :
Donc, dès qu’une image ou une représentation viendra te troubler l’esprit, pense à te dire à son sujet : « Tu n’es que représentation, et non la réalité dont tu as l’apparence. » Puis, examine-la et soumets-la à l’épreuve des lois qui règlent ta vie : avant tout, vois si cette réalité dépend de nous ou n’en dépend pas ; et si elle ne dépend pas de nous, sois prêt à dire : « Cela ne me regarde pas. »
La représentation n’est pas la chose même, ce qui me permet de la contrôler librement. Parce que la représentation représente la chose, nous la prenons pour la chose et nous la laissons nous dicter son contenu, comme si nous étions passif face à elle, alors que la représentation est une pensée, quelque chose sur quoi je suis actif.
L’acceptation de la nécessité
La perte de mon ami ne dépend pas de moi : je n’ai donc pas à m’en affliger, mais, parce que cela ne dépend pas de moi, je peux décider de l’accepter. Le chapitre 8 énonce ainsi :
N’attends pas que les événements arrivent comme tu le souhaites ; décide de vouloir ce qui arrive comme cela arrive et tu seras heureux.
Il ne sert en effet à rien de s’affliger pour ce qui ne dépend pas de nous, mais au contraire il est possible de maintenir son bonheur en acceptant que ce qui ne dépend pas de nous ne dépende pas de nous, et arrive sans que nous puissions agir dessus.
Cette acceptation se fait au niveau des représentations et des jugements, aussi c’est à ce niveau que nous pouvons nous défaire de notre tourment, accepter la nécessité des choses et trouver une sérénité qui confine au bonheur. C’est ce qu’énonce Épictète au chapitre 5 :
Ce qui tourmente les hommes, ce n’est pas la réalité mais les jugements qu’ils portent sur elle.
Ainsi, grâce à cette liberté de la pensée et du désir, nous pouvons cesser de nous affliger sur ce qui ne dépend pas de nous et entrer dans la félicité.