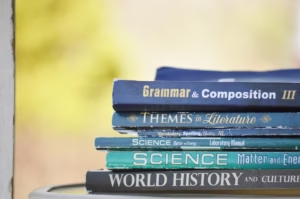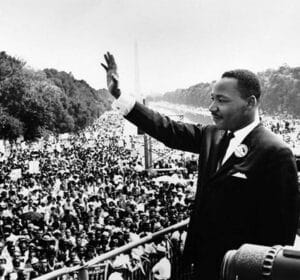Le Canada, connu pour être l’un des États les plus multiculturels du monde, possède deux langues officielles : l’anglais et le français. Pourtant, dans les faits, une grande diversité de langues y cohabitent. Dans ce pays, 20 % de la population ont une langue maternelle autre que l’anglais ou le français. Comprendre les origines, les particularités et les tensions liées à cette situation linguistique te permettra de mieux connaître le Canada !

Petite histoire du bilinguisme au Canada
La présence de deux langues officielles au Canada trouve son origine dans l’histoire coloniale du pays. En 1534, Jacques Cartier et son équipage atteignent le fleuve Saint-Laurent, qui leur permet de remonter depuis l’océan Atlantique vers ce qui deviendra le Québec. Jusqu’au milieu du XVIIIᵉ siècle, l’empire colonial français s’étend en Amérique du Nord, sous le nom de Nouvelle-France.
Parallèlement, les Anglais développent leurs treize premières colonies (symbolisées plus tard par les treize bandes du drapeau des États-Unis), du nord de la Floride jusqu’à New York. Les deux puissances s’affrontent, et la Nouvelle-France est cédée à la Grande-Bretagne en 1763, par le traité de Paris.
La relation qu’entretient alors le pouvoir colonial britannique avec les minorités francophones est particulièrement complexe, oscillant entre volonté d’assimilation et reconnaissance de leur singularité. En 1867, l’Acte de l’Amérique du Nord britannique fonde le Canada en tant qu’État fédéral, avec ses quatre provinces (à l’est), auxquelles s’ajouteront progressivement six autres.
Aujourd’hui, les interventions du Premier ministre sont souvent doublées, voire répétées, dans les deux langues officielles. Les décisions ayant une portée fédérale, les sites internet de l’administration, et même la liste des ingrédients de n’importe quel produit vendu sur le territoire devant obligatoirement être écrit dans les deux langues.
Les proportions actuelles
Aujourd’hui, l’anglais reste la langue majoritairement parlée au Canada, avec 57 % des habitants l’ayant pour langue maternelle. Le français, quant à lui, est la langue prédominante dans la province du Québec, où près de 78 % de la population sont locuteurs natifs.
D’autres langues sont également très présentes dans le pays : 12,7 % des habitants du Canada ne parlent ni l’anglais ni le français à la maison. Par exemple, Vancouver (à l’ouest du pays) abrite une importante communauté dont la langue maternelle est le mandarin.
Depuis plusieurs années, de nombreux observateurs s’alarment du recul progressif du français au Canada, y compris au Québec. Bien que cette langue conserve un statut officiel et une forte implantation dans certaines régions, les données démographiques récentes révèlent une baisse du pourcentage de francophones dans la population globale, notamment en raison de l’immigration internationale, majoritairement anglophone ou allophone, et de l’usage croissant de l’anglais dans l’espace numérique et professionnel.
Cette évolution alimente un sentiment d’inquiétude au sein de la société québécoise, où la langue française est perçue comme un pilier identitaire. En réponse, plusieurs mouvements citoyens et initiatives gouvernementales ont vu le jour. Le gouvernement du Québec a par exemple adopté la Loi 96 en 2022, renforçant la Charte de la langue française : elle impose de nouvelles obligations linguistiques aux entreprises, limite l’usage de l’anglais dans les institutions publiques et renforce l’apprentissage du français pour les nouveaux arrivants.
Des groupes comme le Mouvement Québec français militent aussi pour un usage du français plus ambitieux dans les milieux de travail et une valorisation culturelle accrue. Pour beaucoup, défendre le français au Canada ne relève pas seulement d’un enjeu linguistique, mais aussi d’une lutte pour la préservation des mémoires collectives.
Langues et identités
Les langues sont également un important vecteur d’affirmation identitaire : certaines populations se battent pour que leur langue soit reconnue et valorisée. Ainsi, en s’exprimant en français à la Chambre des communes, une députée peut par exemple réaffirmer l’importance de cette langue à l’échelle nationale.
Le Québec multiplie les politiques pour renforcer la place du français, en proposant notamment aux nouveaux arrivants souhaitant s’installer dans la province des cours intensifs. La maîtrise de la langue est en effet devenue quasi indispensable pour bon nombre de démarches administratives.
À Montréal il est courant d’entendre un « Bonjour, Hello ! » lorsque l’on rentre dans un commerce, ce qui invite chacun à s’exprimer dans la langue de son choix. Dans les régions du Québec plus éloignées des grandes villes, le français reste omniprésent, bien que les jeunes générations aient souvent tendance à s’exprimer plus aisément dans les deux langues que leurs aïeux.
Dans d’autres provinces, le français est obligatoire comme langue vivante à l’école. En pratique, de nombreux anglophones ayant effectué leur scolarité au Canada maîtrisent très bien le français, même s’ils hésitent souvent à le reconnaître ! Certaines universités proposent de même un cursus intégralement bilingue, avec la possibilité d’y suivre des cours en français et en anglais. De nombreux établissements secondaires proposent également des programmes « immersion », qui sont l’équivalent de nos classes européennes en France, pour approfondire leur apprentissage du français.
Enjeux économiques.
La présence de deux langues officielles rend les profils qualifiés et bilingues particulièrement attractifs sur le marché du travail canadien. Le Québec, en particulier, multiplie les initiatives pour attirer des ingénieurs, des techniciens et d’autres professionnels compétents maîtrisant à la fois le français et l’anglais.
Réappropriation de langues.
Comme nous l’avons vu en introduction, le bilinguisme canadien est avant tout le fruit de son histoire coloniale. En s’imposant en Amérique, les colons ont introduit leurs langues, marginalisant de facto les langues et dialectes parlés par les populations autochtones. Une remise en question de ce récit colonial a lieu dans ce pays, notamment en raison des crimes commis à l’encontre de ces populations. Dans les residential schools pare exemple, l’État canadien et l’Église ont, pendant plus d’un siècle, envoyé de force des enfants autochtones pour les assimiler, souvent dans des conditions violentes.
Valoriser les langues autochtones devient alors un moyen de reconnaître leur histoire et de leur redonner une place dans l’espace public. Par exemple, à Vancouver, certaines rues ont pour nom les appellations utilisées par les peuples autochtones avant la colonisation.