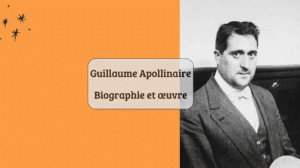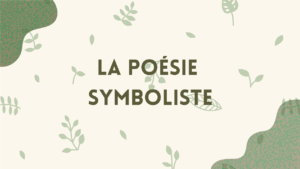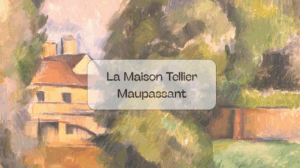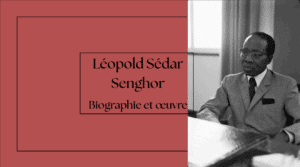L’oxymore fait partie de ses figures de style qui te disent quelque chose, mais qui paraît difficile à comprendre. Rassure-toi, l’équipe AuFutur va se concentrer sur cette figure de style grâce à des exemples concrets, une définition concise et des explications simples à comprendre.
Quelques exemples de l’oxymore
L’oxymore est une figure de style qui consiste à associer deux termes opposés ensemble. Il s’agit d’une figure d’opposition, car son effet réside dans l’association de deux termes qui ne vont pas ensemble. Voici une liste de quelques exemples de l’oxymore :
👉 « Je serai ton cercueil, aimable pestilence », Baudelaire
👉 « Cette obscure clarté qui tombe des étoiles », Corneille
👉 « C’était une merveilleuse grimace », Victor Hugo
Comme tu le remarques, les trois extraits ont un oxymore : « aimable pestilence », « obscure clarté » et « merveilleuse grimace ». Le lien entre le nom et l’adjectif renforce cette opposition, ce qui crée une image floue et troublante chez le (la) lecteur (lectrice).
Qu’est-ce qu’un oxymore ?
Petit point historique sur l’origine du mot : comme beaucoup de figures de style, on doit l’étymologie du mot oxymore au grec ancien 🇬🇷 ὀξύμωρον, oxúmôron qui signifie « ingénieuse alliance de mots contradictoires ».
Un oxymore est un procédé stylistique qui joue sur la juxtaposition de deux mots opposés. Cette opposition réside dans le lien direct entre les deux mots utilisés et dans leur sens contraire. Prenons un exemple qui illustre cette subtilité :
👉 « Un silence assourdissant », Albert Camus
L’exemple issu de La Chute d’Albert Camus illustre bien les caractéristiques de l’oxymore. Dans un premier temps, les mots « silence » et « assourdissant » sont liés grammaticalement. Dans un second temps, le sens des deux mots s’oppose, puisque le silence est l’absence de bruit, mais l’adjectif souligne une caractéristique propre au bruit. Cette association permet d’illustrer une image trouble et contradictoire : un silence qui fait du bruit, en somme.
Comment faire un oxymore ?
Pour créer un oxymore, tu dois penser à une image contradictoire. Peu importe sa nature tant que tu parviens à l’imaginer. Faisons un exemple ensemble ! Prenons l’image du feu et associons-la à un adjectif qui illustre le contraire du feu, la glace.
👉 « Le feu givré cessa de crépiter »
La figure de style permet ici de donner un exemple d’une image improbable. Pourtant, l’oxymore illustre un passage du feu qui commence à perdre ses flammes et sa chaleur, d’où l’aspect « givré ». L’image évoquée par l’oxymore reste dans l’ordre descriptif, littéraire et sensoriel.
Quelle est la différence entre une antithèse et un oxymore ?
Définition d’une antithèse
Une antithèse est une figure de style d’opposition qui consiste à associer deux termes opposés dans une même phrase. Elle est d’office très similaire à l’oxymore ; pourtant, elles ont toutes les deux une différence qui permet de ne plus les confondre.
La différence entre une antithèse et un oxymore
Afin de bien les différencier, on va te donner un exemple pour chacune de ses deux figures de style et les comparer :
Exemple d’antithèse 👉 « Un ver de terre amoureux d’une étoile », Victor Hugo, Ruy Blas
Exemple d’oxymore 👉 « Cette petite grande âme venait de s’envoler », Victor Hugo, Les Misérables
Dans l’extrait de Ruy Blas, Victor Hugo relie deux éléments dans sa phrase : « le ver de terre » et « l’étoile ». Nous avons donc une opposition entre le ciel et la terre. Pourtant, ici, les deux termes sont reliés à l’adjectif « amoureux ». Il ne s‘agit donc pas d’un oxymore.
Dans les Misérables, nous avons une juxtaposition entre les adjectifs « petite » et « grande ». Contrairement à l‘antithèse, l’oxymore a nécessairement besoin que les termes qu’il oppose soient reliés l’un à l’autre.
Quelle est la différence entre un paradoxe et un oxymore ?
Définition d’un paradoxe
Un paradoxe est une figure de style qui consiste à exprimer une idée qui va à l’encontre de l’opinion commune. L’effet de cette figure d’opposition est de créer un contresens.
La différence entre un paradoxe et un oxymore
Afin de bien différencier les deux figures de style, on va te donner un exemple pour chaque figure de style et les comparer :
Exemple de paradoxe 👉 « Le malheur m’a donné la fortune, l’ignorance m’a instruit », Balzac, La Peau de chagrin
Exemple d’oxymore 👉 « Par ma foi ! voilà un beau jeune vieillard pour quatre-vingt-dix ans », Molière, Le Malade imaginaire.
L’exemple de Balzac illustre deux contresens : « le malheur apporte le bonheur (fortune) » et « l’ignorance rend intelligent ». Ici, les termes ne sont pas collés les uns et les autres, contrairement à l’exemple de Molière.
En effet, ici, l’image du « beau jeune vieillard » amène elle aussi un contresens ; mais, cette fois-ci, c’est dû à la proximité des termes « beau », « jeune » et « vieillard » qui créent le contresens.
Quelle est la différence entre une antiphrase et un oxymore ?
Définition d’une antiphrase
Une antiphrase est une figure de style qui consiste à utiliser un mot ou une locution dans un sens contraire au sens véritable. Elle peut s’employer par ironie ou par euphémisme.
La différence entre une antiphrase et un oxymore
Afin de bien différencier les deux figures de style, on va te donner un exemple pour chacune d’entre elles et les comparer :
Exemple d’antiphrase 👉 « Vivent les collèges d’où l’on sort si habile homme ! », Molière, Le Malade imaginaire
Exemple d’oxymore 👉 « Les soleils mouillés / De ces ciels brouillés », Charles Baudelaire, L’Invitation au voyage
L’antiphrase souligne l’ironie, car tout réside dans le ton du personnage. En effet, l’antiphrase cherche à dire l’opposé de ce qui est pensé. Il ne s’agit donc pas d’un rapprochement de deux termes opposés.
Quant à l’oxymore, les termes de « soleils » et « mouillés » sont associés malgré l’impossibilité (un soleil ne peut pas être mouillé). Le vers de Baudelaire ne cherche pas à dire le contraire de ce qu’il pense, mais seulement de peindre l’image d’un ciel pluvieux et ensoleillé.
Exercice sur les oxymores
Maintenant que tu sais tout à propos des oxymores, on te propose de faire un petit exercice pour être sûr et certain que tout est nickel !
Consigne : Dans cet exercice, tu vas devoir identifier les oxymores dans les phrases suivantes et expliquer leur sens.
- Cette décision est une douloureuse joie.
- Il a un courage timide face aux défis.
- Dans cette ville, la liberté est une prison dorée.
- Sa réponse fut un calme tumulte.
- Elle lui a lancé un regard glacialement chaleureux.
- Nous avons vécu un moment d’étrange familiarité.
Ne triche pas ! 😉
Corrigé de l’exercice
- « douloureuse joie »
- Explication : « douloureuse » et « joie « sont des sentiments opposés. La juxtaposition de ces deux mots exprime un sentiment complexe, où la personne ressent à la fois de la joie et de la souffrance, peut-être une joie mêlée de regrets ou de contradictions internes.
- « courage timide »
- Explication : Le courage implique la bravoure et l’affirmation, tandis que la timidité désigne la réserve et la peur. L’oxymore suggère que cette personne, bien qu’ayant du courage, agit de manière réservée ou hésitante face aux défis.
- « prison dorée »
- Explication : Une prison est un lieu de contrainte et de restriction, tandis que « dorée » suggère quelque chose de précieux et attirant. Cette expression critique une liberté qui semble attractive en surface, mais qui, en réalité, est pleine de contraintes et de limitations
- « calme tumulte »
- Explication : Le calme est l’absence de bruit et de perturbation, tandis que le tumulte désigne une agitation bruyante. Cet oxymore met en lumière un phénomène où une réponse apparemment calme cache une agitation intérieure ou un conflit sous-jacent.
- « regard glacialement chaleureux »
- Explication : « Glacialement » évoque la froideur et la distance, tandis que « chaleureux » implique de la chaleur et de la convivialité. Cet oxymore décrit un regard qui semble à la fois froid et accueillant, suggérant peut-être une attitude contradictoire ou ironique.
- « étrange familiarité »
- Explication : « Familiarité » implique une relation proche et intime, tandis que « étrange » suggère quelque chose de déconcertant ou inhabituel. L’oxymore suggère que la relation était à la fois familière, mais avec un aspect perturbant ou inhabituel.