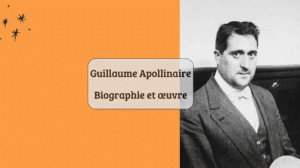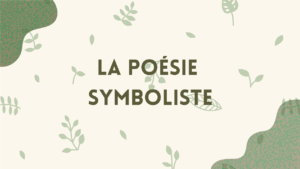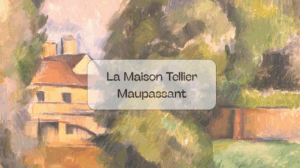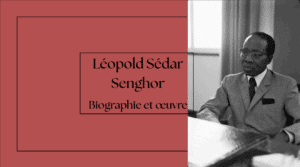Dans le cadre de tes révisions pour le bac de français 2024, nous te proposons dans cet article un résumé de l’œuvre de Francis Ponge, intitulée La Rage de l’expression. De quoi faire le point sur tes connaissances à l’approche de l’épreuve écrite. Si tu te sens déjà à l’aise avec cette œuvre, rendez-vous ici pour lire notre analyse détaillée.
Découvre notre
Guide du Bac de français 2024
Ce guide va booster tes révisions pour le bac de français qui approche ! 📚
Au programme, un rappel des dates importantes, des modalités de l’examen, des conseils et, surtout, une analyse pour chacune des œuvres au programme de cette année 🚀
Composition du recueil poétique La Rage de l’expression
La Rage de l’expression est un recueil de poèmes en prose composé en 1952 qui contient 7 sections différentes. À travers ces poèmes, son auteur explique sa démarche et ce vers quoi il tend. Ainsi, il souhaite « En revenir toujours à l’objet lui-même, à ce qu’il a de brut, de différent », comme il l’explique dans « Berges de la Loire ». Pour lui, les objets qu’il étudie sont donc à considérer comme un matériau brut, central, avant qu’il ne soit traité verbalement et/ou poétiquement.
Première section
Dans « Berge de la Loire », première section de ce recueil, Francis Ponge pose le principe qui va guider et déterminer son écriture. Il s’agit d’« une rectification continuelle de [s]on expression […] en faveur de l’objet brut ». Le poète est donc au service de l’objet de non de la forme ou de la beauté des phrases. Dans ce qui peut être considéré comme son manifeste poétique, Ponge expose son objectif, celui de mettre son regard, ses émotions et son écriture au service de l’objet.
Deuxième section
Dans « La Guêpe », Francis Ponge réalise une description humoristique et scientifique de l’insecte. Ce dernier essaie d’approcher son objet par de nombreuses analogies, en présentant l’insecte comme une « danseuse » , un « brasier pétillant » , une « balle de fusil » , ou encore une « forme musicale » .
Troisième section
« Notes prises pour un oiseau » est la troisième partie du recueil, dans laquelle Ponge entend résumer tous les éléments communs à l’ensemble de cette catégorie animale. Seule cette partie peut être considérée comme présentant une écriture davantage traditionnelle que les autres poèmes, visible par l’alternance de décasyllabes (vers contenant dix syllabes) et d’alexandrins (vers à douze syllabes).
Quatrième et cinquième sections
Dans « L’œillet » et « Le Mimosa », Francis Ponge s’efforce d’aboutir à l’évocation la plus juste possible de chacune de ces deux plantes. Ce sont donc des descriptions aussi précises que fidèles de ces deux fleurs, qui correspondent à l’aboutissement du projet poétique de Ponge.
Sixième section
Dans « Le Carnet du bois de pin », il cherche à saisir les caractéristiques du bois de pins. Il s’agit de la recherche de ce qui fait l’essence (sans jeu de mots) du bois de pin, en tenant compte de sa complexité. Il utilise souvent le signe de l’accolade ({ }) pour montrer la multiplicité des expressions possibles. À la fin de la section, il relit et commente ses notes avec une sévérité impitoyable jusqu’à conclure : « Tout cela n’est pas sérieux. »
Septième section
Enfin, dans « La Mounine », Ponge tente de rendre compte d’un ciel de Provence – au lieu-dit « La Mounine », entre Marseille et Aix, un matin d’avril – qui provoqua chez lui une émotion profonde. Francis Ponge réfléchit au sens de son écriture : pour lui, sa démarche est proche de celle d’un scientifique. Il ne se considère pas poète, mais savant.
C’est la fin de cette fiche résumant succinctement et section par section le recueil de poèmes en prose de Francis Ponge. N’hésite pas à consulter nos autres articles pour compléter tes révisions !