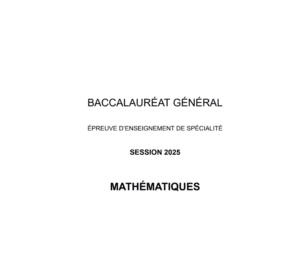Mercredi 11 mai 2022 a marqué pour plus de 500 000 élèves de terminale le début des épreuves de spécialité du baccalauréat 2022. Lors de cette session, vous avez été très nombreux à composer en HLP (humanités, littératures et philosophie). Nous partageons donc avec toi une proposition de corrigé pour cette épreuve de spécialité HLP.
Comment se passe l’épreuve de spécialité HLP ?
L’épreuve de spécialité HLP dure 4 heures, tout comme la plupart des autres épreuves de spécialité. Ces 4 heures peuvent te paraître très longues, mais une fois lancé(e) dans la rédaction, le temps passe beaucoup plus vite qu’on ne le pense.
Le jour de l’examen, l’épreuve est composée de deux parties :
- Une interprétation littéraire ou une interprétation philosophique ;
- Un essai littéraire ou un essai philosophique.
Si tu fais le choix d’une interprétation littéraire, alors tu choisiras ensuite l’essai philosophique et inversement. Le but étant de réaliser un exercice en philosophie et un exercice en littérature.
À l’issue de cette épreuve, tu obtiendras une note sur 20 points.
Les corrigés des sujets de HLP du mercredi 11 et jeudi 12 mai du bac 2022
Télécharge notre corrigé complet des épreuves de spécialité HLP du mercredi 11 et jeudi 12 mai 2022. Notre rédacteur expert a traité l’intégralité des sujets.
Comment y accéder ? Rien de plus simple, tout se passe juste ici 🔽
Notre corrigé de l'épreuve de HLP
du BAC 2022 👀
Jette un œil à notre corrigé complet des deux épreuves de spécialité HLP des mercredi 11 et jeudi 12 mai 2022 🤓