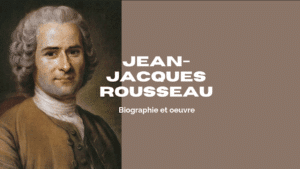Bac 2023. Découvre le corrigé du sujet de l’épreuve de philosophie tombé le mercredi 14 juin 2023. Que ce soit pour vérifier tes connaissances ou par simple curiosité, nous avons tous une bonne raison de consulter ce corrigé.
L’épreuve de philosophie s’est déroulée le mercredi 14 juin 2023, pour les quelque 536 000 candidats de France métropolitaine.
À quoi servent les corrigés d’épreuves ?
Les corrigés d’épreuves peuvent être utiles dans deux cas : si tu viens de passer ton bac de philo ou si tu révises pour passer ton bac de philo.
Regarder les corrigés après avoir passé une épreuve présente plusieurs avantages significatifs. Cela permet de comparer tes réponses avec celles attendues par les correcteurs. Cela aide à identifier les erreurs factuelles, les fautes de raisonnement ou les incompréhensions des consignes. Le fait de savoir ce que tu as bien fait ou mal fait offre un feedback immédiat. Connaître les réponses correctes et comprendre tes erreurs peut réduire l’incertitude et l’anxiété liées aux résultats. Cela permet d’aborder les prochaines épreuves avec plus de confiance.
Si tu passes bientôt ton bac de philo. En étudiant les corrigés, tu pourras mieux comprendre ce que les examinateurs attendent au moment de l’examen final, notamment en termes de structure, d’argumentation et de profondeur des réponses. En revisitant les sujets abordés, tu renforces tes connaissances et fixe mieux les informations dans ta mémoire. Comprendre tes erreurs et les corriger est crucial pour éviter de les répéter dans les futures évaluations. Cela améliorera progressivement tes compétences et ta capacité à performer. Les corrigés peuvent offrir une explication plus claire ou différente des notions traitées, facilitant ainsi ta compréhension.
Bac 2023 : le sujet de l’épreuve de philosophie
Cette année, les élèves en classe de terminale générale se sont penchés sur l’un des trois sujets suivants :
- Le bonheur est-il une affaire de raison ?
- Vouloir la paix, est-ce vouloir la justice ?
- Une explication de texte sur La Pensée sauvage, de Levi-Strauss.
Bac 2023 : le corrigé de l’épreuve de philosophie
Le corrigé du sujet 1 : Le bonheur est-il affaire de raison ?
La mort d’Emma à la fin de Madame Bovary nous apprend à nous méfier de l’imagination : condamnant notre bonheur, elle doit donner place à la raison, qui elle seule nous montre le chemin à suivre. Mais le bonheur est-il affaire de raison ?
Il peut sembler évident que la raison, faculté de penser proprement humaine, soit ce qui nous guide vers le bonheur : si l’on veut atteindre cet état de satisfaction durable, alors il faut prendre de bonnes décisions, prévoir notre avenir, bref, réfléchir à la direction que nous voulons donner à notre existence. Pourtant, le bonheur consiste aussi en petits plaisirs, en des joies quotidiennes qui dépassent le domaine seul de la raison, et font place à d’autres facultés, comme l’imagination ou la sensibilité. On peut par ailleurs rater le bonheur à force de trop y penser : spontané, il ne se donne pas comme la résolution d’une équation, et trop rationaliser le bonheur peut donc être davantage un obstacle à son accomplissement qu’une véritable aide. Somme toute, la raison doit-elle nous guider vers le bonheur, ou faut-il au contraire la faire taire pour embrasser la spontanéité de la joie ?
Si la raison peut bien sûr nous diriger vers le bonheur, évitant que le sujet erre indéfiniment par des chemins néfastes, d’autres facultés rentrent en jeu bien différentes de la raison : elle s’avère alors insuffisante pour atteindre le bonheur, voire contraire à sa nature spontanée et imprévisible. La raison doit donc repenser son propre rôle dans le chemin vers le bonheur, qui doit se faire raisonnable plutôt que rationnel.
Il semble évident, au premier regard, que la raison constitue une aide cruciale pour atteindre le bonheur : tempérant nos désirs et nous montrant la route à suivre, elle est un guide inestimable vers l’épanouissement.
Le bonheur s’oppose en effet aux simples plaisirs : durable, il ne s’efface pas lorsque l’objet convoité disparaît ; il doit donc, pour exister, pouvoir subsister. Or, la raison n’est-elle pas le meilleur moyen pour atteindre cet état durable dans le temps ? En effet, elle est ce qui dirige le corps, comme un souverain dirige une cité : donnant le cap, indiquant les meilleurs choix, elle évite le naufrage d’une situation dans laquelle nous sommes sujets à des désirs momentanés, mais néfastes, contraires au bonheur, puisque la satisfaction qu’ils octroient disparaît en même temps qu’eux. C’est ainsi que Platon nous met en garde face aux dangers du désir dans le Gorgias : la satisfaction s’oppose bel et bien au bonheur, puisque comme le tonneau des Danaïdes, elle doit être constamment remplie. C’est donc une “vie terrible” que celle que veut mener Calliclès, satisfaisant ses désirs sans cesse : déréglé plutôt que tempérant, il ressemble davantage à un pluvier qu’à un humain là où il n’use pas de sa raison pour déterminer les meilleurs choix qui le guideraient vers la plénitude. La raison est donc ce qui nous différencie des animaux et nous octroie la possibilité d’une vie heureuse, d’une situation où l’on ne se contente pas de satisfaire nos désirs indéfiniment, coûte que coûte, pour n’être heureux que par intermittence : comme un souverain bon guide son peuple, elle mène vers un véritable bonheur durable. Le bonheur est donc bien une affaire de raison, outil clef pour l’atteindre.
Cela ne signifie pas pour autant qu’il faille absolument rejeter nos désirs : un état de joie durable ne saurait être atteint avec une telle restriction. Nos désirs ne sont en réalité pas contraires à la raison ; celle-ci doit simplement nous aider à les trier, à différencier entre ceux que l’on doit garder et ceux qu’il nous faut taire. La raison nous aide ainsi à voir que “le plaisir est le commencement et la fin de la vie heureuse”, comme l’écrit Épicure dans sa Lettre à Ménécée : nous donnant le critère pour différencier entre nos désirs naturels et nos désirs vains, elle s’allie à la faculté de désirer pour nous mener vers le bonheur. Le bonheur est donc affaire de raison, mais d’une raison bien comprise : un mode de vie raisonnable donne la clef pour éviter tout “trouble de l’âme” et ainsi atteindre l’ataraxie, la véritable vie heureuse.
C’est donc dire que la raison est un véritable guide pour celui qui aspire au bonheur : jouant le rôle de phare, elle éclaire le sujet et lui montre le droit chemin, non pas vers le bien (la morale), mais vers le bon (le bonheur). Ainsi Descartes donne ses Règles pour la direction de l’esprit : directive, l’intelligence nous oriente et indique à la volonté, sa faculté voisine, les bons choix qu’elle doit faire pour nous rendre heureux. La raison, entendue ici comme intelligence, doit donc “montrer à la volonté le parti qu’elle doit prendre dans chaque situation de la vie”, comme l’écrit Descartes, pour éviter que le sujet erre, ballotté entre plusieurs choix. Triant, élaguant, aidant à choisir, la raison est donc la clef pour atteindre un bonheur durable.
Le bonheur, puisqu’il doit rester dans le temps, est donc, dans une certaine mesure, affaire de raison : celle-ci est un outil pour diriger le sujet vers ce qui peut l’épanouir. Pourtant, il semble difficile d’envisager un bonheur purement rationnel : nous ne sommes pas des machines, n’avons pas, parfois, besoin d’écouter seuls nos désirs et nos affects pour atteindre le bonheur ? ne dit-on pas, lorsqu’on doit prendre une décision importante, qu’il faut écouter son cœur ? Autrement dit, la raison n’est-elle pas, parfois, contraire à l’atteinte du bonheur ?
Le bonheur ne semble donc pas être un simple objectif rationnel : s’il est en partie affaire de raison, celle-ci est nécessaire à l’obtention du bonheur, mais pas suffisante.
À trop rationaliser le bonheur, on risque effectivement de le rater : un café pris le matin dans un jardin, un coucher de soleil contemplé une soirée d’été, un bon moment passé avec quelqu’un qu’on aime – ce sont tous des moments où la raison connaît une pause, et où d’autres facultés prennent le relais, nous offrant néanmoins des moments de bonheur certains. La raison ne suffit donc pas à atteindre le bonheur : d’autres facultés doivent être convoquées, sans quoi l’existence n’est qu’une vie morte, car trop ancrée dans une rationalité excessive qui paralyse le sujet et l’éloigne d’une vie véritablement vécue. Ne faire du bonheur qu’une affaire de raison, c’est donc se condamner à ne jamais le connaître : Nietzsche parle ainsi, dans le Gai savoir, d’une telle existence obsédée par la raison, qui perd alors la spontanéité du rapport au monde et donc ses possibilités de nous rendre heureux. En effet, il nous faut “retrouver la nature nouvellement délivrée” du joug de la rationalisation du monde pour la saisir comme elle est, imprévisible. C’est cette imprévisibilité qui mène vers le bonheur, puisqu’avec elle viennent les instants heureux ; le monde ne doit donc pas être purement rationnel, c’est-à-dire rationalisé par le sujet, mais au contraire, le bonheur ne s’atteint qu’à mettre la raison de côté. Une vie dont l’affaire ne serait que la raison est donc une vie amoindrie, affaiblie, qui n’atteint pas sa pleine puissance d’épanouissement, et donc de bonheur.
Il faut donc convoquer d’autres facultés que la raison pour atteindre le bonheur : l’émerveillement, l’imagination, la reconnaissance de la beauté, sont autant d’éléments qui peuvent nous rendre heureux. Le bonheur n’est en effet pas seulement un état de joie prolongé, mais se loge également dans des instants diffus, qu’il faut saisir ; or, cette saisie peut non seulement ne pas appeler la raison, mais également être obstruée par celle-ci. Il faut donc saisir l’existence par un prisme non rationalisant pour goûter toutes les “nourritures terrestres” qu’elle a à nous offrir, pour reprendre le mot de Gide. Ainsi Bergson condamne-t-il la rationalisation extrême du monde dans L’Énergie spirituelle, défendant la création et la nouveauté comme vectrices de bonheur face à une raison qui stabilise trop l’existence. C’est ainsi que le bonheur est aussi joie : il se compose de moments précis, qu’une raison trop présente rate.
On peut donc avancer que le bonheur n’est pas seulement une affaire de raison ; plus encore, celle-ci risque parfois, si elle nous guide, de ne pas nous orienter vers le bon chemin. Si la raison peut en effet nous montrer ce qui est moral, le bonheur n’est-il pas ailleurs, ne transcende-t-il pas la légifération du juste ? Ainsi Kant, dans la Métaphysique des mœurs, pense la raison comme insuffisante pour atteindre le bonheur ; ou plus précisément, elle peut nous y orienter, mais sans jamais nous assurer avec certitude que le chemin emprunté est le bon. Le bonheur est en effet “un idéal non pas de la raison, mais de l’imagination”, puisqu’il n’y a pas de science du bonheur : je ne peux déterminer avec certitude ce qui me rendra heureux ; ce que je désirais (la gloire, la connaissance, la richesse) peut tout à fait me rendre malheureux, sans que je puisse le prédire. La raison est donc somme toute insuffisante, “le problème de déterminer de manière sûre et universelle quelle action favoriserait le bonheur d’un être raisonnable [étant] totalement insoluble”. Le bonheur n’est donc pas vraiment une affaire de raison : bien plutôt, il nécessite que la raison elle-même constate ses propres limites.
La raison doit somme toute, pour nous guider vers le bonheur, raisonner à propos d’elle-même : plutôt que de toujours représenter ce qui doit légiférer notre existence pour que celle-ci soit épanouie, la raison, en un mouvement réflexif, doit prendre compte de ses propres limites pour permettre le bonheur.
La raison ne suffisant en effet pas à atteindre le bonheur, celui-ci est donc certes, une affaire de raison, mais une raison bien comprise, qui ne cherche pas à prendre le monopole de l’existence du sujet, mais bien plutôt, le guide raisonnablement. Le bonheur est donc somme toute davantage guidé par ce qui est raisonnable que par ce qui est rationnel : qu’est-il raisonnable de faire compte tenu de mes facultés ? Quel bonheur convoiter avec les moyens que j’ai ? Telles sont les questions que la raison doit poser ; mais ce n’est pas à elle de nous offrir le bonheur, puisqu’elle ne le peut pas. Ainsi Spinoza, dans la Lettre à Schuller, incite le lecteur à un peu d’humilité ; malgré le fait que l’Homme détienne la raison, il n’est finalement pas si différent d’une pierre poussée par le vent, là où il est lui-même poussé par les lois qui le déterminent. La raison est alors non pas ce qui nous rend surpuissants, mais ce qui sert à comprendre ces lois : or, celui qui connaît ce qui le détermine peut alors mieux agir, et à défaut de subvertir la nécessité, l’utiliser pour être heureux. La raison est donc utile pour atteindre le bonheur à condition de la questionner d’abord et d’en montrer les limites : elle ne peut changer le monde et les déterminations qu’il nous impose, mais elle peut nous faire voir celles-ci.
Loin d’être surpuissante, la raison doit donc se faire réflexive ; ce n’est ainsi que l’on devient raisonnables, et qu’on atteint le bonheur. Cette raisonnabilité propre à la raison, ce versant oublié qui n’est pas celui du calcul, mais de la tempérance, doit être le premier pas : nul ne sert de convoiter le bonheur si on le cherche au sein d’un monde dont nous avons mal compris l’influence qu’il a sur nous, et la grandeur qu’il détient. On ne peut en effet “qu’accéder à une infime partie de la nature”, comme le rappelle Pascal dans ses Pensées : il faut donc apprendre à “estimer”, à aimer cette “infime partie”, sans quoi toute recherche du bonheur est vaine. Le bonheur ne s’atteint donc que lorsque “l’homme rev[ient] à soi”, c’est-à-dire à sa condition sensible, sans s’emprisonner dans la recherche d’une vie contemplative où la plénitude s’atteindrait par un excès de rationalisme.
Faire du bonheur une affaire de raison, c’est donc, finalement, oublier à la fois que la raison n’est pas surpuissante, et que le bonheur ne se compose pas uniquement d’éléments rationnels ou rationnalisables. Le bonheur ne s’atteint qu’à comprendre la véritable portée de la raison, sa puissance ; “tout le reste n’est qu’esclavage, illusion, prestige”, déclare Rousseau dans l’Emile. L’âme ne peut rester “paisible”, emprunter “la route du vrai bonheur”, qu’à ne pas devenir esclave d’elle-même : souveraine, la raison doit cependant toujours s’interroger sur ses propres capacités, au risque de tomber, sinon, dans une tyrannie sur le corps. Il faut “mettre en égalité parfaite la puissance et la volonté”, mettre la raison au même niveau que les autres facultés, et apprendre, donc, à équilibrer les facultés qui nous animent : sans quoi le bonheur n’est qu’illusion, affaire de raison certes, mais une raison qui ne questionne pas les raisons mêmes de son action.
Le bonheur n’est donc affaire de raison qu’à condition qu’elle se fasse raisonnabilité et non-rationalité pure : ainsi seulement peut-elle composer avec l’imagination, la volonté, les désirs et les plaisirs qui montrent que le bonheur n’est pas seulement un horizon, un état durable et donc parfois inaccessible, mais aussi et peut être surtout une opportunité de chaque instant. La raison doit se faire maligne et non seulement calculatrice : elle doit saisir ses propres limites pour éviter de faire fausse route sur le chemin du bonheur. La philosophie, comme amour de la raison, mais aussi rapport critique à celle-ci, semble donc être le meilleur moyen d’atteindre le bonheur.
Lire aussi : Bac 2022 : corrigé du sujet de philosophie (voie générale)
Le corrigé du sujet 2 : Vouloir la paix, est-ce vouloir la justice ?
Le célèbre cliché de Nick Ut, “La petite fille au napalm”, nous met face à une évidence : l’horreur de la guerre doit toujours cesser, l’injustice de la violence infligée à ses victimes – ici poussée à son paroxysme par la représentation d’enfants – étant inconcevable, et, de toute évidence, moralement condamnable. C’est donc qu’un état de guerre, un conflit dont aucune autre résolution n’est envisageable que la violence, ne peut, semble-t-il, être juste ; seule la paix serait souhaitable, légitime et envisageable sur le long terme. Mais vouloir la paix, est-ce nécessairement vouloir la justice ?
La paix désignant un état durable d’entente et d’absence de conflits entre deux partis, elle semble moralement préférable : il s’agit même d’une question de conservation de la vie, puisque vouloir la paix, c’est vouloir vivre dans de meilleures conditions, mais aussi et surtout survivre. Il peut donc paraître censé de penser la paix comme une forme éminente de justice : de quel droit pourrions-nous souhaiter à un peuple de subir un état de guerre ? Pourtant, les causes d’une guerre proviennent, par définition, d’un désaccord ; et qui dit désaccord dit différend, c’est-à-dire conflit entre deux visions de la justice. Envahir un territoire, par exemple, peut sembler juste pour un peuple qui le revendique, mais injuste pour celui qui l’occupe ; vouloir la guerre pour défendre son territoire ou son peuple peut alors être considéré comme une forme de justice.
Il apparaît donc que la guerre comme la paix puissent être justifiées, ou plutôt, expliquées par l’idée de juste. Pourtant, le droit de la guerre légifère lui-même ce que le juste doit être au sein d’un conflit ; ainsi la guerre peut-elle ne pas être légitime, mais elle peut être légale. Le perspectivisme ne nous avance donc guère : une paix forcée, un accord desservant certains pays, peut sembler encore plus injuste qu’une guerre. Autrement dit, désirer un état de paix est-il nécessairement légitime, ou ne faut-il pas, parfois, préférer le conflit voire la guerre ?
La guerre peut être conçue comme une forme de légitime défense : vouloir la guerre, c’est donc vouloir se faire justice, et l’option de la paix empêche alors à chaque parti de défendre ses intérêts. Pourtant, la paix, en tant qu’état durable de calme et donc de protection, semble être l’option la plus juste pour ce qui donne à la vie une valeur suprême. Il faut donc repenser la paix de sorte qu’elle soit non seulement juste, mais le lieu de la justice : qu’elle permette, en son sein même, la résolution de conflits à venir, ce qui est le propre d’une cité juste.
I. Vouloir la guerre, c’est vouloir se faire justice : la guerre comme légitime défense
Il serait irréaliste de penser que chaque guerre est injuste : si ses causalités ne sont jamais justifiables, ses causes, elles, peuvent venir d’une volonté de justice. Plus encore, la guerre est parfois la conséquence même du droit, et donc de la justice : la violation du droit international, par exemple l’annexion d’un territoire, rend d’emblée légitime une intervention armée, comme ce fut le cas, par exemple, lors de l’annexion de la Pologne par l’armée du IIIe Reich en 1939, ou celle de quatre régions de l’Ukraine par la Russie à l’automne 2022. Si l’on ne peut donc encore affirmer, à ce stade, que vouloir la paix, c’est vouloir la justice, on peut cependant dire que vouloir la justice implique de respecter la paix.
Alors pourquoi la guerre semble-t-elle, parfois, le juste moyen ? Par définition, une guerre n’arrive qu’en dernière instance : elle est l’ultime ressort auquel ont recours les États qui n’ont pas pu, par d’autres moyens, arriver à la fin qui leur paraît juste. Ainsi la guerre est-elle juste aux yeux de ceux qui la perpétuent ; elle contient donc une forme de justice, là où elle suit les intérêts de ses acteurs. C’est ainsi que Hobbes explique (sans pour autant justifier), dans le Léviathan, la “guerre de tous contre tous” qui a lieu à l’état de nature : si chacun a la même force et la même intelligence, chacun étant doté de raison, alors chacun dispose des mêmes moyens pour défendre ses intérêts (sa parcelle de terrain, ses possessions) ; dès lors, la guerre n’a rien d’injuste ; elle est simplement la conséquence logique d’un conflit d’intérêts. Par suite, de même, une guerre entre États démontre peut-être moins une forme d’injustice que la volonté de chaque parti de défendre ses intérêts : il est alors difficile de parler d’injustice.
Vouloir la guerre, c’est vouloir se faire justice : c’est vouloir faire primer ses intérêts au-dessus de ceux de l’adversaire, si les deux sont incompatibles. Peut-être faut-il donc attribuer le qualificatif d’injuste non pas à la guerre, mais à cette volonté de faire primer ses intérêts personnels.
II. Vouloir la paix, c’est vouloir défendre la vie à tout prix : c’est donc vouloir une forme de justice
Cela permet alors de rendre légitime la volonté de paix : si le juste est l’égalité de droits entre chacun, alors chacun a le droit de survivre ; dès lors, la paix est l’option la plus juste, puisqu’elle maximise les chances de survivre.
Or, si “les animaux”, selon Voltaire, “sont [tous] en guerre les uns contre les autres” par survie, l’Homme, lui, cherche à vivre plutôt qu’à survivre ; la spécificité de l’Homme est donc d’établir un système du droit pour permettre à tout un chacun de vivre dans la paix. Vouloir la paix, c’est donc non seulement vouloir la justice pour tous, mais vouloir respecter l’humanité en chacun ; d’où l’institution de l’État Léviathan chez Hobbes, paroxysme de la raison humaine et garant de la sécurité de tous. La “guerre de tous contre tous” est donc une justice animale, biologique ; vouloir la paix, c’est s’affranchir de cette condition animale pour s’approcher d’une idée de justice proprement humaine.
III. Vouloir la paix, c’est s’en prévenir par la justice
L’Homme doit donc former une organisation capable de se prévenir de cette “guerre de tous contre tous” et de ce retour à l’animalité. La forme politique de la cité est donc la suite logique d’une volonté de paix : il n’y a en effet pas de paix durable sans instance pour la faire respecter, les intérêts des uns pouvant toujours entrer en conflit avec ceux des autres. Cela est le cas au sein d’un même État (guerre civile) comme entre États ; or, nous avons bien vu que cela n’a rien d’injuste, mais n’est que la suite logique de l’existence d’une communauté des hommes, et donc d’intérêts divergents.
Cette communauté doit donc se prémunir d’une telle guerre, et inscrire des limites que le peuple, pris en un tout, n’a pas intérêt à franchir. D’où le mot de Clausewitz, selon lequel “la guerre est la continuation de la politique par d’autres moyens” ; autrement dit, la politique, comme organisation de la cité, doit user des moyens nécessaires pour se prémunir de la guerre. D’où l’utilisation de ce que Weber, dans le Savant et le politique, nomme “la violence légitime” de l’État, qui en a “le monopole” : cette violence est légitime, c’est-à-dire juste aux yeux de l’État, parce qu’elle vise à protéger le peuple d’une violence plus grande. Vouloir la paix, c’est donc peut-être, finalement, accepter une forme de violence juste.
Conclusion
Est-ce à dire que vouloir la paix nécessite d’accepter toutes ses conditions ? N’est-ce pas sombrer dans le risque du totalitarisme ? Ne peut-on pas penser à un état de paix qui soit juste sans pour autant être contraignant ? Si vouloir la paix, c’est s’en prévenir par la justice, cette justice doit elle-même adopter une forme légitime – et il faut rappeler qu’une justice exercée par le moyen légal (le droit positif) n’est pas pour autant légitime. Ainsi faut-il exercer, comme l’avançait Arendt, l’activité essentielle de l’Homme, c’est-à-dire la discussion politique : seul un échange équitable, institué et accepté permet l’existence d’un système politique qui se prévient de la guerre. Il faut donc moins chercher à justifier la guerre au détriment de la paix qu’à s’en prémunir coûte que coûte, à la racine de l’organisation politique.
Lire aussi : Philosophie : Justice distributive et commutative chez Aristote
Le corrigé du sujet 3
Que les outils du bricoleur ne soient jamais assignés à un projet particulier condamne-t-il leur utilité ou au contraire la renforce-t-il ? C’est la question posée par Lévi-Strauss dans cet extrait de La Pensée sauvage, ouvrage paru en 1962 : différenciant le bricoleur de l’ingénieur, il interroge et caractérise l’”univers instrumental” du premier pour mettre en exergue la particularité de son activité, c’est-à-dire de son rapport à la technique.
Il s’agit en effet, dans ce texte, d’interroger le mode d’utilisation particulier de l’outil technique dans le cas du bricoleur. Contrairement à l’ingénieur, il ne possède pas de projet particulier ; c’est dire que le bricoleur n’est pas dirigé par un dessein connu à l’avance. Il ne s’agit donc pas d’une projection dans l’avenir d’une tâche déterminée. Comment expliquer alors l’efficacité de ses outils ? Il s’agit ici de dévoiler le rapport particulier du bricoleur à ses outils pour mettre en exergue, par la suite, le rapport particulier de ces outils à la production technique, qu’ils permettent d’être multiforme malgré leur absence de projet.
- Si le bricoleur et l’ingénieur utilisent tous les deux des outils, la manière qu’a le bricoleur de procéder est bien différente (début jusqu’à “hétéroclites au surplus”)
Lévi-Strauss commence par différencier le bricoleur et l’ingénieur, pour, d’emblée, placer l’extrait sous le signe du rapport à la technique. Cette utilisation de la technique est analysée par le prisme du travail, dont la forme diffère entre les deux.
En effet, si le travail de l’ingénieur se caractérise par l’utilisation de matières premières au sein d’un projet précis (l’ingénieur doit construire tel engin pour répondre à telle demande), celui du bricoleur n’a pas un tel dessein : il semble donc s’inscrire, selon l’auteur, dans un contexte sans particularité. La fin de la manipulation du bricoleur ne définit donc pas l’outil qu’il utilise ; au contraire, c’est bien plutôt avec les outils, ses “moyens de bord”, qu’il tente d’atteindre une fin donnée après l’obtention des dits outils, là où l’ingénieur acquiert ce dont il a besoin en fonction du but à atteindre.
Dès lors, les instruments du bricoleur n’ont d’instrumental que le nom : il ne s’adapte pas à un impératif. Lévi-Strauss va jusqu’à dire que cet ‘ensemble’ d’outils est “fini”, c’est-à-dire qu’il ne s’adapte pas à la mission du bricoleur : il n’y a donc pas de prolifération de moyens techniques, mais une base durable dont les utilisations seules varient.
De là à dire que l’impératif s’adapte à lui, il n’y a qu’un pas ; mais il faut rappeler que si l’outil du bricoleur a une existence préalable à l’objet technique à transformer, cet objet, pour autant, reste légiférant en tant qu’il représente un certain problème à régler par la technique. Comment Lévi-Strauss peut-il donc affirmer, d’une part, que “l’univers instrumental [du bricoleur] est clos”, comme s’il n’y avait aucun lien entre ses outils et l’utilisation sur l’objet particulier, et d’autre part, que l’objet à transformer ne constitue pas un projet ?
- En effet, la manière dont le bricoleur utilise ses outils n’est pas subordonnée à une finalité particulière : la notion de projet ne compte pas (“parce que la composition … ça peut toujours servir”)
Il faut ici noter que l’auteur ne parle pas d’une absence totale de projet pour le bricoleur, mais d’une absence de “rapport avec le projet du moment”. La notion de particularité du projet est cruciale : ici, Lévi-Strauss entend par particularité du projet la singularité d’un besoin qui serait souveraine sur l’utilisation des outils à disposition. Or, il n’en est rien ; le rapport du bricoleur à la technique est en effet contingent, et non nécessaire.
Cela signifie donc non pas que le bricoleur ne se projette pas dans l’avenir (il doit le faire, pour constituer la trame des gestes techniques lui permettant de réparer l’objet donné), mais que cet avenir diffère en fonction de chaque “ensemble” d’objets ; or, la “composition de [cet] ensemble”, elle, est bien contingente, puisqu’elle dépend non pas de l’objet à réparer à ce moment précis, mes des objets réparés dans le passé.
Le rapport temporel du bricoleur à la technique semble donc davantage tourné vers le passé que vers l’avenir, en tant que sa panoplie d’outils se constitue au fur et à mesure des réparations nécessaires, et non pour la réparation à venir. D’où le fait que Lévi-Strauss définisse davantage le bricolage comme technique en fonction de son “instrumentalité” (c’est-à-dire la disposition et l’utilité spécifiques aux objets dont le bricoleur a besoin) qu’en fonction d’un projet, qui lui, désigne l’ingénieur s’adaptant à une demande extérieure d’un objet à construire, et non à un besoin précis concernant un objet déjà existant. Preuve en est que contrairement à l’ingénieur, qui reste ici le référentiel servant à analyser le bricoleur, celui-ci possède un seul ensemble d’instruments, et non plusieurs pour chaque demande. Or, comment le bricoleur peut-il mener son travail de manière efficace alors qu’il ne semble pas être adapté à toutes les exigences techniques qu’il peut rencontrer ?
- Plus encore, il y a une indétermination de l’utilisation des outils du bricoleur, auxquels rien n’est assigné ; or, c’est ce qui leur permet d’être toujours utiles (“autrement dit” jusqu’à la fin)
Finalement, le bricoleur se situe dans une forme d’astreinte, mot employé par l’auteur, puisqu’il ne peut faire varier ses instruments pour s’adapter à chaque besoin qu’il rencontre. Pourtant, il existe tout de même une adaptabilité dans la forme technique spécifique du bricolage, qui ne réside pas chez le sujet, mais dans les objets qu’il utilise. Apparaît donc une certaine flexibilité dans cette forme de technique, qui marque l’originalité du texte de Lévi-Strauss : si d’habitude, l’adaptation est l’œuvre de l’Homme, c’est ici son moyen technique qui l’assure.
La panoplie du bricoleur est en effet seulement “à demi particularisé[e]” : elle se situe entre particulier et général, puisqu’elle est singulière de par sa composition, mais générale de par son adaptabilité. Le bricoleur a donc un double avantage, celui du “concret” et du “virtuel” : concrètement, il a réparé x et y objets et a donc x et y outils, mais virtuellement, il est capable de réparer d’autres objets avec ces mêmes outils. Cela suppose néanmoins l’accumulation d’un savoir-faire qui puisse ensuite s’appliquer à un objet différent, à des “opérations quelconques”, c’est-à-dire ni déterminées, ni déterminables : d’où la particularité du bricoleur, qui d’un ensemble d’outils donné, parcourt tous les champs des possibles.