Omniprésente dans les existences humaines, la peur traverse les siècles et les civilisations comme une force ambivalente : tantôt instrument de domination, tantôt signal d’alerte, tantôt moteur d’espérance. Elle irrigue nos choix individuels, structure les sociétés, oriente les croyances et fonde parfois jusqu’aux institutions politiques ou religieuses. Des procès politiques aux apocalypses scripturaires, des campagnes de terreur aux réflexions morales les plus profondes, elle surgit toujours là où l’homme se confronte à l’incertain, au danger, à la finitude.
Faut-il alors y voir un obstacle à la liberté, à l’action, à la lucidité ? Ou bien reconnaître, à rebours des apparences, que la peur peut éclairer, réveiller, sauver ? Est-elle seulement une entrave à l’histoire humaine, ou peut-elle en être aussi un moteur ?
C’est à cette tension que se confronte cet article, en explorant tour à tour la peur comme outil de pouvoir, vecteur de sagesse morale et religieuse, levier politique, ressort eschatologique, mais aussi arme de manipulation ou ferment de rédemption. Une traversée philosophique, historique et spirituelle de cette passion souvent honnie, mais fondamentalement humaine.
Peur : entrave ou moteur de l’histoire humaine ?
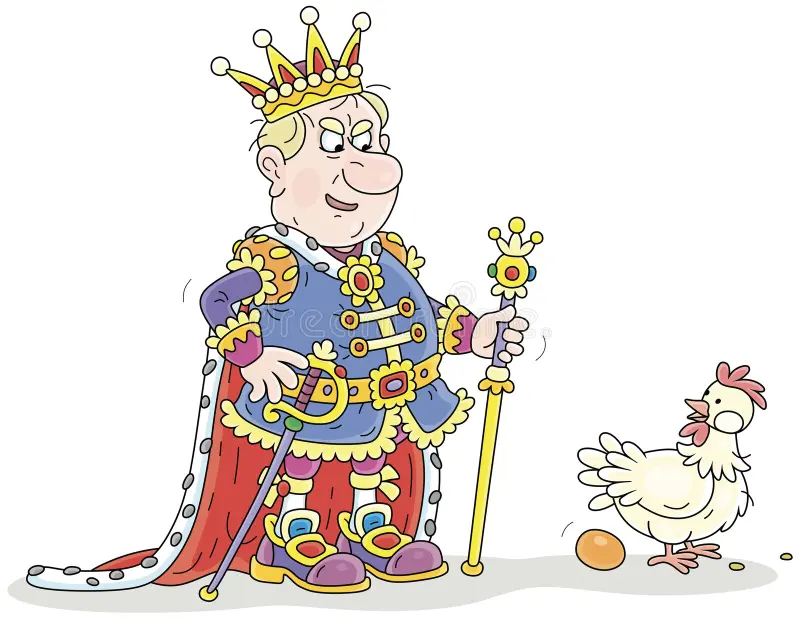
A. Tyrannie de la peur : le pouvoir par la crainte
La peur, conjuguée au pouvoir, s’érige souvent en instrument central de domination. Hannah Arendt, dans Les Origines du totalitarisme, analyse avec rigueur la stratégie des régimes totalitaires : la peur devient alors l’outil-maître de l’atomisation sociale. La terreur installe une défiance généralisée, brise la spontanéité collective, impose la soumission et détruit la capacité de juger ou d’agir de l’individu. Sous le feu croisé des politiques de la terreur, les actes de dénonciation deviennent un réflexe de survie, et l’espace public se vide de toute authenticité.
L’histoire offre des exemples particulièrement frappants de ce mécanisme : lors de la Terreur révolutionnaire de 1793-1794, Robespierre et le Comité de salut public instaurent un climat de peur généralisée. La « loi des suspects » livre citoyens et citoyennes à la toute-puissance de l’État, 16,000 personnes exécutées sous la seule accusation de complot ou d’antipatriotisme. Cette période illustre la logique implacable d’un pouvoir fondé sur la crainte : au nom du salut public, la peur devient une arme de gouvernement, produisant à la fois l’obéissance et le chaos.
Cette dialectique se retrouve jusque dans l’Évangile : l’épisode du procès de Jésus devant Ponce Pilate (Jean 19, 8–16) révèle une autre face de la peur politique. Pilate, bien qu’occupant la position du juge tout-puissant, fléchit devant la pression de la foule : « Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher, mais les Juifs criaient… » Frappé de crainte, il cède la justice à la force des passions collectives. Ainsi, la peur ne soumet pas seulement les dominés : elle habite aussi ceux qui détiennent le pouvoir, les rendant complices parfois, impuissants souvent, face à la logique de la foule ou de l’Histoire.
B. La peur au cœur du discernement moral et religieux
La peur occupe également une place centrale dans le discernement moral et religieux, oscillant entre excès nuisible et vertu régulatrice. Aristote, dans son Éthique à Nicomaque, développe une réflexion fine sur le courage comme juste milieu : il ne s’agit pas d’une absence totale de peur, mais d’une disposition à la maîtriser. Le courage se définit par la capacité à affronter ce qui fait peur, ni en témérité inconsidérée, ni en lâcheté paralysante. Ainsi, la peur n’est pas condamnée en soi, mais doit être modérée et éduquée pour permettre une action juste et bonne.
Un exemple emblématique de la fonction apaisante et transformative de la peur se trouve dans l’Évangile de Marc (4, 35–41). Lorsqu’une tempête violente menace le bateau où se trouvent Jésus et ses apôtres, ceux-ci sont saisis d’effroi face au danger imminent de la mort. Jésus, quant à lui, calme la mer d’un simple « Silence, tais-toi ! » Exécutée avec autorité, cette maîtrise symbolise la victoire de la foi sur la peur. Cet épisode invite à comprendre que la peur fait partie de la condition humaine, mais que la confiance et la sagesse suppriment sa paralysie.
Dans la tradition islamique, la peur apparaît aussi comme un moteur éthique par son rapport au Jugement dernier. La Sourate 99, intitulée « Al-Zalzalah » (Le Tremblement de terre), décrit un cataclysme cosmique qui annonce la fin des temps où chaque âme recevra son dû. Cette peur du châtiment divin et de la justice ultime engage les croyants à une vie droite et responsable. Elle ne vise pas à terroriser, mais à éveiller la conscience morale, en lien avec la notion de taqwa (crainte révérencielle). Ainsi, la peur ne dissout pas la liberté, mais en structure l’acte, guidant vers un chemin de rectitude.
La peur comme gardienne : politique, révélation et fin des temps

A. Dimension politique : légitimation et pacte social
La peur, loin d’être seulement une émotion paralysante, joue un rôle fondamental dans la légitimation du pouvoir politique et la structuration du pacte social. Thomas Hobbes, dans son œuvre majeure Léviathan (1651), explique avec une rigueur philosophique comment c’est précisément la « peur de la mort violente » qui pousse les hommes à quitter l’état de nature, caractérisé par un « bellum omnium contra omnes » — une guerre de tous contre tous. Le mot Léviathan, issu de la tradition biblique, désigne un monstre marin puissant et terrifiant, métaphore d’un État souverain fort capable d’imposer la paix. Hobbes conçoit la peur non seulement comme un mouvement naturel mais comme une condition sine qua non pour instaurer une autorité capable de garantir la sécurité, donc de fonder la société politique.
Cette analyse trouve un écho saisissant dans les réalités géopolitiques modernes, notamment pendant la Guerre froide. La doctrine de la dissuasion nucléaire, incarnée par la crise des missiles de Cuba en octobre 1962, illustre cette peur structurante au niveau international. La peur mutuelle d’une destruction totale, exprimée par la notion de destruction mutuelle assurée (Mutually Assured Destruction – MAD), paradoxalement, garantit la paix entre superpuissances. Ce fragile équilibre repose donc sur une peur rationnelle, politique, qui contraint les États à la prudence et au dialogue. Ainsi, la peur, loin d’engendrer la guerre, devient un facteur de paix et de régulation diplomatique.
Dans le cadre religieux, la dimension eschatologique de la peur trouve une profonde résonance dans la Bible, notamment dans le Livre des Proverbes. Le verset « La crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse » (Proverbes 9,10) invite à comprendre la peur non comme terreur aveugle, mais comme phobos — peur sacrée, respect profond et conscient de la transcendance divine. Le mot hébreu original « yirah » recouvre cette idée ambivalente de crainte mêlée de révérence. Dans le texte apocalyptique, la peur de la fin des temps est aussi une force qui appelle à la conversion et à la purification morale. Elle agit comme un moteur qui pousse à la vigilance et à la repentance, ouvrant la voie à la sagesse et à la vie nouvelle.
B. Les prophéties et le salut : peur de la fin, moteur d’espérance
Les prophéties religieuses, loin de se réduire à de simples annonces terrifiantes, articulent étroitement la peur de la fin avec une puissante espérance de salut et de renouveau. Dans l’islam, la peur liée aux prophéties de la fin des temps se manifeste notamment dans le discours sur la venue d’al-Mahdi, figure centrale des eschatologies chiites et sunnites. Les hadiths rapportés dans le Sahih Muslim soulignent des signes précis annonçant la fin imminente : conflits, propagation du désordre (fitna), et grande peur parmi les peuples. Cette inquiétude, bien que redoutable, porte en elle l’attente joyeuse d’une restauration de la justice divine et humaine, incarnée par l’avènement d’al-Mahdi. L’existence d’un tel espoir transforme la peur en impulsion morale et politique, incitant les croyants à la vigilance et à la persévérance.
Le Coran exprime également ce sentiment universel de frayeur à l’évocation du Jour du Jugement. La Sourate 81, « L’Obscurcissement » (At-Takwir), décrit avec force visuelle les bouleversements cosmiques qui précèdent ce moment : le soleil s’obscurcira, les étoiles tomberont, et chacun fera face à la réalité ultime de ses actes. Cette effroi collectif, loin d’être gratuit, vise à mobiliser la conscience humaine vers une conduite juste.
Un exemple historique marquant sur le lien entre peur, fuite et espérance est l’Hégire, la migration de Mahomet de La Mecque à Médine en 622. Face aux persécutions, la communauté naissante affronte la peur de la mort et de l’exclusion sociale. Pourtant, cette fuite, pleine de risques, incarne aussi l’espoir d’un monde nouveau, d’une société fondée sur la justice, la fraternité et la foi. L’Hégire devient ainsi un acte fondateur où la peur, loin de paralyser, propulse vers un avenir transformé.
Dérives, redemptions et sens éthique de la peur

A. Quand la peur devient instrument de manipulation
La peur, en dépit de ses fonctions régulatrices, peut basculer dans la manipulation et la domination abusive. Nicolas Machiavel, dans Le Prince, propose une réflexion pragmatique sur l’art du gouvernement : il affirme que « il vaut mieux être craint qu’aimé, si l’on ne peut être les deux à la fois ». Cette maxime n’encourage pas une peur aveugle ni tyrannique, mais une crainte mesurée qui préserve l’ordre. Toutefois, Machiavel avertit aussi que la peur peut aisément dégénérer en oppression lorsque le prince abuse de son pouvoir, instillant terreur et suspicion au sein de ses sujets pour se maintenir. La « crainte » devient alors un outil de contrôle, mais toujours fragile, reposant sur la gestion habile des passions collectives.
Un exemple contemporain manifeste de cette dérive est la vague de politiques antiterroristes mises en place après les attentats du 11 septembre 2001, notamment aux États-Unis avec le Patriot Act. Ce texte législatif élargit considérablement les pouvoirs des autorités pour surveiller la population, souvent au nom de la peur du terrorisme. Le climat anxiogène instauré justifie une surveillance accrue, parfois au détriment des droits fondamentaux. Cette instrumentalisation de la peur, bien qu’ayant pour finalité déclarée la protection, révèle ainsi le risque éthique majeur : la peur, lorsqu’elle est exploitée, engendre une société de méfiance et de contrôle, susceptible de miner la démocratie elle-même.
B. Peur rédemptrice ou destructrice ? Vers une sagesse de la crainte
Des exemples historiques et philosophiques illustrent avec force la transformation de la peur en une force éthique et rédemptrice. Saint Augustin, dans La Cité de Dieu (Livre XI, chap. 27), explique que « la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse », non comme une terreur aveugle, mais comme une humble reconnaissance de la souveraineté divine qui conduit à la conversion intérieure. Cette timor Dei réoriente la peur vers une sagesse qui libère l’âme de l’orgueil et la pousse vers la vertu. Cette idée s’illustre concrètement dans l’exemple des martyrs chrétiens des persécutions romaines, tels que saint Étienne ou les premiers chrétiens sous Néron. Face à la torture et à la mort, leur foi transcendait la peur, comme le relate Eusèbe dans Histoire ecclésiastique; ils inscrivaient leur souffrance dans une espérance assurée de la résurrection.
Ce qu’il faut retenir
La peur, tour à tour servitude ou boussole, accompagne l’humanité dans ses choix les plus décisifs. Parfois détournée au service de la manipulation politique ou de la domination, elle peut aussi devenir lucide éveilleuse : Aristote y voit le ferment du courage, Augustin la racine de la sagesse, Hans Jonas la condition d’une éthique prévoyante (« heuristique de la peur »). En religion, elle inspire non la passivité, mais la foi et l’espérance active. Ainsi, la peur se révèle ambivalente : force destructrice sous forme de terreur, elle sait aussi être gardienne de la justice, levier du salut ou tremplin du courage. Savoir la reconnaître, la nommer, l’apprivoiser, voilà l’une des grandes tâches de l’esprit, pour que la peur cesse d’asservir et devienne, enfin, la condition d’une sagesse forte et responsable.












