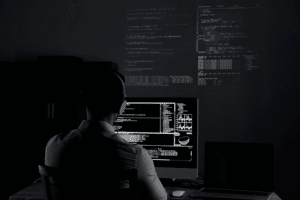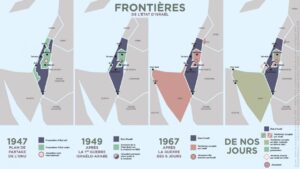La « frontière maritime » est une notion qu’il est essentiel de maîtriser dans le cadre du programme d’histoire-géographie et de HGGSP. Cet article te présente sa définition ainsi que des exemples concrets qui te permettront d’étayer tes copies.
Définition et cadre juridique des frontières maritimes
Qu’est-ce qu’une frontière maritime ?
Contrairement aux frontières terrestres, souvent matérialisées par des murs, des postes frontières ou des bornes, les frontières maritimes sont invisibles à l’œil nu, mais elles n’en sont pas moins fondamentales dans l’organisation des relations internationales. Elles séparent les espaces maritimes placés sous la souveraineté ou la juridiction de différents États. Si tu veux en savoir plus sur la géopolitique des mers, rendez-vous dans cet article.
Ces délimitations permettent de déterminer qui peut pêcher dans une zone donnée, exploiter des ressources pétrolières, poser des câbles sous-marins ou exercer des contrôles de police maritime. Ces frontières sont aussi cruciales pour la sécurité des États côtiers, qui cherchent à protéger leurs intérêts économiques et stratégiques.
Le droit international de la mer
La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM), adoptée en 1982 après près de dix ans de négociations, constitue le socle juridique du droit maritime moderne. Cette convention codifie les différentes zones maritimes et précise les droits et obligations des États dans chacune d’elles :
- La mer territoriale (jusqu’à 12 milles marins) : l’État y exerce une souveraineté quasi complète, semblable à celle qu’il exerce sur son territoire terrestre, à l’exception du droit de passage inoffensif reconnu aux navires étrangers.
- La zone contiguë (jusqu’à 24 milles marins) : l’État peut y faire appliquer certaines lois en matière de douanes, de fiscalité, de santé publique et d’immigration.
- La zone économique exclusive (ZEE) (jusqu’à 200 milles marins) : l’État dispose de droits souverains pour l’exploration et l’exploitation des ressources naturelles, vivantes et non vivantes, de la colonne d’eau et du fond marin.
- Le plateau continental : il peut s’étendre au-delà de 200 milles marins si l’État démontre la prolongation naturelle de son territoire sous-marin, ouvrant la voie à des revendications élargies.
La CNUDM prévoit également des mécanismes pour régler les différends, en privilégiant la négociation. Si aucun accord n’est trouvé, les États peuvent recourir à des juridictions internationales telles que la Cour internationale de Justice (CIJ) ou le Tribunal international du droit de la mer (TIDM).
Méthodes de délimitation des frontières maritimes
La méthode de l’équidistance
La méthode dite de l’équidistance ou « ligne médiane » est la plus utilisée pour délimiter des espaces maritimes. Elle s’appuie sur un principe simple : tracer une ligne dont chaque point est à égale distance des côtes des deux États concernés. Cette méthode est reconnue pour sa neutralité, son objectivité et sa clarté géographique.
Elle est souvent utilisée lorsque les côtes sont relativement droites et lorsque les États sont situés face à face ou côte à côte à des distances similaires. Dans le cas de la Manche, par exemple, la France et le Royaume-Uni ont utilisé cette méthode pour définir leur frontière maritime.
Les circonstances pertinentes
Cependant, la méthode de l’équidistance n’est pas toujours équitable. La jurisprudence internationale a reconnu qu’il peut exister des « circonstances pertinentes » nécessitant une adaptation de la ligne pour parvenir à un résultat équitable.
Ces circonstances peuvent inclure :
- La géographie des côtes : une côte très découpée, la présence d’îles, ou des côtes très disparates en longueur peuvent fausser la ligne d’équidistance.
- L’existence de droits historiques : par exemple, des zones traditionnellement exploitées par les pêcheurs d’un État.
- Des considérations économiques : pour éviter une disproportion trop grande dans l’accès aux ressources maritimes.
Ainsi, la délimitation des frontières maritimes n’est pas simplement une opération technique, mais un exercice politique et diplomatique complexe, nécessitant souvent de longs pourparlers.
Enjeux géopolitiques des frontières maritimes
Des ressources stratégiques
Les espaces maritimes sont une manne de richesses. Les ZEE contiennent d’immenses réserves halieutiques, essentielles à la sécurité alimentaire de nombreux pays. De plus, les fonds marins recèlent des ressources minérales précieuses, notamment des nodules polymétalliques riches en cobalt, nickel et terres rares, éléments clés de la transition énergétique.
Par ailleurs, les gisements d’hydrocarbures offshore, tels que ceux découverts en mer du Nord, en mer Caspienne ou en Méditerranée orientale, attirent l’intérêt des États et des compagnies pétrolières. Ces ressources peuvent exacerber les rivalités entre pays, comme le montre le différend entre Chypre, la Turquie et la Grèce en Méditerranée.
Le contrôle des routes commerciales
80 % du commerce mondial transite par voie maritime. Le contrôle des routes maritimes — détroits, canaux, ports stratégiques — constitue un levier de puissance. Ainsi, des zones comme le détroit d’Ormuz, le détroit de Malacca ou le canal de Panama sont des points de passage essentiels pour le pétrole et les marchandises.
Les États souhaitent sécuriser ces routes, ce qui passe souvent par un renforcement de leur présence navale. Cela engendre parfois une militarisation de certaines zones, comme c’est le cas dans la mer de Chine méridionale, où la Chine construit des bases militaires sur des îles artificielles.
Un enjeu environnemental croissant
L’océan est un écosystème fragile, menacé par la surpêche, la pollution plastique, les marées noires, l’exploitation minière des grands fonds et le réchauffement climatique. Chaque État a la responsabilité de protéger son espace maritime, mais les effets de ces activités sont transfrontaliers.
La gestion durable des ressources marines, la conservation de la biodiversité et la lutte contre le changement climatique nécessitent une coopération internationale renforcée. Des aires marines protégées internationales, comme celle des îles Galápagos, montrent la voie à suivre.
Conflits et différends liés aux frontières maritimes
Mer de Chine méridionale : un foyer de tensions
Ce vaste espace maritime est revendiqué en tout ou partie par sept acteurs : Chine, Taïwan, Philippines, Vietnam, Malaisie, Brunei et Indonésie. Il est stratégique à plusieurs titres : routes commerciales, réserves de pétrole et de gaz, pêche abondante.
La Chine revendique la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale par une ligne appelée « ligne en neuf traits », sans fondement juridique selon la sentence arbitrale rendue en 2016 à La Haye. Pékin a ignoré cette décision et poursuit sa politique de faits accomplis : militarisation des îles Spratleys, patrouilles navales, pressions sur les pêcheurs étrangers. Cette situation accroît les tensions avec les États voisins, mais aussi avec les États-Unis, qui assurent des missions de « liberté de navigation ».
La CIJ entre la Somalie et le Kenya
La Somalie et le Kenya revendiquent une zone triangulaire de l’océan Indien riche en pétrole offshore. Le Kenya proposait une délimitation parallèle à la ligne de latitude, tandis que la Somalie défendait une ligne d’équidistance.
Après des années de négociations infructueuses, la Cour internationale de Justice a tranché en 2021 en faveur d’une solution mixte : une ligne proche de l’équidistance. Le Kenya a refusé cette décision, illustrant les limites du droit international lorsqu’un des États refuse de se soumettre à la juridiction internationale.
La péninsule coréenne : tensions navales en mer Jaune
La ligne de limitation nord (NLL), tracée unilatéralement par les Nations Unies après la guerre de Corée, est régulièrement contestée par la Corée du Nord, qui estime qu’elle empiète sur ses eaux. Cette ligne traverse des zones poissonneuses, ce qui la rend économiquement stratégique.
Plusieurs affrontements navals ont éclaté dans cette zone, causant la mort de soldats des deux camps. Malgré les tentatives de rapprochement intercoréen, cette frontière maritime reste une zone sensible.
La France et ses frontières maritimes
La France est souvent perçue comme une puissance terrestre, mais elle est aussi une grande puissance maritime. Grâce à ses territoires d’outre-mer, elle possède le deuxième domaine maritime mondial (11 millions de km²), derrière les États-Unis. Ses zones maritimes s’étendent dans tous les océans : Pacifique, Atlantique, Indien et même autour de l’Antarctique.
La France a conclu des accords de délimitation avec de nombreux voisins (Royaume-Uni, Espagne, Brésil, etc.), mais certains litiges subsistent :
- En Guyane, la frontière maritime avec le Suriname a donné lieu à des tensions liées à la pêche.
- Au large de Saint-Pierre-et-Miquelon, la délimitation avec le Canada a longtemps été source de contentieux, notamment pour les droits de pêche.
La France défend une approche multilatérale et juridique des différends maritimes. Elle participe également aux efforts internationaux pour protéger les écosystèmes marins, comme à travers la mission « Tara Océan » ou les actions de l’Office français de la biodiversité.
Pour compléter cet article, nous te proposons de visualiser cette vidéo, disponible sur le site Lumni, qui présente l’enjeu des frontières maritimes dans un contexte de mondialisation accru.
Ce qu’il faut retenir sur les frontières maritimes
Les frontières maritimes, invisibles mais omniprésentes, sont au cœur des enjeux géopolitiques, économiques et environnementaux du XXIe siècle. Leur délimitation repose sur des règles de droit international, mais elle est souvent influencée par des rapports de force, des considérations historiques ou des intérêts stratégiques.
Dans un monde globalisé où les ressources marines deviennent vitales, la coopération entre États, le respect du droit international et la préservation des océans sont des défis majeurs. Le dialogue, la diplomatie et les juridictions internationales offrent des outils pour résoudre les différends, mais leur efficacité dépend de la volonté politique des États.