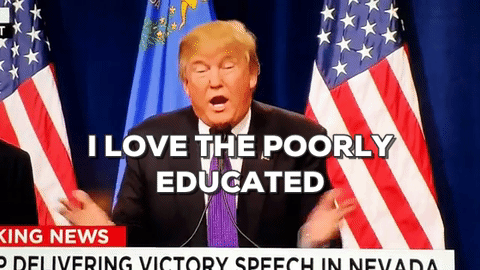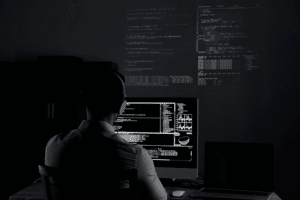Lorsqu’on pense à la connaissance, on imagine d’abord des livres et des chiffres. Mais la connaissance est bien plus que cela. C’est quelque chose qui se propage, se partage, parfois se déforme, mais qui est d’une importance fondamentale. La connaissance, au sens large, est à la fois une quête personnelle (celle du sens, de la vérité, du progrès) et un enjeu collectif, stratégique, souvent conflictuel. Elle est aujourd’hui au cœur des tensions géopolitiques, économiques et sociales.
S’il est une nation qui a bâti sa puissance sur la maîtrise de la connaissance, ce sont bien les États-Unis. Mais les États-Unis, c’est aussi le pays des fake news, d’un président qui n’hésite pas à les propager pour asseoir ses positions, et d’un monde médiatique qui n’a jamais été aussi fragmenté et fragilisé. Leur exemple illustre aussi combien la connaissance est un outil ambivalent, tantôt libérateur, tantôt verrouillé et traître.

La connaissance comme levier de puissance
L’histoire des États-Unis est traversée par cette idée fondatrice : celle d’une nation construite par la science, pour la science. Le rêve américain, en réalité, est aussi et avant tout un rêve technologique : l’homme sur la lune, Internet, ChatGPT : tous ces accomplissements trouvent leur origine dans une volonté politique de produire du savoir pour produire du pouvoir. L’après-Seconde Guerre mondiale est révélateur : alors que l’Europe panse ses plaies, les États-Unis investissent massivement dans la recherche fondamentale. Le rapport Vannevar Bush (1945) est un moment fondateur : il recommande de financer la science comme bien public, afin de mieux comprendre le monde. Par la suite, ce rapport donnera naissance à la National Science Foundation (NSF) et façonnera un modèle américain de recherche basé sur l’alliance entre universités, État et secteur privé, aujourd’hui encore le plus performant au monde.
Le savoir devient capital : capital militaire d’abord, avec le développement d’armes, de satellites, de systèmes de surveillance. Puis vient le capital économique, via les brevets, la R&D, les transferts technologiques, mais aussi le capital symbolique : le savoir américain s’exporte, fascine, devient une forme d’hégémonie culturelle. L’étudiant chinois à Stanford, le doctorant iranien au MIT, l’ingénieur indien chez Google : tous sont venus se former aux États-Unis, reconnaissant implicitement la supériorité (ou du moins l’attractivité) d’un système scientifique structuré.
Mais cette suprématie, qui se veut ouverte, repose en réalité sur un contrôle invisible mais rigide.

La connaissance entre ouverture démocratique et contrôle stratégique
Il existe un paradoxe propre aux démocraties libérales : elles prônent la libre circulation de la connaissance, mais la régulent dès lors qu’elle touche aux intérêts vitaux de l’État. Les États-Unis incarnent ce paradoxe mieux que quiconque. L’exemple du projet Manhattan est emblématique : au nom de la sécurité nationale, la science y devient secrète, militarisée, dirigée par l’État, avant de ruisseler plusieurs années plus tard vers l’économie civile américaine. Depuis, des agences comme la DARPA ou la NSA contrôlent, orientent, parfois verrouillent certaines recherches. Ainsi, la connaissance n’est pas toujours produite pour être diffusée, mais elle peut être retenue, classifiée, protégée, non pour manipuler le savoir, mais pour en conserver l’exclusivité stratégique.
Les États-Unis régulent également l’accès à la connaissance par le biais de la réglementation des visas, des financements, des publications sensibles. Par exemple, un chercheur étranger dans un laboratoire de physique quantique peut se voir interdire l’accès à certains protocoles. Depuis la présidence Trump, puis sous Biden et Trump à nouveau, les tensions croissantes avec la Chine ont entraîné une suspicion généralisée des chercheurs asiatiques, accusés parfois à tort d’espionnage scientifique. L’affaire du professeur Charles Lieber, accusé d’avoir dissimulé ses liens avec des institutions chinoises, symbolise la judiciarisation de la science dans un contexte géopolitique tendu. Aujourd’hui, les décisions du président Trump accentuent ce phénomène de « protectionnisme de la connaissance ».

Les États comme architectes ou gardiens de la connaissance
Derrière les apparences d’une science « sans frontières », les États orientent, coopèrent ou s’affrontent en fonction de leurs intérêts. La coopération existe : les États-Unis participent historiquement à l’OMS, à l’UNESCO, ou aux grands consortiums sur le climat ou la santé mondiale. Mais cette coopération est toujours fragile, souvent conditionnée.
La course au vaccin a révélé combien la production scientifique pouvait être une course économique, diplomatique, voire identitaire. Pfizer/BioNTech, Moderna, Sputnik V, Sinovac : autant de vaccins, autant de drapeaux. On parle ici de « diplomatie vaccinale », où la connaissance médicale devient levier d’influence internationale.
Dans ce contexte, la science n’est pas un langage universel — elle est traduite, interprétée, parfois instrumentalisée selon les agendas nationaux. Ce phénomène s’intensifie aujourd’hui avec l’intelligence artificielle : les modèles de langage, les données, les normes d’éthique sont profondément influencés par le pays d’origine. OpenAI, entreprise américaine, incarne ainsi un modèle culturel autant qu’un outil technique. Faut-il s’en méfier ? L’encadrer par le droit international ? La réguler au niveau national ? Les États-Unis ont longtemps défendu une position de non-ingérence dans l’innovation, mais commencent désormais à structurer des politiques industrielles autour de l’IA, des semi-conducteurs, du cloud, autant de domaines liés à la souveraineté numérique.
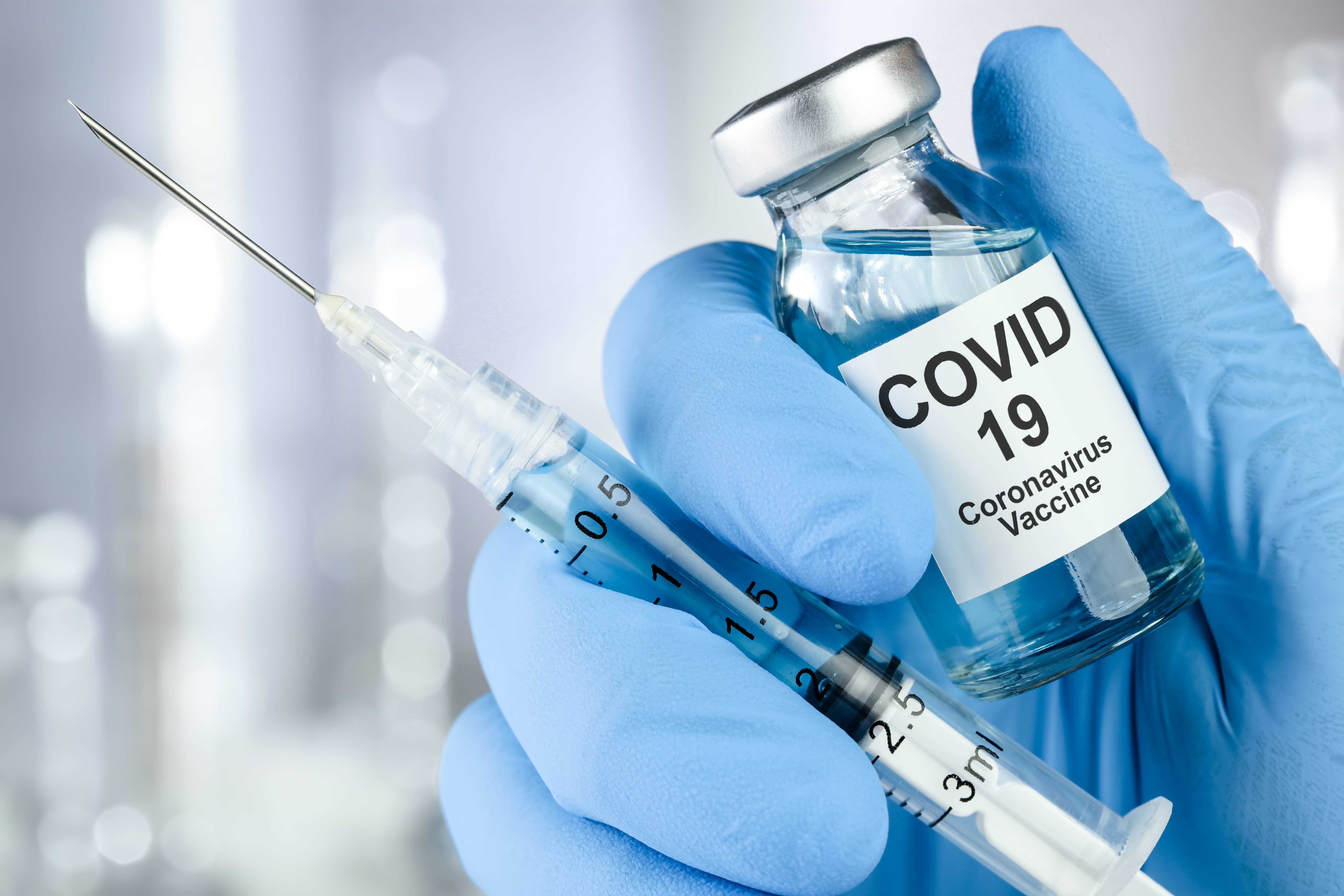
Entre Silicon Valley et Etat profond : la dualité américaine
Le cas américain est fascinant car il est à la fois libertaire et interventionniste. La Silicon Valley incarne la connaissance libre : open source, recherche décentralisée, levées de fonds privées. Pourtant, ces mêmes géants travaillent en étroite collaboration avec l’État fédéral. Google, Amazon, Palantir ou Tesla ont des contrats avec la CIA, le Pentagone, ou la NASA.
Cette dualité se retrouve dans l’éducation : les universités américaines sont parmi les meilleures au monde, mais elles sont aussi inégalitaires. Harvard, Yale ou Stanford attirent des cerveaux du monde entier, mais l’accès y reste conditionné par des critères de revenus, de réseau, voire de nationalité. Il est frappant de constater que la connaissance, même lorsqu’elle se veut universelle, reste profondément marquée par les rapports de classe, de race, de territoire.
Conclusion
La connaissance, lorsqu’elle devient enjeu de puissance, est prise dans trois dynamiques contradictoires : celle de la production (scientifique, libre, compétitive), celle de la diffusion (ouverte, pédagogique, citoyenne), et celle de la protection (stratégique, réglementaire, exclusive). Les États-Unis incarnent pleinement cette triple tension. Leur modèle de recherche, à la fois performant et inégalitaire, ouvert et contrôlé, mondial et nationaliste, est à l’image du XXIᵉ siècle : complexe, instable, en recomposition.
Nous vivons une époque où la connaissance n’est plus seulement une question d’éducation, mais une matière politique, diplomatique et économique. Dans cette bataille feutrée, les États-Unis avancent à la fois comme pionniers et comme gardiens. Ils investissent dans le savoir, en exploitent la puissance, mais en verrouillent les usages. Reste à savoir si cette stratégie les rend plus puissants… ou plus fragiles. Car une nation qui contrôle trop la connaissance finit parfois par en freiner la vitalité, voire à sombrer dans l’ignorance.