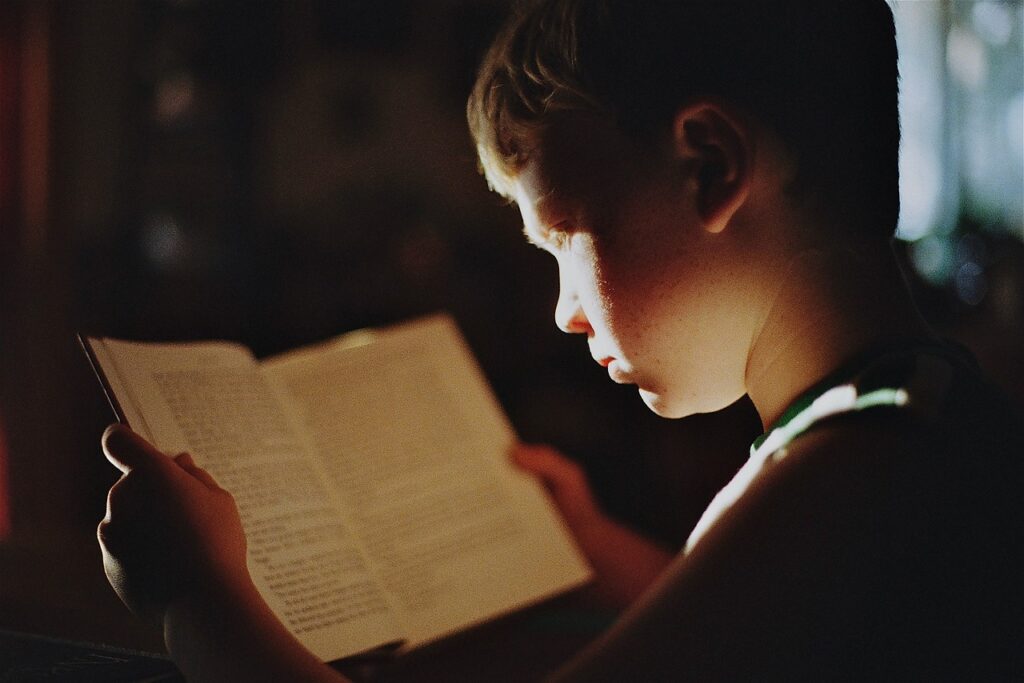Pendant des siècles, les civilisations se sont appuyées sur de grands récits pour donner sens au monde : le progrès, la nation, Dieu, la Révolution, l’humanité. Ces récits offraient une vision unifiée de l’Histoire, promettaient un avenir meilleur, donnaient des repères collectifs. Mais à l’ère de la modernité tardive, marquée par les crises, les désillusions politiques et la montée de l’individualisme, une question se pose : peut-on encore croire aux grands récits ? Entre effondrement des idéologies et fragmentation des discours, entre littérature postmoderne et pensée critique, ce questionnement invite à revisiter les promesses, les échecs et les métamorphoses du sens collectif.
Qu’est-ce qu’un grand récit ?
Une structure fondatrice de sens
Un grand récit est une narration collective qui organise le monde autour d’un but historique, moral ou spirituel. Il relie le passé, le présent et le futur dans une logique cohérente. Par exemple :
- Le récit chrétien du salut, structuré autour de la chute, de la rédemption et de la promesse divine.
- Le récit marxiste de la lutte des classes, menant à la société sans classes.
- Le récit humaniste du progrès, selon lequel la raison et la science permettent d’améliorer indéfiniment la condition humaine.
Ces récits ne sont pas de simples histoires : ce sont des matrices idéologiques qui orientent les choix politiques, les normes sociales, les représentations de soi.
Lyotard et la « fin des grands récits »
Dans La Condition postmoderne (1979), Jean-François Lyotard affirme que la modernité est entrée dans une phase où les grands récits perdent leur crédibilité. Les sociétés postmodernes ne croient plus en un sens unique de l’histoire. On ne parle plus d’humanité, mais d’identités plurielles. Le soupçon, le relativisme et la désillusion remplacent les grands espoirs.
➤ Selon Lyotard, nous vivons dans un monde de petits récits, fragmentés, individuels, éphémères.
La désillusion historique : la crise des idéologies
Les promesses trahies du XXe siècle
Le XXe siècle, théâtre des grandes idéologies, a vu naître puis s’effondrer de nombreux grands récits politiques :
- Le communisme, porteur d’une promesse d’égalité, s’est transformé en régime totalitaire dans plusieurs pays.
- Le nationalisme, censé unir les peuples, a mené aux guerres mondiales et à des génocides.
- Le progrès technologique, censé libérer l’homme, a aussi produit la bombe atomique, la pollution et l’aliénation.
Ces échecs ont provoqué une crise de confiance dans les récits collectifs.
La montée de l’individualisme
À mesure que les grands récits se disloquent, l’individu devient le centre du sens. La quête de vérité laisse place à la recherche d’expérience personnelle, de narrations subjectives, de voix multiples. L’époque moderne ne croit plus en une vérité universelle, mais en une multitude de perspectives.
Le philosophe Gilles Lipovetsky, dans L’Ère du vide, décrit cette mutation comme celle d’une société postmoderne individualiste, marquée par le retrait des grands idéaux collectifs et l’essor d’un hédonisme privé, émotionnel et consumériste. L’individu ne cherche plus à s’inscrire dans un récit historique global, mais à vivre son propre scénario, souvent instable, intime et fragmenté.
La littérature postmoderne : la fin des héros et du sens global
La littérature, miroir des représentations collectives, reflète aussi cette perte de foi dans les grands récits.
Le roman moderne : une crise du récit
Dès le début du XXe siècle, des écrivains comme Franz Kafka, Virginia Woolf ou Marcel Proust mettent en question les structures narratives traditionnelles. Le roman devient fragmenté, introspectif, incertain. Il ne raconte plus une épopée collective, mais le trouble intérieur de l’individu.
➤ Chez Proust, le temps n’est plus linéaire, mais circulaire, fait de souvenirs subjectifs.
Le postmodernisme : ironie, fragmentation, pastiche
Avec des auteurs comme Italo Calvino, Marguerite Duras ou Paul Auster, le récit devient jeu, déconstruction, mise en abyme. Le roman postmoderne ne cherche plus à raconter un monde cohérent, mais à montrer la difficulté de le raconter.
Exemple :
- Dans Si par une nuit d’hiver un voyageur, Calvino propose un roman sans fin, où le lecteur lit sans cesse le début d’histoires inachevées. Le grand récit est remplacé par une expérience de lecture éclatée.
➤ La littérature contemporaine ne raconte plus l’histoire du monde, mais la pluralité des voix, des expériences, des vérités.
Peut-on (re)croire aux récits aujourd’hui ?
Le besoin de récit ne disparaît pas
Malgré le déclin des grands récits idéologiques, le besoin de raconter le monde demeure. L’être humain est un animal narratif : il cherche à donner sens à sa vie à travers des histoires. Ce besoin se manifeste dans :
- Le succès des séries télévisées, qui créent de nouveaux mythes culturels.
- La montée des récits identitaires, à travers les mémoires collectives, les luttes minoritaires, les voix invisibilisées.
- Le développement du storytelling dans le marketing, la politique, les réseaux sociaux.
➤ Ce ne sont plus des « grands récits universels », mais des micro-récits puissants, souvent porteurs de revendications sociales ou affectives.
Les récits écologiques et anthropocènes : un retour du collectif ?
Face à la crise écologique et à l’Anthropocène, on assiste à une tentative de réinventer un récit commun autour de la survie de la planète. Des auteurs comme Bruno Latour ou Baptiste Morizot proposent de repenser notre rapport au vivant à travers des récits non anthropocentriques.
➤ Ces nouvelles narrations cherchent à rallier, mobiliser, responsabiliser, sans revenir à un dogme.
Peut-être est-ce là l’avenir du grand récit : non plus imposer une vérité, mais tisser des liens entre des expériences fragmentées, dans un monde globalisé et en crise.
Conclusion
Peut-on encore croire aux grands récits ? Si l’on entend par là des discours totalisants, fondés sur une vérité unique et universelle, alors sans doute faut-il répondre non. L’Histoire, la littérature et la philosophie ont montré les limites, voire les dangers, de ces constructions. Mais si l’on comprend les grands récits comme des manières de relier, d’imaginer, de construire un sens commun, alors la réponse est peut-être oui mais à condition qu’ils soient ouverts, pluriels, critiques et inclusifs.
Nous ne vivons plus dans l’illusion du sens unique, mais nous avons encore besoin de sens partagé. Et ce sont peut-être la littérature, la philosophie, et les nouvelles formes d’expression collective qui peuvent en esquisser les contours.