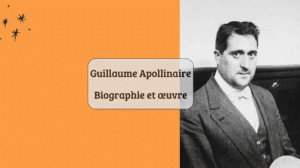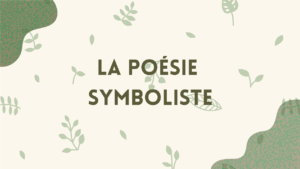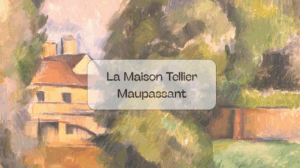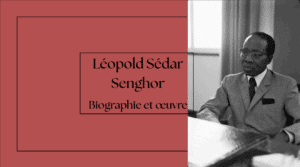Le théâtre est un grand incontournable du baccalauréat de français auquel il faut mieux être bien préparé(e). Dans cet article, nous faisons le point avec toi sur les notions fondamentales à connaître. De quoi te permettre d’employer les mots justes dans tes analyses et d’être capable de commenter avec précision et justesse la structure d’un texte théâtral.
Les genres du théâtre
Comédie : il s’agit d’un genre théâtral qui vise à faire rire le public en se moquant des travers de la société et des comportements humains. Elle utilise souvent des personnages types et des situations cocasses pour divertir le public tout en faisant passer un message critique sur la société. Les comédies peuvent se présenter sous différentes formes, comme la comédie de mœurs, qui se moque des comportements de la société, ou la farce, qui utilise des situations absurdes et des quiproquos pour faire rire le public.
Exemple : Le Malade imaginaire de Molière.
Drame : il s’agit d’un genre théâtral qui met en scène des personnages confrontés à des conflits et des situations dramatiques, souvent graves et émouvantes. Contrairement à la comédie qui cherche à faire rire, le drame cherche à émouvoir et à susciter des réflexions chez le public sur des sujets tels que la condition humaine, la justice, la morale, la religion, etc. Les personnages dans le drame peuvent être complexes et leur développement psychologique est souvent mis en avant.
Exemple : Hernani de Victor Hugo, pour le drame romantique.
Tragédie : il s’agit d’un genre théâtral qui met en scène des personnages confrontés à des événements tragiques, souvent liés à la fatalité ou à des choix qui mènent à leur propre destruction. La tragédie est caractérisée par une atmosphère sombre, une tension dramatique élevée et une issue fatale pour les personnages principaux. Les personnages dans la tragédie sont souvent des héros ou des figures importantes de la société, dont la chute est considérée comme un avertissement sur les conséquences de la démesure, de l’hubris ou de la transgression des lois divines ou humaines.
Exemple : Phèdre de Racine.
Tragi-comédie : il s’agit d’un genre théâtral qui mélange les éléments de la tragédie et de la comédie. Ce genre cherche à provoquer des émotions contrastées chez le public en alternant des scènes dramatiques et sombres avec des scènes légères et comiques. Les personnages dans la tragi-comédie peuvent être confrontés à des situations dramatiques, mais l’issue n’est pas nécessairement fatale ou désespérée comme dans la tragédie. Au contraire, la tragi-comédie peut proposer une fin heureuse ou une issue imprévue qui surprend le public. La tragi-comédie peut également inclure des éléments fantastiques ou merveilleux, tels que des interventions divines, des apparitions surnaturelles ou des rebondissements inattendus. Ce genre a connu un grand succès au XVIIe siècle en France, notamment avec les œuvres de Molière et de Corneille, qui ont mélangé les éléments tragiques et comiques pour créer des pièces divertissantes et réfléchies à la fois.
Exemple : Le Cid de Corneille.
Absurde : il s’agit d’un genre théâtral (et littéraire) qui cherche à remettre en question les conventions sociales, les certitudes et les valeurs traditionnelles en mettant en scène des situations et des personnages décalés, dépourvus de sens ou de logique. Le théâtre de l’absurde, en particulier, met souvent en scène des personnages qui cherchent un sens à leur existence dans un monde incompréhensible et absurde. Les dialogues dans ce genre théâtral sont souvent décousus et dépourvus de cohérence, créant une atmosphère d’aliénation et de désorientation. L’absurde a émergé dans les années 1950 en réaction aux traumatismes de la Seconde Guerre mondiale et a influencé de nombreux artistes et écrivains depuis lors.
Exemple : En attendant Godot de Samuel Beckett.
Théâtre de boulevard : il s’agit d’un genre théâtral qui met l’accent sur l’intrigue, les rebondissements et les quiproquos comiques. Ce genre est souvent associé à la comédie légère et au divertissement, avec des personnages stéréotypés, des situations drôles et des dialogues enlevés. Les pièces de théâtre de boulevard sont généralement destinées à un large public et cherchent à divertir en proposant des histoires divertissantes et cocasses. Le théâtre de boulevard a connu un grand succès au XIXe siècle en France et reste un genre populaire dans le théâtre contemporain.
Exemple : Un fil à la patte de Georges Feydeau.
Mélodrame : il s’agit d’un genre théâtral qui met en scène des histoires émouvantes et passionnées, souvent avec une forte dose de sentimentalisme. Les personnages du mélodrame sont souvent des héros ou des héroïnes confrontés à des épreuves difficiles et dramatiques, telles que des trahisons, des maladies, des catastrophes naturelles ou des injustices sociales. Les intrigues du mélodrame sont souvent ponctuées de moments forts, tels que des révélations choquantes, des retournements de situation inattendus ou des scènes de confrontation dramatiques. Le mélodrame est un genre théâtral qui a connu un grand succès à l’époque romantique, au XIXe siècle, et a souvent été associé à une esthétique grandiose et spectaculaire. Aujourd’hui, le mélodrame est souvent considéré comme un genre quelque peu dépassé et simpliste, mais il continue à inspirer certains artistes et à être présent dans le cinéma et les séries télévisées.
Exemple : Le Bossu de Paul Féval.
La composition d’une pièce de théâtre
Acte : division majeure de la pièce, qui correspond à une étape importante de l’action. Dans la comédie et la tragédie classiques, il doit y en avoir cinq.
Scène : il existe deux définitions pour ce mot (on dit alors qu’il est polysémique).
- Division d’un acte qui se termine lorsque le nombre de personnages sur le plateau change (entrée ou sortie).
- Espace sur lequel jouent les acteurs.
Didascalies : indications scéniques dans le texte théâtral, écrites en italique et destinées à être seulement lues. Elles peuvent concerner le décor, l’intonation, le déplacement, etc.
Mise en scène : travail qui consiste à transformer un texte écrit en performance théâtrale, c’est-à-dire à donner une existence scénique à l’œuvre.
Quatrième mur : convention théâtrale selon laquelle les personnages ne s’adressent pas directement au public, mais jouent leur rôle comme si les spectateurs n’étaient pas là.
Le schéma de l’intrigue de théâtre
Intrigue : chaîne des événements qui constituent la trame de la pièce.
Scène d’exposition : première partie de la pièce dans laquelle sont présentés les personnages, le contexte et l’intrigue.
Péripétie : action secondaire qui contribue à faire avancer l’intrigue.
Dénouement : partie finale de la pièce, qui marque la fin de l’intrigue et la résolution de la crise.
Exemple: le dénouement dans Tartuffe de Molière.
Les types de réplique
Aparté : Convention théâtrale selon laquelle un personnage peut s’exprimer tout haut, sans que les autres sur scène ne l’entendent.
Dialogue : ensemble des propos tenus par des personnages qui échangent entre eux.
Monologue : longue réplique prononcée par un personnage seul sur scène. C’est l’occasion pour le personnage d’exprimer ses doutes, hésitations et sentiments, ce qui permet au spectateur de mieux le comprendre.
Exemple : le monologue délibératif de Rodrigue dans Le Cid de Corneille (Acte I, scène 6).
Réplique : paroles brèves qu’une personne prononce sur scène au cours d’un dialogue.
Tirade : longue réplique au sein d’un dialogue, dans laquelle le personnage s’exprime librement sans être interrompu par ses interlocuteurs.
Exemple : la déclaration d’amour de Phèdre à Hippolyte dans Phèdre de Racine, Acte II, scène 5).
Stichomythies : suite de répliques très courtes et cinglantes, souvent utilisées lors de disputes.
Exemple : dans Le Cid de Corneille : ” LE COMTE : Ce que je méritais, vous l’avez emporté. / DON DIÈGUE : Qui l’a gagné sur vous l’avait mieux mérité. / LE COMTE : Qui peut mieux l’exercer en est bien le plus digne. / DON DIÈGUE : En être refusé n’en est pas un bon signe. / LE COMTE : Vous l’avez eu par brigue, étant vieux courtisan. / DON DIÈGUE : L’éclat de mes hauts faits fut mon seul partisan. […] ” (Acte I, scène 3).
Les formes de comique au théâtre
Comique de situation : comique lié à la scène elle-même, qui peut naître de malentendus, de rebondissements inattendus et burlesques voire de situations ridicules. Il est souvent lié au quiproquo : Méprise sur l’identité d’une personne ou sur les circonstances d’un évènement.
Exemple : dans L’Avare de Molière. Alors que Valère parle de son amour pour Elise, Harpagon croit qu’il courtise son argent : ” VALÈRE : Tous mes désirs se sont bornés à jouir de sa vue ; et rien de criminel n’a profané la passion que ses beaux yeux m’ont inspirée. / HARPAGON : Les beaux yeux de ma cassette ! Il parle d’elle, comme un amant d’une maîtresse. “ (Acte V, scène 3).
Comique de gestes : comique porté par l’attitude du personnage et le jeu d’acteur. Il concerne alors les expressions du visage, la démarche, les chutes, les déplacements arbitraires, les gestes inattendus, etc.
Exemple: les coups de bâtons que donne Scapin à son maître enfermé dans un sac (Les Fourberies de Scapin de Molière, Acte III, scène 2).
Comique de mots : travail sur le choix des mots, la façon dont ils sont prononcés (accent, ton) et la situation dans laquelle ils interviennent.
Exemple : l’absurdité du langage dans La Cantatrice chauve de Ionesco (en particulier la fin de la pièce).
Comique de répétition : répétition de paroles ou de gestes qui entraînent le rire du spectateur.
Exemple : la répétition, sept fois, par Géronte, de la phrase ” Que diable allait-il faire dans cette galère ? ” (Les Fourberies de Scapin de Molière, Acte II, scène 7).
Comique de caractère : comique lié au caractère du personnage et aux réactions qui en résultent.
Exemple : le personnage d’Alceste qui déteste le genre humain dans Le Misanthrope de Molière.
Les expressions latines à retenir
Castigat ridendo mores : “Corrige les mœurs en riant”, maxime appliquée au théâtre classique. Les spectateurs, en se moquant de l’attitude des personnages sur scène, se rendent compte de leurs propres défauts.
Catharsis : principe central de la tragédie antique. Les spectateurs purgent leurs passions, bouleversés par ce qu’ils voient sur la scène.
Deus ex machina : autrefois on faisait apparaître de nulle part des représentations des dieux sur scène grâce à de la machinerie de théâtre. Un dénouement en deus ex machina est aujourd’hui un dénouement inespéré. C’est le cas par exemple de Tartuffe de Molière. Lorsque la situation semble désespérée, un conseiller arrive sur scène et dénoue l’intrigue grâce à un décret signé par la main du roi.
In medias res : cette expression signifie “au milieu des choses” en latin. Elle est utilisée pour décrire une technique de narration qui consiste à commencer une histoire au beau milieu de l’action, sans préambule ni exposition.
Memento mori : cette expression signifie “souviens-toi que tu vas mourir” en latin. Elle est parfois utilisée pour rappeler aux acteurs et aux spectateurs la fragilité de la vie humaine.
Tabula rasa : cette expression signifie “table rase” en latin. Elle est parfois utilisée pour décrire une situation où tous les éléments précédents ont été effacés et où l’on repart à zéro.