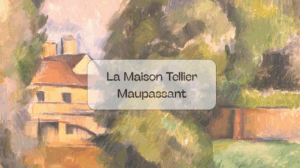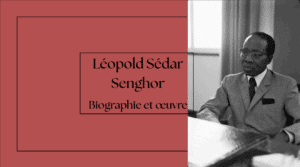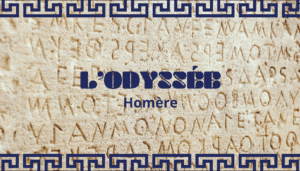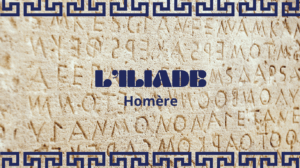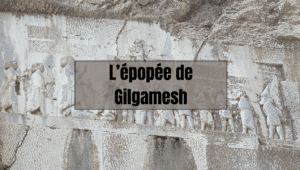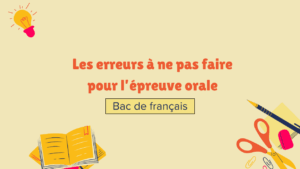Parce que des oeuvres théâtrales sont au programme tous les ans, il est important de connaître les noms de quelques grands metteurs en scène. Cela te permettra d’avoir des références pour parler de mise en scène et te démarquera des autres candidat(e)s.
André Antoine, le metteur en scène du réalisme
André Antoine (1858 – 1943) est un acteur, metteur en scène et critique français.
Il fonde en 1887 le Théâtre Libre, qui entend rompre avec les habitudes de mise en scène. De 1906 à 1914, il est directeur du théâtre de l’Odéon ; mais, au bord de la faillite, il quitte le théâtre pour se tourner vers le cinéma. Fidèle à lui-même, André Antoine adapte alors à l’écran des œuvres de la littérature classique, comme Les Travailleurs de la mer en 1917 ou La Terre en 1919.
Sa touche théâtrale
Antoine s’inscrit dans une veine réaliste : pour lui, le théâtre doit avant tout être vrai. Aussi prête-t-il une grande attention aux décors et aux costumes. Ce metteur en scène révolutionne également le jeu des acteurs en leur demandant d’adopter une expression naturelle qui s’éloigne de la déclamation solennelle.
Jacques Copeau, le metteur en scène de l’authenticité
Jacques Copeau (1879 – 1949) est un critique, metteur en scène et directeur de théâtre français, qui a été très influent dans l’évolution du théâtre au XXe siècle.
Camus écrit ainsi dans Théâtre, Récits, Nouvelles : ” Dans l’histoire du théâtre français, il y a deux périodes : avant et après Copeau “.
En 1908, Copeau crée, avec André Gide notamment, la Nouvelle Revue Française (NRP), qui existe toujours aujourd’hui. Cinq ans plus tard, il fonde le théâtre du Vieux-Colombier qu’il dirige pendant plusieurs années et dans lequel il fait jouer ses pièces.
Sa touche théâtrale
Face aux nouveaux moyens que le progrès technique offre au théâtre, Copeau choisit de garder un théâtre authentique, sans artifice ni trucage.
Pour lui, l’interprétation de l’acteur est plus importante que la mise en scène ou le décor. Il écrit d’ailleurs dans son manifeste de 1913 (publié dans la NRP à l’occasion de l’ouverture du théâtre du Vieux-Colombier) : ” Bonne ou mauvaise, rudimentaire ou perfectionnée, artificielle ou réaliste, nous entendons nier l’importance de toute machinerie […]. Pour l’œuvre nouvelle, qu’on nous laisse un tréteau nu. “
Louis Jouvet, le metteur en scène au service de l’oeuvre
Louis Jouvet (1887 – 1951) est un acteur et metteur en scène français. D’abord pharmacien, il s’oriente rapidement vers le théâtre et entre au Vieux Colombier, où Jacques Copeau influence considérablement sa conception du théâtre.
En 1922, il donne ses premières mises en scènes au théâtre des Champs-Elysées. C’est alors pour lui le début du succès, et il devient directeur de plusieurs théâtres parisiens. Parallèlement à son activité théâtrale, il joue dans plusieurs films, parmi lesquels Les Bas-Fonds de Jean Renoir (1936) ou Quai des Orfèvres de Clouzot (1947).
Sa touche théâtrale
Dans la lignée de Copeau, Jouvet prône un effacement devant l’œuvre qui permet au texte de retrouver une place centrale. Le théâtre est dès lors un travail d’humilité. Jouvet écrit ainsi dans Réflexions du comédien (1941) : ” Mettre en scène, c’est servir l’auteur, l’assister par une totale, une aveugle dévotion qui fait aimer son œuvre sans réserve. ”
Jean-Louis Barrault, le metteur en scène du spectacle total
Jean-Louis Barrault (1910 – 1994) est un acteur, metteur en scène et directeur de théâtre français. Il entre à la Comédie Française en 1940, de laquelle il démissionne en 1946. Avec Madeleine Renaud, son épouse, il fonde la Compagnie Renaud-Barrault. Tout au long de sa vie, il monte des œuvres issues du répertoire classique comme des pièces contemporaines.
Sa touche théâtrale
Barrault s’inscrit dans la lignée du ” spectacle total “ d’Antonin Artaud. Selon Artaud, le théâtre doit être un spectacle vivant et violent, un ” théâtre de la cruauté “. Le but d’une représentation est d’ébranler le spectateur : pour y parvenir, le texte doit alors être subordonné à la mise en scène.
Dans cette veine, Barrault joue tout particulièrement sur la gestuelle des corps et l’intensité de la récitation. Pour mieux comprendre sa conception de la mise en scène, on écoutera l’entretien qu’il donne à propos de Phèdre (1959), dans lequel il insiste sur ce qu’il appelle la ” gestuelle verbale “.
Jean Vilar, le metteur en scène de la sobriété
Jean Vilar (1912 – 1971) est un écrivain, acteur et metteur en scène français. Il rencontre très rapidement le succès après ses premières mises en scène. En 1947, il crée le Festival d’Art Dramatique, aussi appelé Festival d’Avignon, qu’il dirige jusqu’à sa mort. Il prend également la tête en 1951 du Théâtre National Populaire (TNP), au sein duquel il souhaite encourager la réflexion collective sur le théâtre.
Sa touche théâtrale
Avec le TNP, Vilar exprime une conception très épurée de la mise en scène : elle doit être sobre et dépouillée afin de laisser aux acteurs un espace de liberté totale. Libérée de tout artifice, la représentation doit laisser voir la rencontre entre l’acteur et le texte. C’est dire l’importance de l’expression personnelle de l’acteur.
Patrice Chéreau, le metteur en scène de l’innovation
Patrice Chéreau (1944-2013) était un metteur en scène, réalisateur, scénariste et producteur français connu pour sortir des sentiers battus. Son travail, reconnu comme innovant, à marquer la scène française de plusieurs domaines : le théâtre évidemment, mais aussi l’opéra et le cinéma.
Il a eu une carrière intense et rythmé par des scènes audacieuses et contemporaines d’œuvres classiques telles que des pièces de Molière (Dom Juan), de Marivaux (La Dispute, La fausse suivante) ou encore de Shakespeare (Richard II, Hamlet). À l’opéra, il s’est notamment fait connaître grâce à sa production de « L’anneau du Nibelung » au festival de Beyreuth (Allemagne, 1976) suscitant les réactions des passionnés. Enfin, au cinéma, il est notamment connu pour l’adaptation cinématographique de « La Reine Margot » (1994), ouvrage d’Alexandre Dumas. Un film qui lui vaudra de nombreux prix, dont le prix du jury au Festival de Cannes.
Sa touche théâtrale
C’est un metteur en scène particulièrement apprécié par ses mises en scène focalisées sur les émotions des personnages. Patrice Chéreau était doué pour mettre en valeur la complexité humaine qui conduisait souvent à des comiques de situation.
Sa vision artistique audacieuse et sa capacité à défier les limites du « politiquement correct » et de l’interprétation artistique étaient très appréciées. C’est un metteur en scène qui a influencé le monde du théâtre actuel. Son héritage artistique perdure puisque son travail continue d’inspirer artistes et créateurs à travers le monde.
Ariane Mnouchkine, le metteur en scène du mouvement
Ariane Mnouchkine (1939 – . ) est une metteuse en scène et réalisatrice française. En 1964, elle fonde avec d’autres étudiants le Théâtre du Soleil, qu’elle dirige toujours aujourd’hui. Si elle met en scène des œuvres classiques et contemporaines, elle représente également les siennes, comme Une Chambre en Inde (2016).
Sa touche théâtrale
Ariane Mnouchkine pense un théâtre en perpétuel mouvement. Pour elle, loin d’être figé, le théâtre doit reposer sur le création commune et l’improvisation. Dans la lignée d’Artaud, elle travaille également beaucoup la dimension visuelle et sonore de ses mises en scène, en s’inspirant par exemple du cirque. Cela peut même parfois sembler excessif, comme on pourra le constater dans cet extrait d’Agamemnon de Racine (1992).
Daniel Mesguich, le metteur en scène du non verbal
Mesguich (1952 -.) est un acteur, metteur en scène et professeur de théâtre français. Il fonde sa compagnie, le Théâtre du Miroir, dès sa sortie d’Ecole, ce qui lui permet de monter très tôt ses propres pièces. Il en a aujourd’hui plus d’une centaine à son actif, issues autant du répertoire classique que du contemporain.
Sa touche théâtrale
S’il reste fidèle au texte, Mesguich travaille beaucoup le non-verbal et la gestuelle de ses acteurs, ce qui lui permet d’aller au-delà de la pièce écrite. Il prend le parti d’innover et de proposer des interprétations parfois très personnelles des textes, en utilisant par exemple des costumes contemporains.
Ainsi, dans sa mise en scène de Dom Juan (1997), Mesguich propose-t-il une interprétation moderne et originale en associant le personnage libertin au fascisme. La scène où Monsieur Dimanche vient réclamer à Dom Juan l’argent qu’il lui doit (Acte IV scène 3) est particulièrement évocatrice. Jouant sur les clichés historiques qui conjuguent argent et juifs, Mesguich associe le créancier au judaïsme, comme en témoignent les costumes. En fin de scène, les directives autoritaires de Dom Juan ainsi que les jeux de lumière, de voix et de bruits de train font très explicitement référence à la Shoah : il y a là un vrai dépassement et une interprétation moderne de la pièce.
Joël Pommerat, le metteur en scène poétique
Joël Pommerat (1963-.) est un auteur et metteur en scène français reconnu pour ses pièces de théâtre contemporaines et son style très visuel et poétique. Il crée des spectacles originaux dans lesquels ils abordent des sujets universels et intemporels. Tout le monde peut s’y rattacher.
Sa plus grande force ? Savoir capturer l’essence humaine et en faire quelque chose de drôle. L’Homme se moque alors de lui-même. C’est d’ailleurs en partie grâce à ce talent qu’il a été récompensé de plusieurs prix tels que de nombreux Molière (dont celui du meilleur metteur en scène en 2016 et en 2018) ainsi que du Grand Prix du théâtre de l’Académie française (2015). Ses pièces les plus connues sont “Cendrillon”, une adaptation moderne du conte féerique mondialement connu et “Ma chambre froide” une pièce qui a marqué le public par ses scènes intimes et intenses.
Sa touche théâtrale
Ce qui le démarque des autres metteurs en scène ? Sa capacité à créer des univers théâtraux poétiques et visuellement captivants. Ses décors sont très appréciés des amateurs de théâtre. Aussi, en exploitant les diversités et contrastes de la condition humaine, ses pièces comportent un grand nombre de comiques de situation et de caractères, entraînant le rire du public. Il arrive à captiver son public.
Wajdi Mouawad, le metteur en scène spectaculaire
Mouawad (1968-.) est un acteur, écrivain et metteur en scène qui naît au Liban puis immigre avec la guerre civile en France puis au Québec. Il fonde plusieurs compagnies, parmi lesquelles ” Au carré de l’hypoténuse ” et ” Abé carré ” en 2005. Depuis 2007, il est directeur artistique du Théâtre français du Centre national des Arts à Montréal.
Mouawad écrit et met en scène ses pièces, en particulier sa trilogie Littoral, Incendies et Forêts, qui interroge la quête des origines. Il met également en scène les pièces d’autres auteurs, notamment Sophocle pour lequel il a le projet de représenter toutes les tragédies.
Sa touche théâtrale
Ses mises en scène, souvent spectaculaires voire violentes, entendent exploiter toutes les possibilités du théâtre, que ce soit au niveau des lumières, des décors, de la musique ou des costumes. Le théâtre est avant tout un spectacle à voir et à entendre, comme on peut le voir avec Antigone de Sophocle, dans laquelle certaines répliques sont même chantées.
Les auteurs des oeuvres au programme 2023, en tant que metteur en scène
Molière, en tant que metteur en scène
Molière, en tant que metteur en scène, a laissé une empreinte indélébile dans le monde du théâtre. Connu principalement en tant qu’écrivain et comédien, Molière a également joué un rôle essentiel dans la mise en scène de ses propres pièces. En plus d’écrire les textes, il travaillait sur les aspects visuels, la direction d’acteurs et la création globale de ses productions théâtrales. Son talent de metteur en scène se reflétait dans la manière dont il conceptualisait et présentait ses œuvres sur scène, captivant le public avec son sens aigu du rythme, de la mise en scène comique et de l’expression corporelle. Molière a révolutionné le théâtre de son époque et continue d’inspirer les metteurs en scène d’aujourd’hui.
Marivaux, en tant que metteur en scène
Marivaux, a apporté sa propre vision artistique et son expertise au monde du théâtre. Connu comme écrivain de pièces de théâtre, Marivaux était également impliqué dans la mise en scène de ses œuvres. En tant que metteur en scène, il travaillait sur les aspects visuels, la direction d’acteurs et la création globale de ses productions théâtrales. Marivaux était reconnu pour sa finesse dans l’écriture des dialogues et des intrigues, et il mettait tout en œuvre pour que ses pièces soient présentées de manière captivante sur scène. Son sens aigu de l’esthétique et sa volonté de créer des expériences théâtrales uniques ont contribué à l’appréciation durable de son œuvre. Ainsi, Marivaux a laissé sa marque en tant que metteur en scène talentueux, offrant au public des productions théâtrales riches en émotion et en subtilité.
Jean-Luc Lagarce, en tant que metteur en scène
Jean-Luc Lagarce a laissé une empreinte indélébile dans le domaine théâtral. Bien qu’il soit plus connu en tant qu’auteur, Lagarce a également exercé ses talents dans la mise en scène de ses propres pièces ainsi que d’autres œuvres théâtrales. En tant que metteur en scène, il portait une attention particulière à la mise en espace, à la direction d’acteurs et à la création d’une atmosphère unique sur scène. Lagarce était reconnu pour son approche innovante et audacieuse, cherchant à repousser les limites du théâtre conventionnel. Son travail se caractérisait par un langage poétique et une exploration profonde des émotions humaines. En tant que metteur en scène, Lagarce cherchait à créer des expériences théâtrales intenses et émouvantes, captivant le public avec des mises en scène puissantes et des interprétations originales. Son héritage en tant que metteur en scène est une contribution précieuse à l’évolution du théâtre contemporain.
Lire aussi : Bac français 2023 : les œuvres au programme